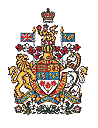Bonjour.
Je tiens à remercier les témoins d'être parmi nous aujourd'hui.
Comme vous le savez, conformément au paragraphe 108(2) du Règlement, nous étudions la violence contre les femmes autochtones. Nous examinons les causes, l'étendue et la nature de cette violence contre elles, tant dans les réserves qu'à l'extérieur. En consultation avec les femmes autochtones, nous essayons de formuler des recommandations et de trouver des solutions pour nous attaquer au problème.
Aujourd'hui, nous accueillons trois témoins: Michelle Mann, avocate et consultante, qui comparaît à titre personnel, Irene Compton, gestionnaire du Programme culturel du Minwaashin Lodge, et Conrad Saulis, directeur de la politique, à l'Association nationale des centres d'amitié.
La règle habituelle veut que chacun de vous, étant donné que vous représentez des organisations différentes, ait 10 minutes pour faire un exposé. Je vous ferai signe deux minutes avant la fin pour que vous puissiez conclure. Puis, nous passerons aux questions et réponses. Le moment venu, je vous expliquerai un peu différemment comment les choses se passent.
Ce sera d'abord Mme Mann.
Comme on l'a dit, je suis avocate. J'ai été appelée au Barreau de l'Ontario en 1996. J'ai exercé le droit autochtone au ministère fédéral de la Justice et à la Commission des revendications des Indiens du Canada. Depuis 2002, je suis consultante et j'écris sur des questions de droit et de politique intéressant les Autochtones. J'ai rédigé de nombreux rapports, articles et chapitres de livres portant sur les questions autochtones.
Aujourd'hui, je vais aborder un sujet dont j'ai parlé dans un document publié l'automne dernier, soit la réforme des lois sur la prostitution sous l'angle de ses effets sur les femmes et jeunes filles autochtones. La prémisse du document: malgré l'énorme surreprésentation des femmes autochtones parmi les travailleuses du sexe dans les rues et parmi les personnes tuées et disparues, les débats sur la réforme des lois sur la prostitution mettent rarement l'accent sur les moyens d'atténuer leur exploitation sexuelle et leur vulnérabilité à la violence courante qui va de pair avec cette exploitation.
Les réformes des lois sur la prostitution doivent tenir compte de la situation des plus surreprésentées et des plus vulnérables des travailleuses du sexe: les femmes autochtones.
Vous avez certainement déjà entendu beaucoup de choses sur l'inégalité des femmes autochtones dans la société canadienne et la façon dont elle avive la vulnérabilité à l'exploitation et à la violence. La discrimination raciale et sexuelle, alliée à la pauvreté, à un mauvais état de santé, à la participation au commerce du sexe et d'autres facteurs aggrave le problème d'inégalité.
Toutes les travailleuses du sexe sont extrêmement vulnérables, mais celles qui font de la sollicitation dans les rues le sont encore plus. Selon une étude réalisée à Vancouver, un tiers des femmes disent avoir été agressées pendant qu'elles travaillaient dans la rue.
La discrimination et l'inégalité des femmes autochtones dans la société contribuent aussi à les faire percevoir comme des proies faciles pour la violence et l'exploitation.
La marginalisation sociale et économique, conjuguée à la toxicomanie et à d’autres facteurs, a fait en sorte que les femmes autochtones sont considérablement surreprésentées parmi les travailleuses du sexe. À Winnipeg, 70 p. 100 des jeunes exploités sexuellement et 50 p. 100 des travailleuses du sexe adultes sont d'origine autochtone dans une ville où les Autochtones représentent environ 10 p. 100 de la population. À Vancouver, la proportion des jeunes et adultes autochtones des deux sexes exploités sexuellement peut atteindre 40 p. 100. Et au moins le tiers des femmes disparues dans le Downtown East Side de Vancouver sont autochtones.
Le risque accru de violence, pour toutes les travailleuses du sexe dans les rues, est souvent particulièrement grave pour les femmes autochtones, qui sont plus susceptibles de vivre dans une pauvreté extrême et d'être toxicomanes. Généralement, les travailleuses du sexe dans les rues se livrent à cette activité pour survivre et sont souvent toxicomanes et malades, et on ne veut probablement pas d'elles là où la prostitution se pratique à l'intérieur. Elles peuvent souffrir de maladies mentales ou des troubles causés par l'alcoolisation foetale, et être peu instruites.
La colonisation, les pensionnats, l'effondrement général des collectivités, la marginalisation sociale et économique, et une tradition de politiques gouvernementales colonialistes — ce dont vous avez sûrement entendu parler — sont autant de facteurs qui contribuent à la surreprésentation des Autochtones parmi les travailleuses du sexe. Ce fait est inextricablement lié à la nature systémique et à l'omniprésence de l’inégalité des femmes autochtones dans la société canadienne.
Passons aux questions juridiques. Juridiquement, la prostitution est légale au Canada, mais certaines interdictions prévues dans le Code criminel dressent des barrières. La communication avec le client, la tenue d'une maison de débauche, l'incitation et le fait de vivre des produits de la prostitution sont illégaux. Résultat: la travailleuse du sexe, le proxénète et le client sont tous criminalisés. Toutefois, la loi n'a pas été appliquée de façon uniforme au Canada. Les prostituées de luxe qui ne sont pas dans les rues travaillent à peu près impunément, alors que les plus vulnérables et les plus marginalisées, celles des rues, qui sont souvent autochtones, sont couramment arrêtées. La prostitution des rues ne représente que de 5 à 20 p. 100 du commerce du sexe, mais elle est à l'origine de plus de 90 p. 100 des incidents liés à la prostitution signalés par la police.
Alors que les femmes autochtones sont particulièrement vulnérables, la police canadienne a souvent omis de leur assurer une protection suffisante. La police est perçue comme indifférente et passive, lorsqu'il s'agit de la disparition de travailleuses du sexe et de femmes autochtones. Un gros obstacle à l'amélioration des relations entre la police et les travailleuses du sexe est la criminalisation constante de ces travailleuses, qui peuvent hésiter à faire appel à la police ou aux services sociaux parce qu'elles se livrent à une activité criminelle.
La dépénalisation et la légalisation sont généralement présentées comme un moyen d'assurer une plus grande sécurité aux travailleuses du sexe, car les prostituées pourraient travailler à l'intérieur, dans un milieu protégé. Elles auraient aussi un meilleur accès à la police et aux services sociaux et de santé. Toutefois, les pays qui ont dépénalisé et légalisé la prostitution, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Allemagne et les Pays-Bas, ont vu augmenter le trafic de personnes.
Au Canada, le Code criminel et la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés comportent des dispositions sur le trafic des êtres humains, mais on commence à peine à remarquer le problème du trafic des femmes et des jeunes filles autochtones à l'intérieur du Canada. Peu importe l'approche retenue, certaines travailleuses du sexe, surtout les plus défavorisées, resteront dans les rues. Voilà pourquoi l'exemple de la Nouvelle-Zélande est très intéressant. En 2003, ce pays a dépénalisé la prostitution chez les adultes. En 2007, le Prostitution Law Review Committee a étudié les effets de la dépénalisation de 2003, et il a conclu qu'il y avait parmi les prostituées des rues un nombre disproportionné d'aborigènes pauvres. Les travailleuses des rues étaient plus susceptibles que celles qui travaillent à l'intérieur ou dans des services privés de déclarer avoir été agressées physiquement ou menacées par un client, retenues contre leur gré ou violées au cours des 12 mois précédant l'étude. C'était après la dépénalisation.
Il a été constaté que le dixième des travailleuses du sexe étaient dans la rue, proportion semblable à celle d'avant la dépénalisation. Dans l'échantillon étudié, la moitié des femmes étaient des Néo-Zélandaises d'origine européenne et le tiers des Maories. L'évaluation que le gouvernement a faite en 2007 révèle que 64 p. 100 des prostituées des rues étaient de l'ethnie maorie, alors qu'elles ne représentaient que 31 p. 100 des femmes engagées dans le commerce du sexe. Elle signale qu'elles sont toujours vulnérables à la violence et hésitent à faire appel à la police.
Les résultats préliminaires de 2007 montrent donc que la loi dépénalisant la prostitution a profité surtout à celles qui travaillent à l'intérieur et dans un cadre privé, où prédominent les Néo-Zélandaises d'origine européenne. Il est important de tenir compte de ces résultats dans la réforme des lois canadiennes sur la prostitution.
Toutes les femmes ne pourront pas offrir leurs services à l'intérieur. Même s'il y a légalisation ou dépénalisation, il y aura des prostituées dans les rues. Vu les statistiques actuelles, nous avons toute raison de croire que les femmes autochtones seront largement surreprésentées dans ce groupe, comme le sont les femmes maories.
Faisons une comparaison avec la Suède, premier pays à criminaliser, en 1999, seulement les proxénètes et les acheteurs de services sexuels et non les travailleuses du sexe. Officiellement, la prostitution est perçue comme une agression sexuelle et un acte de violence contre les femmes. Cette dépénalisation, pour les prostituées, favorise la réalisation d'un objectif: faciliter la déclaration des rendez-vous dangereux et des agressions à la police, à supposer qu'il y ait une police pour intervenir et qu'on établisse de meilleures relations entre elle et les travailleuses du sexe. En Suède, des femmes qui vendent toujours des services sexuels ont dit qu'elles se sentaient plus à l'aise pour déclarer les crimes à la police.
Je conclus. Les statistiques montrent que les lois canadiennes sur la prostitution et leur application peuvent favoriser l'apparition d'une sous-classe de travailleuses du sexe en danger et criminalisées, et elles sont trop souvent autochtones. La loi seule ne peut apporter une solution, mais il est souvent arrivé, dans le discours sur la réforme des lois sur la prostitution au Canada, qu'on oublie de se demander qui profitera de la dépénalisation de ce commerce et qui risque d'être laissé pour compte.
La dépénalisation de la prostituée serait visiblement à l'avantage de toutes les travailleuses du sexe et surtout des plus vulnérables: celles des rues, qui ont le plus besoin des services policiers et sont le plus souvent condamnées. En fin de compte, il faut se demander quelles réformes de la législation serviront et protégeront le mieux les plus défavorisées dans un groupe déjà marginalisé.
Quant aux recommandations précises, je préconiserais clairement la dépénalisation pour la prostituée ou la travailleuse du sexe; une plus grande insistance, dans les discussions au sujet de la réforme, sur les femmes autochtones dans le commerce du sexe; et, bien que je n'en aie pas beaucoup parlé, la sensibilisation des policiers aux différences raciales et culturelles.
:
Merci de m'avoir invitée à vous parler aujourd'hui. C'est un honneur de représenter les femmes et les enfants autochtones dont s'occupe le Minwaashin Lodge et de donner une voix à d'innombrables femmes des premières nations, métisses et inuites qui vivent la réalité de la violence dans notre collectivité.
Je vais profiter du temps qui m'est accordé pour parler des causes et de la prévalence de la violence ainsi que des solutions, comme il est dit dans votre mandat, en insistant sur les solutions qu'on peut trouver avec la collaboration des femmes autochtones.
Le problème de la violence faite aux femmes au Canada a été signalé pour la première fois en 1993, année où Statistique Canada a fait sa première enquête spécialement consacrée à ce problème. On a appris à comprendre qu'il s'agit d'un problème complexe à aborder dans le contexte de la réalité de la femme. Dans le cas de la violence contre les femmes autochtones, cette réalité a de profondes racines qui traversent le temps.
L'Association des femmes autochtones du Canada a rédigé un document de fond, Violence Against Aboriginal Women and Girls, répond clairement aux questions que pose le comité. Le premier paragraphe dit: « La violence systémique contre les femmes et les jeunes filles autochtones, leurs collectivités et leurs nations repose sur le colonialisme... » Le document décrit l'impact de la Loi sur les Indiens sur les femmes et jeunes filles autochtones. La colonisation et la tentative d'assimilation par la Loi sur les Indiens et le réseau des pensionnats ont déchiré des familles, des collectivités et des nations.
Les séquelles de ce passé ont été et demeurent catastrophiques pour tous les Autochtones. C'est pourquoi la violence contre les femmes autochtones est si répandue.
Je voudrais me présenter. Je m'appelle Irene, j'appartiens à la première nation Saulteaux et à la bande de Keeseekoose, en Saskatchewan. Je fais partie du clan de l'ours. Je suis également une survivante des problèmes intergénérationnels causés par les pensionnats. Ma mère est allée au pensionnat de 1926 à 1942. Si elle avait vécu plus longtemps, elle aurait aujourd'hui 89 ans. Elle a eu neuf enfants. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que deux. Ma plus jeune soeur s'est suicidée à 20 ans, en 1979. Récemment, deux de mes soeurs sont mortes prématurément, victimes de l'alcoolisme et de la maladie mentale. Une autre soeur a été tuée sur la route Yellow Quill, en Saskatchewan, en 1968. À combien de malheurs une famille peut-elle résister?
La plupart de mes frères et soeurs ont souffert d'alcoolisme et de dépression. Mon frère et moi sommes les deux derniers survivants de la famille. Si nous sommes toujours là et en bonne santé, c'est parce que nous avons eu la chance de suivre notre parcours de guérison. Pendant des années, je n'ai pas dit un mot de mon passé. C'était trop pénible. Il était plus facile de nier que j'aie eu des problèmes. Du reste, il n'y avait aucun endroit sûr où je pouvais raconter mon passé et obtenir l'aide dont j'avais besoin.
J'ai porté cette douleur jusqu'à ce que le créateur m'amène à Ottawa et que je sois appelée à être cofondatrice de l'Aboriginal Women's Support Centre, en 1993. C'est en travaillant au Minwaashin Lodge que j'ai trouvé mon identité et ma raison d'être, le courage de guérir et la capacité de faire à mon tour quelque chose pour les autres. Tout ce que je peux dire, c'est que ce fut un parcours de croissance personnelle et professionnelle.
Venons-en rapidement à aujourd'hui. Il a fallu 40 ans pour que le gouvernement commence à aider des organisations comme le Minwaashin Lodge. J'espère voir de mon vivant une nette diminution du nombre de traumatismes intergénérationnels non résolus chez les femmes autochtones.
Mon histoire ressemble beaucoup à celles que racontent les femmes qui viennent recevoir les services du Minwaashin Lodge. La plupart d'entre elles sont des survivantes des traumatismes intergénérationnels attribuables aux pensionnats. Certaines ne connaissent ni leur identité ni leur culture parce que la honte a pesé sur des générations et que leur mère ont décidé de ne pas leur apprendre leur langue ni leurs coutumes. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à récupérer leur patrimoine et leur culture grâce au Programme culturel du Minwaashin Lodge.
Beaucoup de femmes que nous accueillons souffrent des effets de la toxicomanie, de la pauvreté, des traumatismes non résolus, de problèmes de santé mentale non traités et d'un manque d'estime de soi. Le Minwaashin Lodge offre des programmes et services qui aident les femmes et leurs familles à se faire une vie libre de la violence.
Nous sommes actifs à Ottawa depuis 17 ans. Nous avons vu beaucoup de femmes suivre un parcours de guérison, faire de modestes progrès avec courage et acquérir la confiance voulue pour que de bonnes choses se produisent dans leur vie. Nous avons une équipe de conseillers psychologiques qui aide beaucoup de femmes à gérer leurs traumatismes non résolus. Nous comptons aussi dans notre personnel une grand-mère pour aider les femmes en leur donnant le soutien de la tradition et en leur proposant des cérémonies de guérison.
En plus des femmes, nous aidons aussi leurs enfants et des adolescents. Nous avons un refuge qui a mis dix ans à obtenir un financement durable. À Ottawa, c'est le seul refuge pour femmes violentées qui est au service des femmes des premières nations, inuites et métisses. De plus en plus de femmes apprennent à survivre et à s'épanouir. Elles s'en tirent bien. Nous leur apprenons également à préconiser la prévention de la violence et l'éducation à ce sujet dans les foyers, à l'école, dans les collectivités et en milieu de travail. Beaucoup d'entre elles prêchent publiquement pour le changement, s'expriment et sont entendues. Il y a cependant beaucoup de chemin à faire encore, car il y a toujours beaucoup de femmes qui souffrent des impacts de la violence; et les hommes, plus particulièrement, tardent à s'engager dans la voie de leur propre guérison.
L'un des meilleurs moyens d'autonomiser les femmes est de les amener à guérir et à trouver leur identité culturelle, puis à suivre une formation et à s'instruire. Beaucoup sont le seul soutien de leur famille et ont besoin de moyens de subsistance durables.
Des organisations autochtones dirigées par des Autochtones peuvent et doivent offrir des solutions réelles et durables au problème de la violence contre les femmes. Notre organisation n'est peut-être qu'un petit élément de l'ensemble, mais je peux vous dire que ce que nous faisons donne des résultats. C'est parce que tout notre travail repose sur une compréhension historique des impacts de la colonisation, de la Loi sur les Indiens et des pensionnats. Nous comprenons les femmes qui demandent notre aide. Nous avons vécu les mêmes expériences, elles nous connaissent et elles nous font confiance. Ces femmes ont internalisé la honte à l'égard de leur identité et de leur culture, ce qui les a jetées dans une vie marquée par la violence, la toxicomanie et la maladie mentale. Elles ont été perdues, coupées de leur esprit, de leur culture, de leur langue, de leur famille, de leur milieu.
Lorsque les femmes autochtones cherchent du soutien et veulent savoir qui elles sont, elles méritent d'être accueillies par des femmes comme elles, qui ont vécu la même réalité et savent comprendre. Il est inacceptable d'envoyer une femme par avion dans une ville loin de chez elle, dans un service gouvernemental bureaucratique qui lui est étranger. On ne peut pas juste leur dire qu'on est désolé. Chaque femme mérite d'être accueillie chez elle et, comme je l'ai déjà dit, j'espère que les femmes autochtones pourront avoir une chance dans la vie. Elles ont besoin d'être respectées, aimées et valorisées dans la société d'aujourd'hui.
Nous pouvons commencer dans la capitale nationale. Je remercie Condition féminine Canada d'avoir été un chef de file dans la marche vers l'égalité et la justice pour les femmes de la base et leur famille. Je dis meegwetch, et merci de m'avoir écoutée.
:
Madame la présidente et mesdames et messieurs les membres du Comité permanent de la condition féminine,
woliwon. Merci de l'occasion qui m'est donnée de présenter un exposé au nom de l'Association nationale des centres d'amitié.
Permettez-moi de saluer d'abord la nation algonquine qui a habité la première le territoire où nous nous trouvons aujourd'hui. Woliwon. Merci de nous accueillir dans votre territoire.
Je m'appelle Conrad Saulis, et je suis directeur de la politique à l'Association nationale des centres d'amitié. Je suis un fier citoyen de la première nation Maliseet, né et élevé dans la collectivité de la Première nation Tobique, au Nouveau-Brunswick.
L'Association nationale des centres d'amitié est une organisation autochtone sans but lucratif qui fait valoir les points de vue et préoccupations de 120 centres d'amitié et de sept associations provinciales et territoriales par tout le Canada. Sa mission est d'améliorer la qualité de vie des peuples autochtones en milieu urbain en appuyant des activités de leur choix qui favorisent un accès égal et la participation à la société canadienne, et qui respectent et renforcent le caractère culturel distinct des Autochtones, sur lequel on insiste davantage.
Avec le ministère du Patrimoine canadien, l'Association nationale des centres d'amitié offre un ensemble de programmes fédéraux prioritaires à la population autochtone urbaine du Canada. À partir du financement de base que nous recevons de Patrimoine canadien, les 120 centres d'amitié disséminés d'un océan à l'autre produisent pour 114 millions de dollars de programmes et services aux Autochtones des villes en partenariat avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les administrations municipales. J'ai fourni une carte qui indique où se trouvent les centres d'amitié au Canada.
Chaque année, nous publions un rapport intitulé L'état du Mouvement des centres d'amitié. Dans notre rapport de 2009, nous affirmons que les centres d'amitié continuent de fournir des programmes aux Autochtones des villes dans les domaines suivants: culture, famille, jeunesse, sports et loisirs, langue, justice, logement, santé, éducation, emploi, développement économique et « divers », catégorie qui englobe des services comme les banques d'alimentation. Dans tout le Canada, les centres offrent un total combiné de 1 295 programmes. En 2009, le mouvement des centres d'amitié employait 2 338 personnes au Canada, dont 74 p. 100 de femmes. Le mouvement est très fier de sa mission de service auprès des Autochtones des villes. Les centres comptent donc le nombre de fois où ils assurent un service. Chaque fois qu'un client profite d'un programme ou d'un service dans un centre d'amitié, on parle d'un point de contact. Au Canada, en 2009, il y a eu près d'un million de points de contact, soit environ 977 000.
En 2007, l'Ontario Federation of Indian Friendship Centres et l'Ontario Native Women's Association ont parrainé un sommet, convoqué à cause des taux élevés persistants de violence contre les femmes autochtones et l'absence de progrès dans la lutte contre cette violence. L'Ontario Native Women's Association et l'OFIFC ont convoqué en 2007 une réunion de stratégie, le « Summit to End Violence Against Aboriginal Women », dont le but était de réunir des dirigeants locaux pour esquisser le cadre d'une stratégie afin de mettre un terme à la violence contre les femmes autochtones. Le sommet était une suite du Forum national sur la politique concernant les femmes autochtones et la violence, dont Condition féminine Canada a été l'hôte en mars 2006, à Ottawa.
Je voudrais rappeler quelques éléments signalés dans le rapport final de ce forum. À cause des agressions physiques et sexuelles et des mauvais traitements psychologiques subis dans les pensionnats beaucoup d'Autochtones ont souffert des séquelles durables de ces mauvais traitements et n'ont pu voir des exemples du rôle constructif de parent, comme le signalait en 1996 la Commission royale sur les peuples autochtones. Ce qui peut être l'un des facteurs qui expliquent le taux plus élevé de violence dans les collectivités autochtones de génération en génération.
Une étude réalisée par l'Ontario Native Women's Association, Breaking Free, a permis de constater que huit femmes autochtones sur dix en Ontario avaient connu une expérience personnelle de violence familiale. Il importe de signaler que, même si toute la violence contre les femmes autochtones ne vient pas de leur milieu, cette violence doit cesser, quels que soient le type et l'origine de cette violence. Les participants ont conclu que, pour atteindre cet objectif, il fallait élaborer, appuyer et promouvoir une stratégie complète et la doter de ressources immédiatement. Toutes les organisations, les gouvernements et la société dans son ensemble n'ont que trop tardé à intervenir pour régler ce problème.
Le cadre est proposé selon le modèle d'une roue médicinale pour présenter un ensemble continu d'approches du problème, et il exigera des stratégies à de nombreux niveaux et autour de différents thèmes si on veut qu'il réussisse à enrayer la violence. Chaque aspect peut être élaboré à part, mais il doit s'intégrer à l'approche globale et s'harmoniser avec elle. Il faudra, pour que l'initiative soit fructueuse, une approche de guérison locale, culturelle et holistique axée sur l'élimination de la violence. Or, cela sera impossible si tous les ordres de gouvernement n'offrent pas des politiques favorables, des mesures législatives, des ressources et des approches propices.
Le rapport récent de l'Association des femmes autochtones du Canada, What Their Stories Tell Us, révèle que non seulement les femmes autochtones affichaient les taux les plus élevés de violence conjugale en 2004, mais aussi qu'elles étaient nettement plus susceptibles que les femmes non autochtones de déclarer les formes les plus graves de violence, menaçant peut-être même leur vie, comme des coups et des étranglements, l'utilisation d'une arme à feu ou d'un couteau contre elles, ou des agressions sexuelles. Ces incidents sont arrivés à 54 p. 100 des femmes autochtones, contre 37 p. 100 chez les non-Autochtones.
Les pourcentages des femmes autochtones violentées sont restés inchangés depuis 1999, comme le révèle l'Enquête sociale générale de 2004. Pour les non-Autochtones, par ailleurs, le pourcentage de celles qui ont connu les pires formes de violence a été ramené de 43 p. 100 en 1999 à 37 p. 100 en 2004.
Le rapport de l'Association des femmes autochtones du Canada ajoute qu'on a constaté que la mobilité, chez les femmes autochtones, surtout lorsqu'elles passent de petites localités à de grands centres urbains, les rend vulnérables à la violence. Beaucoup de jeunes des localités rurales déménagent dans les villes pour faire des études. Des membres des familles et des collectivités, ainsi que d'autres sources clés d'information, ont raconté que les femmes et les jeunes filles qui ont grandi dans des localités rurales et isolées sont souvent mal préparées à la transition vers le milieu urbain.
Les faits recueillis montrent que la majorité des incidents se produisent dans les zones urbaines. Parmi les cas sur lesquels on possède de l'information, près de 60 p. 100 des femmes et des filles ont été tuées en zone urbaine, 28 p. 100 en zone rurale et 13 p. 100 dans les réserves.
Cette répartition est encore plus frappante dans le cas des disparitions. Si on regarde généralement les différents endroits où les femmes et les jeunes filles sont disparues, on constate que 70 p. 100 sont disparues dans une ville, que 22 p. 100 ont été vues pour la dernière fois en zone rurale et que 7 p. 100 sont disparues d'une réserve.
Pour en revenir à l'OFIFC, l'Ontario Federation of Indian Friendship Centres, et...
La présidente: Il vous reste une minute et demie, monsieur Saulis.
M. Conrad Saulis: D'accord.
En 2007, le rapport dit que les collectivités et organisations autochtones ainsi que les organisations et fournisseurs de services de la société majoritaire affirment depuis longtemps que les femmes autochtones subissent des taux de violence beaucoup plus élevés que les autres Ontariennes, et que de nombreux facteurs convergents liés à ces niveaux de violence sont propres aux femmes autochtones parce qu'ils sont directement liés à des éléments historiques qui subsistent, comme le colonialisme, les séquelles des pensionnats, les dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens, la non-reconnaissance de l'identité métisse et les effets résiduels des traumatismes collectifs comme la maladie mentale et la pauvreté.
Je vais devoir sauter quelques pages et en arriver à mes conclusions.
Nous pouvons continuer à échanger de l'information sur les statistiques alarmantes de la violence contre les femmes et les jeunes filles autochtones au Canada, mais il faut arrêter de parler, à un moment donné, et mettre des mesures en place, agir et travailler sérieusement pour faire beaucoup diminuer toutes les formes de violence contre elles.
L'ANCA appuie sans réserve le travail en cours de l'Association des femmes autochtones du Canada et plus particulièrement de l'initiative Soeurs par l'esprit.
J'espère qu'on accordera une attention sérieuse à la proposition de cadre qui a découlé du sommet de 2007 de l'Ontario Federation of Indian Friendship Centres et de l'Ontario Native Women's Association.
Le Mouvement des centres d'amitié demeure un partenaire bien disposé et compétent dans tous les efforts visant à combattre, à prévenir et à faire diminuer la violence contre les femmes et les jeunes filles autochtones.
Merci. Woliwon.
:
Merci, madame la présidente.
Je remercie tous les témoins d'avoir pris le temps de comparaître aujourd'hui. Vos exposés ont été extrêmement intéressants, mais tristes.
J'adresse mes premières questions à Mme Mann.
J'ai eu l'occasion de lire le rapport de 2005 rédigé pour Condition féminine Canada, Les femmes autochtones : un document d’information sur les problèmes. Il ne s'agit pas spécialement du problème de la prostitution pour l'instant, mais j'ai été très intéressé par vos observations sous la rubrique « Les biens immobiliers matrimoniaux situés dans les réserves ». Je suis plutôt d'accord pour dire que, lorsqu'il y a de la violence en milieu familial, il n'y a aucun choix. S'il y a rupture d'un mariage ou d'une relation, il n'y a bien souvent aucune disposition prévoyant le partage de la maison familiale. Très souvent, les femmes restent dans des situations d'une grande violence parce qu'elles ne peuvent pas se loger ailleurs.
J'espère que vous pourrez nous éclairer à ce sujet. Le projet de loi sur les biens immobiliers matrimoniaux, le S-4, chemine au Sénat. À première vue, ce projet de loi un peu long semble s'attaquer au problème. Chose curieuse, lorsqu'on discute avec des collègues et certains autochtones, il ne semble pas jouir d'autant d'appuis que je l'aurais supposé de la part des Autochtones. En tout cas, ils ne sont pas tous enthousiastes.
Avez-vous eu des réactions à ce sujet? Pouvez-vous donner de l'information ou des aperçus au comité au sujet des lacunes du projet de loi? Pourquoi n'arrive-t-il pas à faire ce que les collectivités autochtones souhaiteraient peut-être?
:
Plusieurs choses. D'abord, lorsqu'une jeune femme ou une adolescente, peut-être avec un ou deux enfants, arrive d'une localité des premières nations, d'une localité métisse ou inuite dans une ville comme Ottawa, Vancouver ou Montréal, par exemple, il y a un choc culturel, comme Irene l'a dit. Elle n'est pas préparée et ne sait pas où aller.
Heureusement, il y a au moins 120 centres d'amitié dont les femmes sont probablement au courant et où elles peuvent obtenir de l'aide et des conseils. Toutefois, il arrive souvent qu'elles ne soient pas au courant et elles se retrouvent dans la rue. Michelle en a parlé. Elles ne se mêlent pas aux bonnes personnes. Elles tombent dans la prostitution, les drogues et le commerce du sexe. Au bout du compte, elles deviennent victimes.
Ce n'est pas ce qu'elles veulent et ce n'est pas leur faute. Bien des fois, au départ, elles fuient probablement le même genre de violence chez elles. Elles veulent s'éloigner de cela et pensent que la ville sera un refuge. Hélas, elles s'aperçoivent que ce n'est pas nécessairement le cas.
Malheureusement ou heureusement, selon le point de vue, nous savons... Nous avons assisté au Forum urbain mondial en mars et nous avons appris que l'urbanisation progresse dans le monde entier, et pas seulement au Canada. On déménage plus nombreux en ville, pour diverses raisons. C'est la même chose pour les Autochtones du Canada. Les statistiques le montrent: de 2001 à 2006, nous sommes passés de 49 à 54 p. 100.
L'autre problème est celui du partage des compétences entre le gouvernement fédéral et les provinces. Il faut s'entendre. La semaine dernière, au Forum permanent des peuples autochtones de l'ONU, le représentant du gouvernement du Canada a dit que le Canada consacrait 10 milliards de dollars aux programmes destinés aux Autochtones. Nous pouvons vous dire, et vous le savez aussi bien que moi, où va la grosse part de cet argent. Et il ne sert pas à aider les Autochtones des villes.
Je ne veux pas opposer différents groupes, car les problèmes des collectivités des réserves et des collectivités métisses sont très graves et très importants pour ceux qui y vivent. L'attention des autorités fédérales et provinciales, qu'il s'agisse des politiques, des programmes ou des engagements...
Désolé, je suis peut-être trop long. Excusez-moi d'avoir parlé trop longtemps.
:
Merci, madame la présidente.
Je vous remercie d'être présents aujourd'hui.
Madame Compton, votre histoire est très triste et choquante à la fois, mais vous êtes un symbole de résilience et d'espoir pour toutes les femmes. Merci beaucoup de partager votre histoire avec nous. Je pense que vous devriez en faire part à un public plus large afin que les gens comprennent que les femmes autochtones sont des femmes au même titre que toutes les autres, au Québec et au Canada.
Madame Mann, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer il y a quelques années dans le cadre du sous-comité portant sur la prostitution. Vous y participiez également. Je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements au cours des dernières années. Vous ne parlez pas de décriminaliser la prostitution, mais bien la prostituée. Vous voulez vous assurer qu'elle n'est pas stigmatisée, qu'elle n'est pas nécessairement emprisonnée et qu'elle n'a pas à vivre ce cycle infernal qui consiste à aller en prison, en sortir puis recommencer la même chose. On a vu que dans les pays où la décriminalisation de la prostituée et la criminalisation des clients avaient été instituées, les femmes qui exerçaient ce métier vivaient des problèmes plus sérieux encore.
Je me demande comment il serait possible d'assurer que les femmes aux prises avec des situations risquées, très dangereuses, puissent aller à des endroits comme les Centres d'amitié ou le refuge que vous dirigez, madame Compton. Vous receviez de l'argent de l'Aboriginal Healing Foundation, mais cet argent a été transféré au ministère de la Santé. Est-ce que vous avez fait une demande de subvention à ce ministère, de façon à pouvoir continuer les programmes que vous réalisiez dans le cadre de la fondation? On nous a dit que l'argent se trouvait au ministère de la Santé. Vous pourriez peut-être avoir accès à ces fonds.
J'aimerais aussi savoir ce que représente votre plume.