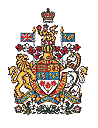:
Permettez-moi d'abord de remercier le comité de m'avoir invité à prendre la parole devant lui.
Je veux aussi prendre un moment pour mentionner l'aide que les Instituts canadiens de recherche en santé, IRSC, m'ont apportée, non seulement à titre personnel, mais aussi pour mon programme de recherche. Je dois vous dire bien honnêtement que, sans les IRSC, des universitaires comme moi ne pourraient pas participer à ce genre de rencontre.
Je tiens aussi à remercier le Fonds du Commonwealth, qui a son siège aux États-Unis, pour m'avoir versé une subvention afin de me permettre d'étudier le Programme commun d'évaluation des médicaments dans un contexte international afin de permettre au Canada et aux États-Unis de tirer les enseignements qui s'imposent, ce qui prouve la notoriété de ce programme.
Avant, justement, de vous parler du contexte international, je me propose de répondre rapidement à la question de savoir pourquoi il convient de soumettre les médicaments à un examen.
Comme je suis économiste de formation, j'appréhende sans doute le marché d'une façon très différente de celle des analystes en politique de la santé. Commençons par ce qu'on pourrait considérer comme étant le concept de « discipline de marché ».
Il est ici question de recourir au marché pour déterminer la valeur que celui-ci accorde aux produits proposés. Pour cela, il faut que le consommateur soit très au fait de ses propres exigences et besoins; il doit évaluer avec justesse la capacité des produits de répondre à ses exigences et besoins; il doit disposer de différents moyens de rechange pour répondre à ces mêmes besoins et exigences, notamment la possibilité de ne pas consommer le produit proposé; enfin, il doit acquitter le coût total de tous ses achats. Dans ces circonstances, comme vous pourrez le constater dans la plupart des centres commerciaux, les consommateurs jugent en fonction d'un rapport qualité-prix et sont disposés à payer en conséquence.
Cependant, la réalité est différente dans le secteur pharmaceutique. Les médicaments ne sont pas des « produits de consommation », ils sont plutôt un élément de soin. Dans ce secteur, l'objet réel n'est pas d'acheter des cachets ou des pilules. Que vous soyez patient ou administrateur d'un régime d'assurance-médicament, votre but est d'acheter des résultats en santé.
Si vous devez améliorer votre état de santé, il est fort probable que vous soyez vulnérable, du moins dans certaines circonstances. Cela étant, en qualité de consommateur, vous n'aurez pas forcément ni le temps ni la capacité d'évaluer et de soupeser toutes les options susceptibles de répondre à vos besoins.
Il est en fait difficile de démontrer les effets des différentes options de traitement. Il est difficile de décider si c'est la nature, un placebo ou le médicament en question qui est responsable des changements constatés dans l'état de santé d'un patient ou de la population en général. C'est pour cela qu'il faut entreprendre des essais cliniques de grande envergure. D'ailleurs, comme jamais aucun essai de ce genre n'apporte de réponse absolue, nous avons tendance à préférer les méta-analyses dans bien des cas, portant sur des milliers de patients. C'est ce que l'on appelle l'évaluation des technologies de la santé.
L'autre caractéristique unique du secteur pharmaceutique tient au fait que les patients ne paient pas. Loin de moi l'idée de condamner les compagnies d'assurance privées ou les régimes d'assurance publics, mais force est de reconnaître que, quand ils optent pour un traitement afin de répondre à un besoin particulier, les patients ne sont pas aussi sensibles au prix des thérapies que les consommateurs sur un marché normal. À l'instar des patients, les médecins peuvent ne pas être sensibles au prix, même s'ils sont bien renseignés, puisqu'ils règlent rarement la note des médicaments sur ordonnance.
Quelles sont les conséquences de tout cela? Eh bien, d'un point de vue économique, les produits pharmaceutiques et ceux qui les consomment ne sont pas « normalisés ». J'irai jusqu'à dire que le rapport qualité-prix constitue la plus grande déficience du marché dans ce secteur. La seconde grande déficience tient à l'absence de stimulants financiers qui pourraient pousser les gens à se renseigner sur le rapport qualité-prix.
Je vais sauter la question des dépenses au Canada dans le cas des médicaments classifiés suivant le Règlement du CEPMP, mais je serai heureux de répondre à vos éventuelles questions à ce sujet.
Passons à l'augmentation du nombre de processus d'examen des médicaments destinés à corriger les imperfections du marché quant aux informations relatives au rapport qualité-prix, phénomène constaté de par le monde. Pourquoi soumettre les médicaments à un examen?
Tout d'abord, tout le monde reconnaît que les médicaments ne sont pas des produits standardisés, mais des éléments de soin. L'homologation, nécessaire à la mise en marché d'un médicament, vise des fins différentes de celles des programmes d'assurance-médicament. Les politiques d'achat de médicaments doivent s'appuyer sur des données comparatives et des données économiques. Comme la science est extraordinairement complexe, elle exige que chaque pays se dote des moyens et des connaissances nécessaires pour être en mesure d'évaluer la technologie.
Je pense qu'il s'agit-là d'une des raisons pour lesquelles les pays ont opté pour des procédures centralisées d'évaluation des médicaments.
S'agissant de l'objectif global poursuivi, je dirai qu'il est surtout question de rechercher l'efficacité économique et de favoriser la prise de décision étant donné que les budgets publics et privés sont limités. Les ressources ne sont pas infinies. Cela étant, il faut pouvoir s'appuyer sur des données de base et sur le bon sens économique afin de prendre de bonnes décisions sur la façon d'affecter les ressources limitées.
Voici les informations dont nous avons besoin. Par exemple, il y a lieu de se demander si un nouveau produit est moins efficace, aussi efficace ou plus efficace qu'un produit de référence. Est-il moins coûteux, aussi coûteux ou plus coûteux qu'un produit de référence? À partir de ces trois éléments d'information en abscisse et en ordonnée, on peut prendre des décisions éclairées dans le cadre des programmes commun d'évaluation des médicaments.
Dans certains cas, la décision s'impose d'elle-même. On rejettera par exemple un médicament moins efficace et plus coûteux qu'un médicament de substitution, puisque personne ne l'utilisera. D'autres décisions exigeront d'abord un dialogue avec le public et les organismes payeurs pour décider si un médicament, par exemple plus efficace, mais aussi plus coûteux, vaut la différence de prix pour un budget public ou privé. D'autres décisions exigeront une négociation entre les acheteurs et les fournisseurs, comme dans le cas des médicaments dont l'efficacité est comparable aux médicaments de substitution et qui sont tout aussi coûteux.
Dans l'étude que nous avons réalisée pour le compte du Commonwealth Fund des États-Unis, nous avons examiné le processus commun d'évaluation des médicaments, en vigueur au Canada, et le processus d'examen centralisé en vigueur au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous avons aussi étudié l'un des processus en vigueur aux États-Unis.
Je vais rapidement vous parler des cas concernant le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il convient, d'entrée de jeu, de remarquer que les processus d'examen sont extraordinairement complexes. Il est certainement très délicat d'évaluer des produits pour contribuer à des décisions éclairées en matière de couverture.
Il existe quelques points communs entre ces différents processus, le premier étant qu'ils sont différents de l'octroi des licences. Les objectifs poursuivis dans le cas de l'octroi des licences sont différents de ceux des processus destinés à renseigner les programmes d'assurance.
Deuxièmement, tous ces processus impliquent l'évaluation clinique de la preuve, sous une forme ou une autre, de même que l'évaluation des données économiques.
Troisièmement, il s'agit, dans tous les cas, d'effectuer des évaluations centralisées, c'est-à-dire relevant d'un comité d'experts chargé de déterminer l'importance des données scientifiques et économiques au regard des décisions à prendre pour une région ou un pays donné.
L'une des différences que nous avons relevé entre les pays étudiés concerne la prise de décision — ou plus encore, le contexte de financement dans lequel les décisions sont prises.
En Australie, les examens sont effectués par le Pharmaceutical Benefits Advisory Committee, autrement appelé PBAC, qui administre un mécanisme d'examen central pour le formulaire national.
En Australie, il existe un régime d'assurance-médicaments national reposant sur un formulaire national. Chaque médicament doit faire l'objet d'un examen centralisé et le ministre ne peut d'ailleurs pas verser de nouveau médicament sur le formulaire national sans une recommandation du PBAC.
Il s'agit d'un processus pragmatique portant sur un cycle d'examen de 17 semaines qui permet d'étudier une centaine de médicaments par année, médicaments génériques y compris. Les motifs des décisions sont publiés sur Internet et rendus publics par le biais de ces mécanismes, de même que par des consultations publiques à différentes étapes de l'examen.
Les prix en contexte australien sont négociés dans le cadre de ce processus d'examen. Après recommandation par le PBAC, le gouvernement et le fournisseur entreprennent la négociation du prix.
La Nouvelle-Zélande offre une couverture universelle assortie d'un formulaire national administré par un organisme de gestion centralisé, PHARMAC. L'examen central est effectué par le Pharmacology and Therapeutics Advisory Committee, PTAC, en vertu du processus d'assurance-médicament en vigueur en Nouvelle-Zélande, mais PHARMAC peut décider d'inscrire des médicaments sur la liste à l'encontre de recommandations du PTAC, notamment parce que les décisions d'inscription dépendent de la négociation des prix.
Le processus en vigueur en Nouvelle-Zélande est pragmatique en ce sens que l'organisation examine 30 à 40 médicaments par an. Les informations sont choisies sur Internet. Comme nous l'avons vu, la négociation du prix fait partie intégrante du processus.
En Angleterre et au Pays de Galles, c'est le National Institute for Health and Clinical Excellence, autrement connu sous le vocable de NICE, qui effectue une partie des évaluations dans le contexte d'une couverture universelle pour les médicaments, mais selon un formulaire dit « négatif » unique au Royaume-Uni. Apparemment, tous les produits en vente au Royaume-Uni sont admissibles à la couverture publique et il incombe aux décideurs régionaux de décider implicitement de limiter les produits qui ne seront pas homologués dans tel ou tel contexte.
C'est donc dans ce contexte que NICE en est venu à administrer un processus très sélectif. Seuls les médicaments jugés problématiques ou susceptibles d'avoir d'importantes répercussions sur le système de santé sont examinés et évalués de façon centralisée par NICE. Cela étant, NICE n'examine que 11 médicaments environ par an et le processus mis en oeuvre est très complexe, puisqu'il comprend de nombreuses étapes de consultation et de négociation avec les intervenants, ce qui peut prendre un an, voire plus par examen.
Les lignes directrices émises par NICE à l'échelon national deviennent obligatoires à l'échelon régional. Il n'y a pas de négociation de prix dans le cadre des systèmes en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles.
Au Canada, le système que vous connaissez bien, comprend une couverture mixte et une multitude de formulaires administrés par des régimes publics, privés, fédéraux et provinciaux. L'examen commun des médicaments est exigé par la plupart des régimes publics, sauf au Québec, mais les décisions demeurent centralisées. Dans le système canadien, un « oui » et un « non » peuvent aussi bien dire « peut-être ».
À l'origine, l'accent portait sur les produits chimiques et la combinaison de ces produits, sans doute pour des raisons budgétaires, ne serait-ce que pour faire en sorte que le processus demeure pragmatique dans un premier temps.
Il s'agit donc d'un processus pragmatique qui consiste à cibler quelque 25 médicaments par an. Des résumés des motifs sont affichés sur Internet et, comme vous le savez, des représentants de la population siègent maintenant au comité consultatif expert. Le Canada et le Royaume-Uni sont des exceptions parce que le PCE ne fait pas intervenir la négociation des prix. Il s'agit simplement d'une évaluation du prix estimé ou affiché par le fabricant.
Pour ce qui est de l'expérience internationale, j'ai eu la chance d'interviewer des décideurs dans tous les pays étudiés et de les rencontrer personnellement lors d'une réunion que j'avais organisée à Vancouver, l'année dernière, puis à Wellington, en Nouvelle-Zélande, en mars dernier, où nous avons pu discuter des défis auxquels se heurtent les processus communs d'évaluation des médicaments partout dans le monde.
Je m'avancerai à dire — et je le fais de façon objective, parce que je ne travaille pas et je n'ai jamais travaillé pour le PCEM — que ce processus a rapidement acquis une réputation internationale auprès d'organismes identiques. J'irai jusqu'à dire qu'il est sans doute sous-financé, mais nous pourrons en reparler plus tard.
Le PCE et les autres programmes semblables se heurtent à des difficultés communes, l'une tenant au fait que les médicaments sont approuvés pour la vente par comparaison avec des marqueurs de substitution qui en déterminent l'efficacité; autrement dit, ils sont efficaces dans leur action sur les structures ou les systèmes biologiques de l'organisme, mais nous ne savons pas encore s'ils vont donner des résultats probants sur le plan de la santé générale du patient. C'est un problème que l'on rencontre partout dans le monde.
Les programmes communs d'examen pêchent à cause d'essais mal conçus. En particulier, la plupart des essais portent sur une relation entre la placebo et le médicament plutôt que sur des comparaisons entre médicaments, données dont nous devrions pourtant disposer pour prendre des décisions économiques rationnelles. Il faut se demander si le médicament proposé est meilleur que ses substituts.
Il y a de graves problèmes de transparence et de confidentialité en ce sens que les programmes communs d'évaluation sont limités à ce qu'ils peuvent publiquement déclarer au sujet des données utilisées pour la prise de décision, ce qui n'est pas uniquement le cas au Canada, mais bien partout dans le monde.
Enfin, il existe un véritable risque de prescription à des fins inappropriées. Les fabricants prétendent, souvent à juste titre, que leurs produits sont rentables pour certains segments de la population. Toutefois, quand les produits se retrouvent sur le marché, il est souvent difficile d'empêcher qu'ils soient utilisés à des fins pour lesquelles il existe des traitements plus appropriés ou des traitements de remplacement plus rentables.
Pour conclure, je dirai que le PCEM est respecté et que des programmes du genre sont nécessaires parce qu'ils peuvent permettre d'inciter, voire d'obliger les fabricants à divulguer le genre de preuves dont nous avons besoin pour adopter une politique rationnelle en matière de médicaments.
Merci.
:
Elle n'avait guère le choix, puisqu'il se trouve que je suis son supérieur.
Je tiens cependant à lui rendre officiellement hommage, puisque c'est elle qui a réalisé le gros de ce travail et qu'elle n'a malheureusement pas pu se rendre à cette invitation. J'espère donc pouvoir contribuer utilement à vos délibérations et à vos décisions, puisque vous en êtes presque au terme de vos travaux.
Je vais brièvement vous situer en contexte le travail auquel nous avons participé, afin que vous compreniez ce dont il retourne.
Ces dernières années, nous avons réalisé plusieurs projets de recherche financés par des organismes comme les IRSC, dont M. Morgan vous a parlé, sur les différences constatées dans les formulaires utilisés d'une province à l'autre — différences en matière d'accès à des médicaments de traitement du cancer en particulier — et nous avons examiné des modèles utilisés ailleurs dans le monde dans le cas des programmes de couverture des médicaments onéreux, ainsi que la façon dont les données économiques sont ou pourraient être utilisées dans la prise de décision concernant des médicaments.
L'intérêt, dans le cas qui nous préoccupe — et je suppose que c'est la raison pour laquelle je suis ici — réside dans une partie du travail que nous avons réalisé sur ce que j'appelle les processus centralisés d'examen des médicaments actuellement en vigueur dans le monde. M. Morgan vous a déjà donné des précisions en ce qui concerne trois pays auxquels nous nous sommes aussi intéressés. Je vais, pour ma part, essayer de me limiter à cette dimension, puisque nous traitons de la situation dans le monde. D'ailleurs, je vais débuter par cela.
Il y a deux ou trois ans, nous nous étions fixé pour objectif de recenser les modèles d'examen centralisé en vigueur dans le monde. En universitaires originaux que nous étions, nous pensions pouvoir apporter notre pierre à l'édifice en entreprenant ce travail à l'heure où d'autres étaient en train de concevoir un système commun d'examen des médicaments au Canada. Il aura fallu toutefois attendre un certain temps avant que qui que ce soit s'intéresse à nos travaux.
Nous avons examiné des aspects comme les cadres de gestion, la gouvernance ainsi que les processus d'examen et les mécanismes d'appel éventuels. Dans la mesure du possible, nous avons comparé entre eux certains aspects communs des processus d'examen. Nous n'avons pas examiné des choses comme le délai jusqu'à la couverture, les délais d'approbation ni le nombre de médicaments examinés par pays. D'autres l'ont fait; M. Morgan a travaillé dans ce domaine. Ce n'était donc pas l'objet de notre recherche.
À l'époque, nous avions constaté que 16 pays environ ayant des systèmes de santé essentiellement publics administraient ce qu'on pourrait baptiser de systèmes centralisés d'examen des médicaments: l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, l'Afrique du Sud, la Suède et le Royaume-Uni. Nous avons constaté l'existence de différentes approches et de différents modèles en fonction des différentes structures de soins de santé. Certains de ces systèmes étaient en place depuis relativement longtemps, tandis que d'autres étaient nouveaux.
Je vais faire un survol de ce que nous avons constaté.
En ce qui concerne la structure, la gouvernance et le rôle, il existe différents modèles d'organisation dans différents pays destinés à gérer le processus commun d'examen des médicaments: cela va des organismes gouvernementaux relevant d'un ministère à des organisations autonomes. Il existe donc toute une diversité de modèles.
Dans sept des 16 pays, l'organisme équivalent au CCCEM — le Comité consultatif canadien d'expertise sur les médicaments, qui est le comité de révision du PCEM — formule des recommandations en matière de remboursement, de couverture et d'homologation des médicaments. Dans sept autres pays, l'organisme central est investi d'un rôle de réglementation et il tranche sur le sort à réserver aux médicaments, sous l'angle de la couverture. En Norvège, l'organisme peut agir sur les deux plans en fonction de la nature de la demande de remboursement. Comme certains fixent le niveau de remboursement, la tarification intervient forcément dans le processus, ce qui n'est pas le cas chez nous. Certains organismes nationaux s'intéressent à d'autres aspects, comme les lignes directrices concernant l'usage maximum, les indications de prescription et des choses du genre.
Ces organismes de type CCCEM, si on peut les appeler ainsi, sont habituellement composés: de médecins, généralistes et spécialistes; d'économistes en santé; de pharmaciens; de pharmacologistes cliniciens et de représentants des ministères et organismes gouvernementaux, de même que des caisses d'assurance-maladie, dans certains cas. En Nouvelle-Zélande, le conseil est essentiellement composé de médecins et de pharmacologistes cliniques. Cet aspect n'a rien de théorique, parce que l'essentiel du processus repose sur la structure et les membres des organismes décideurs, et sur la représentation au comité. Nous tenions donc à examiner cet aspect.
En Australie, en Suède et au Royaume-Uni — au Royaume-Unis, l'organisme s'appelle NICE, comme on vous l'a dit — le comité d'examen comprend aussi des représentants de la population, qu'il s'agisse de simples citoyens ou contribuables ou encore de représentants de patients.
Le nombre de membres siégeant à ces comités varie de quelques-uns, comme six en Grèce, à 60 au Royaume-Uni. Dans ce dernier pays, on retrouve aussi des épidémiologistes et d'autres méthodologistes et l'on peut même dire que le comité représente tous les secteurs concernés par le processus.
Les critères de couverture varient aussi d'un pays à l'autre, selon le système en vigueur. Comme M. Morgan y a fait allusion tout à l'heure, on retrouve parmi les critères la valeur thérapeutique des médicaments qui s'entend notamment de l'utilité et de l'efficacité clinique du produit examiné et de l'existence éventuelle d'un traitement permettant déjà de soigner l'état sous-jacent considéré. La gravité de l'état pathologique, le caractère commun des besoins constatés et les répercussions éventuelles sur la santé publique sont d'autres critères examinés par ces organismes. On ne sait pas exactement, d'après les documents publics, quel poids relatif est accordé à chacun d'eux. La pondération pourrait être un élément clé de la combinaison des critères.
Ces dernières années, on a constaté dans la plupart des examens centralisés, un net regain d'intérêt pour la rentabilité des médicaments. Soit dit en passant, le Canada est un chef de file dans cette question de la rentabilité, c'est-à-dire pour ce qui est de l'utilisation des méthodes rentables et de l'élaboration de méthodes également rentables pour la prise de décision dans le cadre de programmes de soins de santé en général et pas uniquement pour le choix de médicaments. Dans certains pays, on ne retient que le prix. En revanche, d'autres excluent complètement cette dimension de l'analyse.
En outre, des organismes examinent les répercussions sur les budgets, ce qui peut être différent de la notion de rentabilité. La rentabilité consiste essentiellement à comparer deux éléments entre eux. Dans certains pays, du moins dans deux d'entre eux, l'un des critères est l'automédication, la priorité n'étant alors pas accordée à des médicaments dispensés en milieu hospitalier. D'autres pays examinent la question sous l'angle de la congruence aux priorités gouvernementales et au taux potentiel de mauvaises utilisations.
Voilà donc pour les critères en général. Les données à évaluer au regard de ces critères, le plus souvent grâce à des essais contrôlés dont M. Morgan vous a parlé, sont obtenues grâce à des études comparatives portant sur d'autres thérapies, ce qu'il convient de rappeler, mais M. Morgan l'a déjà fait.
La question est donc de savoir pourquoi quelqu'un d'autre que Santé Canada doit faire un second examen après celui du ministère? Personnellement, j'estime que les objectifs poursuivis par ces examens sont différents. Même les exigences concernant les données sont différentes. Le ministère s'appuie sur des essais cliniques, parfois très importants où l'on utilise souvent des placebos comme comparateurs, mais pour les décisions relatives au remboursement des médicaments, Santé Canada fait une comparaison avec des produits de référence. À ce stade, le ministère peut ne pas disposer de données d'essai, ce qui constitue généralement un défi dans le cas des examens communs de médicament.
La pathologie, l'incidence de la maladie, le fardeau qu'elle représente pour la société et les répercussions éventuelles sur la santé publique sont autant d'éléments d'information retenus à l'étape de l'analyse. Comme je le disais, 13 des 16 pays recommandent fortement d'effectuer des évaluations économiques. De plus, les fabricants sont souvent invités à fournir des évaluations du volume prévu afin de permettre la préparation de budgets en conséquence.
Je crois que M. Morgan vous a parlé des étapes de l'évaluation et de l'estimation du processus. L'évaluation consiste à examiner les données et l'estimation de l'information consiste à porter un jugement, ce que fait un autre organisme.
Qui s'occupe de tout cela dans les différents pays étudiés? Ça dépend. Qui peut soumettre des demandes? Eh bien, dans la plupart des pays, c'est le fabricant ou l'organisme d'approbation de la commercialisation, c'est-à-dire l'organisme chargé d'approuver les fins commerciales, qui s'en charge.
En Australie, un organisme médical, un professionnel de la santé ou même un particulier peut demander un examen, mais je ne sais pas exactement comment les priorités sont établies dans ce cas.
On note également des différences dans la façon dont les informations sont regroupées, à quel moment elles le sont et ainsi de suite.
Enfin, il y a des différences quant à la tenue de consultations officielles auprès d'autres groupes pendant ce processus.
S'agissant des appels, véritable pomme de discorde entre certains secteurs, nous avons constaté qu'il n'existe de mécanisme d'appel des décisions qu'en France et au Royaume-Uni. Toutefois, cela peut avoir changé. Ces deux dernières années, tous les organismes ont fait l'objet d'intenses pressions pour ouvrir le processus et permettre à plus de gens d'y participer.
Je conclurai par cinq remarques que je juge pertinentes à la situation canadienne.
Tout d'abord, la plupart des pays administrent des processus d'examen semblables à ceux de Santé Canada, en plus d'un examen de la couverture. Dans la plupart des 16 pays étudiés, à l'exception du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, c'est le même organisme qui traite des deux aspects, contrairement à ce qui se fait chez nous où nous avons réparti certaines fonctions concernant divers aspects des thérapies médicamenteuses entre le CEPMB, Santé Canada et les provinces. Dans certains pays, on ne constate pas une telle division, les choses ayant évolué de pair.
Deuxièmement, aucun de ces pays ne fait d'examen à des échelons inférieurs parce que les décisions prises par le PCE, ou les recommandations adressées au ministre ou au comité ministériel, constituent le fondement des mesures prises par la suite. Il n'y a donc pas de second échelon où l'on décide de débloquer des fonds pour les médicaments homologués. Cette façon de faire explique la différence qu'il peut y avoir dans les délais d'homologation.
Troisièmement, les décisions relatives à la couverture prise par ces différents organismes couvrent un vaste éventail, notamment pour ce que je viens juste de vous expliquer quant aux rôles mixtes que l'on retrouve dans ces pays. Dans certains cas, l'organisme fixe le niveau de remboursement. Il peut décider d'autoriser le médicament à hauteur de 65 p. 100 du niveau prescrit. Au Canada, ce sont les provinces qui s'en chargent, souvent dans le cadre de négociations avec les fabricants.
Il y a une chose à laquelle j'invite le comité à réfléchir. Il a beaucoup été question d'élargir le niveau de participation au processus commun d'examen des drogues. Au Royaume-Uni, par exemple, un jury de citoyens conseille NICE. Je crois qu'il existe la même chose en Nouvelle-Zélande où il y a un comité consultatif de consommateurs. Les gens, un peu partout, essaient différentes façons de passer d'un processus technique, scientifique et clinique à un processus plus ouvert pouvant illustrer quelque chose pour les gens. C'est difficile et les gens essaient différentes choses, mais ce qui est bien, c'est que le PCE est à présent une dimension publique puisque des représentants y siègent. Je vous invite donc à tenir des réunions publiques, un peu comme vous le faites avec celle-ci.
Enfin, il y a un aspect qui peut être délicat pour certains gouvernements provinciaux. Quand nous avons examiné les organismes appliquant un PCE, nous avons constaté que certains d'entre eux peuvent recommander la radiation. Dans ce cas, ils examinent les médicaments déjà offerts et, s'ils veulent en ajouter un, ils peuvent recommander la radiation d'un médicament précédemment homologué.
Une partie du problème tient au fait que, quand les gens s'inquiètent de l'augmentation des dépenses de médicament, ce n'est certainement pas parce qu'ils ont peur que le plancher s'effondre. Il faut se poser la question non seulement au sujet des médicaments, mais aussi au sujet des technologies de la santé: quelle technologie ou quel médicament remplacé justifierait un retrait de financement? Je crois qu'il serait utile de se demander au moins comment on pourrait aborder la chose sous l'angle de l'examen commun des médicaments.
Merci, monsieur le président.
:
— des médicaments en Colombie-Britannique était attribuable à l'introduction de nouveautés ou de nouvelles indications qui n'apportent rien ou qui apportent peu sur le plan thérapeutique. Ces produits, qu'on appelle des
me-too, sont des molécules équivalentes à celles qui existent déjà sur le marché. Ces nouvelles indications sont souvent d'une efficience non validée sur le terrain. La consommation de ces nouveautés qui ont remplacé les anciens produits a fait doubler les dépenses en médicaments en Colombie-Britannique entre 1996 et 2003.
D'après le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, entre 1990 et 2003, seulement 5,9 p. 100 de ces nouveautés représentaient une percée sur le plan thérapeutique. C'est là que le bât blesse. Dans la même veine, la FDA signalait que les trois quarts des médicaments qui ont été mis sur le marché dans les années 1990 n'apportaient rien de neuf par rapport aux anciens traitements.
Ce qui précède montre l'importance d'une évaluation rigoureuse des médicaments qui doivent figurer sur les formulaires des provinces, c'est-à-dire une évaluation probante et pertinente réalisée par des experts indépendants. Une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association, portant sur 1 140 essais cliniques, indiquait que les essais financés par l'industrie étaient 3,6 fois plus susceptibles de résulter en des conclusions favorables au produit du commanditaire. Ce sont ces études qui sont soumises pour approbation aux agences de contrôle.
À titre d'exemple, soulignons les nouveaux anti-hypertenseurs proposés en première ligne, qui ne sont pas plus utiles pour la vaste majorité des patients que les anciens traitements, mais qui sont des dizaines de fois plus chers. Le Dr Furberg, chercheur principal d'une vaste étude sur les anti-hypertenseurs, a calculé que les consommateurs américains ont déboursé de 8 à 10 milliards de dollars inutilement en utilisant ces nouveautés.
M. Robert Goyer, ancien président du Conseil du médicament du Québec, évaluait que l'anti-ulcéreux le plus populaire et le plus cher a coûté 60 millions de dollars de trop, car des solutions de rechange moins coûteuses existaient et faisaient aussi bien l'affaire dans la plupart des cas.
Sur un autre plan, la Croix-Verte signalait l'existence de disparités importantes dans les prix des médicaments payés par diverses agences gouvernementales. Un médicament sur le formulaire de l'Ontario était inscrit au prix de 1,90 $ et le même produit était vendu au ministère de la Défense pour 45 ¢. La différence est du simple au quadruple.
La Nouvelle-Zélande nous indique une voie à suivre pour l'utilisation optimale des médicaments. En 1973, ce pays mettait sur pied une société publique, Pharmac, composée de scientifiques indépendants et de groupes de patients. Pharmac est un pôle d'achat groupé de médicaments qui a la capacité de négocier des prix. Elle procède par appel d'offres auprès des fabricants, qu'elle met en concurrence les uns avec les autres.
Pharmac établit la liste des meilleurs médicaments à partir de critères scientifiques. Elle choisit celui qui constituera le produit de référence et elle sélectionne un certain nombre d'alternatives qui sont remboursées au prix du produit de référence le meilleur marché, sauf en cas d'intolérance ou de contre-indications. Des accords nommés cross-deals sont négociés avec les fabricants. Quand un nouveau produit efficace et sécuritaire arrive sur le marché, il est inscrit sur le formulaire, à condition que le fabricant consente un rabais sur un produit qui figure déjà sur la liste. Pharmac pratique également le système des dépenses maximales. Un contrat est conclu avec un fabricant en vue de la vente et du remboursement d'une certaine quantité de médicaments à partir d'une analyse des besoins. Si les dépenses excèdent ce maximum, la firme rembourse la différence à Pharmac. Finalement, les produits qui n'ont pas démontré leur supériorité sur les traitements existants ne sont pas remboursés. C'était le cas du Celebrex et du Vioxx avant qu'ils ne soient retirés du marché pour cause de toxicité cardiovasculaire. Soit dit en passant, le Vioxx a gagné le prix Galien en 1999, si je ne m'abuse, qui est ni plus ni moins l'Oscar du médicament. C'est ainsi que le formulaire de Nouvelle-Zélande comprend 2 600 produits, contre 5 000 au Québec.
Permettez-moi d'aborder un sujet connexe, mais dans le droit fil de ce qui précède. L'évaluation des médicaments commence bien avant que les autorités s'interrogent sur l'opportunité de les inscrire sur les formulaires, à savoir dès qu'ils sont soumis à la Direction des produits thérapeutiques. Sur ce plan, nous devrions souhaiter que des améliorations soient apportées à l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité des médicaments.
Les critères d'homologation de Santé Canada sont-ils assez rigoureux? Pour qu'un médicament soit approuvé, il doit généralement démontrer qu'il est plus efficace qu'un placebo. Ne devrait-on pas exiger que le produit fasse ses preuves contre un médicament qui est déjà sur le marché, dont on connaît le profil de toxicité et qui est beaucoup moins coûteux? Par ailleurs, les essais cliniques sont généralement de courte durée. Ils sont conçus pour évaluer l'efficacité du médicament et non sa toxicité, et les patients recrutés sont des patients idéaux. Les conséquences peuvent être dramatiques. C'est ainsi qu'on découvrira beaucoup plus tard les effets indésirables de nombreux produits. Sur une période de 25 ans, 10 p. 100 des médicaments ont reçu l'avertissement le plus sévère de la FDA, le black box warning, et 2,9 p. 100 ont été retirés du marché, alors que la monographie de 51 p. 100 d'entre eux a été modifiée en raison de problèmes de sécurité découverts après la commercialisation. Les recherches du Dr Joel Lexchin, de l'Université York, montrent que, sur une période de 40 ans, 39 p. 100 des médicaments retirés de la circulation l'ont été entre 1993 et 2004, une proportion beaucoup plus importante que dans les décennies précédentes. Certains d'entre eux auraient été approuvés avec trop d'empressement?
Plusieurs spécialistes ont tiré la sonnette d'alarme au sujet de la problématique. Aux États-Unis, une abondante littérature parle de crise de confiance à l'égard du processus d'homologation des médicaments, et puisque le processus de réglementation est pratiquement identique dans les deux pays, nous avons des raisons de nous inquiéter.
Cette crise de confiance a incité l'Institute of Medicine des États-Unis à faire toute une série de recommandations au sujet du processus de réglementation. Parmi ces recommandations, l'institut propose d'apposer un triangle noir sur les nouveaux médicaments pour une période de deux ans afin de signaler que tous les effets indésirables du produit ne sont pas connus; il suggère d'augmenter le budget de la FDA; il propose d'abolir ce qu'on appelle les frais aux usagers, qui correspondent aux frais que les fabricants paient pour approuver les nouveaux médicaments. Ces frais existent aux États-Unis depuis 1992 et au Canada depuis 1994. En échange, les fabricants ont obtenu une réduction du temps d'approbation des nouveaux produits. De nombreux observateurs pensent que, depuis sa mise en oeuvre, cette pratique est responsable de l'augmentation du nombre de médicaments retirés pour des raisons de sécurité. Un sondage interne de la FDA réalisé au tournant du siècle soulignait que 36 p. 100 des scientifiques de l'agence — ils avaient quatre choix de réponse — n'avaient aucunement confiance ou étaient modérément confiants dans la sécurité et l'efficacité des médicaments qu'ils approuvent et 18 p. 100 disaient avoir subi des pressions pour approuver des médicaments, en dépit des réserves qu'ils avaient quant à leur toxicité.
Le Dr Robert Peterson, ancien directeur général de Santé Canada, confiait au Journal de l'Association médicale canadienne que la réglementation internationale en matière de sécurité est adéquate dans 75 p. 100 des cas et que Santé Canada n'a pas de pouvoirs légaux, notamment celui d'exiger des études de suivi après commercialisation pour vérifier la toxicité des médicaments. La plupart des essais de phase IV demandés par Santé Canada ne sont tout simplement pas mis en oeuvre. Par ailleurs, Santé Canada étudie des propositions de modification au processus d'homologation qui mettraient l'accent sur la gestion des risques, ce qui suscite des craintes de la part de nombreux observateurs, craintes qui ont été exposées dans un article tout récent du Journal de l'Association médicale canadienne.
Compte tenu de ce qui précède, le principe de précaution ne devrait-il pas avoir préséance sur la gestion des risques, d'autant que les évaluations indiquent que 10 000 Canadiens meurent chaque année des effets indésirables des médicaments, même s'ils suivent les indications à la lettre?
En guise de conclusion, Santé Canada devrait disposer de pouvoirs étendus et d'un financement adéquat pour évaluer les médicaments. N'y aurait-il pas lieu d'utiliser quelques millions de nos surplus prodigieux pour garantir une meilleure qualité de vie et une plus grande sécurité aux citoyens canadiens qui le méritent? Et pourquoi ne pas rétablir le Bureau de recherche sur les médicaments, qui a été fermé en 1997?
Merci.