FAIT Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
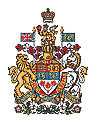
37e LÉGISLATURE, 2e SESSION
Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international
TÉMOIGNAGES
TABLE DES MATIÈRES
Le mardi 18 mars 2003
| ¿ | 0910 |
 |
Le président (M. Bernard Patry (Pierrefonds—Dollard, Lib.)) |
 |
John Sigler (professeur auxiliaire de sciences politiques, université Carleton) |
| ¿ | 0915 |
| ¿ | 0920 |
 |
Le président |
| ¿ | 0925 |
 |
M. Yves Fortier (président et associé principal, Ogilvy Renault, À titre individuel) |
| ¿ | 0930 |
| ¿ | 0935 |
| ¿ | 0940 |
 |
Le président |
 |
M. Stockwell Day (Okanagan—Coquihalla, Alliance canadienne) |
 |
Le président |
 |
John Sigler |
| ¿ | 0945 |
 |
M. Stockwell Day |
 |
John Sigler |
 |
Le président |
 |
Mme Francine Lalonde (Mercier, BQ) |
 |
John Sigler |
 |
Le président |
 |
M. Yves Fortier |
 |
Mme Francine Lalonde |
 |
M. Yves Fortier |
| ¿ | 0950 |
 |
Mme Francine Lalonde |
 |
M. Yves Fortier |
 |
Mme Francine Lalonde |
 |
M. Yves Fortier |
 |
Mme Francine Lalonde |
 |
Le président |
 |
M. Murray Calder (Dufferin—Peel—Wellington—Grey, Lib.) |
| ¿ | 0955 |
 |
Le président |
 |
John Sigler |
 |
Le président |
 |
Mme Alexa McDonough (Halifax, NPD) |
| À | 1000 |
 |
Le président |
 |
Mme Alexa McDonough |
 |
Le président |
 |
M. Yves Fortier |
| À | 1005 |
 |
Le président |
 |
Mme Aileen Carroll (Barrie—Simcoe—Bradford, Lib.) |
 |
John Sigler |
 |
M. Yves Fortier |
| À | 1010 |
 |
Le président |
 |
M. Bill Casey (Cumberland—Colchester, PC) |
| À | 1015 |
 |
M. Yves Fortier |
 |
M. Bill Casey |
 |
Le président |
 |
M. Yves Fortier |
 |
Le président |
 |
M. Bill Casey |
 |
M. Yves Fortier |
 |
Le président |
 |
M. Bill Casey |
 |
M. Yves Fortier |
 |
M. Bill Casey |
 |
M. Yves Fortier |
 |
M. Bill Casey |
 |
Le président |
 |
John Sigler |
| À | 1020 |
 |
Le président |
 |
M. Irwin Cotler (Mont-Royal, Lib.) |
 |
Le président |
 |
M. Yves Fortier |
| À | 1025 |
 |
Le président |
 |
M. Keith Martin (Esquimalt—Juan de Fuca, Alliance canadienne) |
| À | 1030 |
 |
Le président |
 |
John Sigler |
 |
Le président |
 |
M. Art Eggleton (York-Centre, Lib.) |
| À | 1035 |
 |
Le président |
 |
John Sigler |
 |
Le président |
 |
M. Stéphane Bergeron (Verchères—Les-Patriotes, BQ) |
| À | 1040 |
 |
Le président |
 |
M. Yves Fortier |
| À | 1045 |
 |
Le président |
 |
M. Yves Fortier |
 |
Le président |
 |
L'hon. Jim Peterson (Willowdale, Lib.) |
 |
M. Yves Fortier |
 |
Le président |
 |
M. Jim Peterson |
 |
John Sigler |
| À | 1050 |
 |
M. Jim Peterson |
 |
Le président |
 |
Mme Karen Redman (Kitchener-Centre, Lib.) |
 |
Le président |
 |
Mme Alexa McDonough |
 |
Le président |
 |
M. Keith Martin |
 |
Le président |
 |
M. Yves Fortier |
| À | 1055 |
 |
Le président |
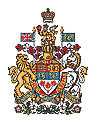
CANADA
Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international |
|
l |
|
l |
|
TÉMOIGNAGES
Le mardi 18 mars 2003
[Enregistrement électronique]
¿  (0910)
(0910)
[Traduction]

Le président (M. Bernard Patry (Pierrefonds—Dollard, Lib.)): Nous allons déclarer la séance ouverte. Conformément au paragraphe 108(2) du Règlement, nous entamons l'étude du dialogue sur la politique étrangère lancé par le ministre des Affaires étrangères.
C'est la première séance du comité tenant lieu de contribution au dialogue sur la politique étrangère, c'est-à-dire à la consultation du ministre des Affaires étrangères auprès des Canadiens concernant l'orientation future de notre politique étrangère. J'avais espéré amorcer notre étude par la comparution du ministre, mais il sera ici mardi prochain.
Je tiens à dire aux membres du comité qu'il y a une motion et qu'elle sera examinée quinze minutes avant la fin de la séance. Je rappelle à tous que le quorum fixé pour l'adoption de motions est de dix.
Ce matin, nous accueillons, de l'Université Carleton, M. John Sigler, qui est l'ex-directeur du Norman Paterson School of International Affairs. Il est actuellement professeur auxiliaire de sciences politiques spécialisé dans la politique du Proche-Orient, la politique étrangère des Nations Unies et les relations internationales.
Le témoignage de M. Sigler sera suivi, espère-t-on, de celui de M. Yves Fortier, dont nous attendons l'arrivée.
Nous allons maintenant entendre l'exposé de M. Sigler, après quoi, s'il est arrivé, nous entendrons celui de M. Fortier.
Monsieur Sigler, vous avez la parole.
[Français]
Bienvenue, monsieur Sigler.


John Sigler (professeur auxiliaire de sciences politiques, université Carleton):
Merci, monsieur le président.
[Traduction]
Je n'aurais pas pu choisir un meilleur moment pour témoigner ici, moi qui ai consacré une si grande partie de ma vie à ce point chaud qu'est le Moyen-Orient.
J'aimerais commencer par vous décrire un contexte plus général, bien que, je suppose, bon nombre de vos questions porteront probablement sur la crise actuelle.
Précisons au départ simplement que le mot «crise» est emprunté au domaine médical où il désigne le point tournant à partir duquel soit le patient se rétablit, soit son état s'aggrave. Il n'est certes question ce matin dans les médias que de la plus récente crise internationale, souvent interprétée comme un point tournant pour les Nations Unies, profondément divisés quant à la nature et au moment choisi pour mener une action militaire contre le régime de Saddam Hussein en Irak.
De pareils événements chocs attirent l'attention sur ce que nous faisons et les raisons pour lesquelles nous les faisons et confèrent une opportunité toute spéciale à votre étude visant à réévaluer la politique étrangère du Canada, même s'il est très difficile de prédire toutes les conséquences de la crise actuelle.
À ce propos justement, nous avons reçu un invité la semaine dernière, à Ottawa, soit John Waterbury, président de l'American University of Beirut. Un très haut diplomate canadien du Moyen-Orient lui a demandé, à la fin de son allocution, à quoi il s'attendait une fois que l'action militaire serait commencée.
Waterbury est une des plus grandes sommités américaines sur le Moyen-Orient—l'état de ses publications fait l'admiration de tous dans le domaine. Sa réponse ne s'est pas fait attendre: «Je n'en ai aucune idée». Il a poursuivi en disant qu'il prêtait l'oreille à toutes les voix optimistes, qui existent en grand nombre également au Moyen-Orient—mais qui ne s'affirment pas publiquement—et qu'il était conscient de tous les collègues qui sont des experts du Moyen-Orient et qui prévoient que l'action militaire aura des conséquences extraordinairement lourdes. J'ai la même réaction moi-même quand j'essaie de me faire une idée des conséquences qu'aura la crise actuelle sur la politique étrangère future du Canada.
Un des principaux points qui différencie l'opinion publique et la politique du Canada de celles des États-Unis est le rôle des Nations Unies. Ce ne fut pas toujours le cas, de sorte qu'il est simplement utile de faire un bref historique.
Lester Pearson a travaillé très fort à jeter des ponts entre le Royaume-Uni et les États-Unis et entre les États-Unis et l'Union soviétique au sujet du plan de partage des Nations Unies qui a abouti à la création d'Israël, en 1947-1948. N'eussent été le grand doigté et l'expertise de M. Pearson, je doute que les Nations Unies auraient réussi à régler la question comme elles l'ont fait.
Quand le Moyen-Orient a à nouveau explosé en 1956, lors de l'invasion coordonnée de l'Égypte par le Royaume-Uni, la France et Israël, Pearson a à nouveau travaillé de près avec la mission onusienne des États-Unis à régler ce conflit par la création de la première force de maintien de la paix des Nations Unies. À nouveau, le rôle du Canada était de servir de pont aux Nations Unies entre les États-Unis et l'Europe.
À mesure que s'intensifiait la guerre froide, les États-Unis se sont de plus en plus détournés des Nations Unies, qui n'ont pas joué un rôle très important dans le long conflit au Vietnam, même si le Canada était présent en tant que représentant de l'Occident à la Commission internationale de contrôle. Durant cette longue période, la politique étrangère des États-Unis a été de plus en plus dominée par le Pentagone, le Département d'État exerçant très peu d'influence. En fait, un des principaux diplomates des États-Unis durant cette période a intitulé ses mémoires Diplomat Among Warriers (Un diplomate parmi les guerriers).
Les Américains qui font carrière dans le service extérieur ont toujours eu la plus grande admiration pour le professionnalisme des diplomates canadiens, ce que j'ai pu documenter de nombreuses fois dans mes travaux de recherche. Les médias n'en parlent jamais, mais le fait demeure extrêmement important.
Même alors, il importe de reconnaître que le Canada, qui connaît très bien les faiblesses et les limites des Nations Unies, a toujours essayé de renforcer cet organisme multilatéral et d'aider à le restructurer de manière à le rendre plus efficace. Le rôle récent joué par le Canada au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue d'essayer de réconcilier les principales divergences des cinq membres permanents correspond à ce qu'il fait depuis très longtemps. Les médias ne semblent pas avoir très bien compris ce qu'essayait de faire Paul Heinbecker, c'est-à-dire de rapprocher les deux camps plutôt que de prendre parti.
Ce qu'il faut faire maintenant, c'est continuer de travailler avec une vaste coalition de personnes animées de mêmes idées pour trouver des moyens de rapprocher les deux camps et de rendre efficace le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le 50eanniversaire des Nations Unies a été marqué par d'importants efforts déployés en vue de les réformer. Étant donné la crise actuelle, il faut relancer ces efforts et voir comment le mouvement de réforme peut être revigoré et efficace sur le plan politique.
Un travail très sérieux a été accompli par la commission canadienne chargée du 50e anniversaire. Elle a en effet produit une série de recommandations bien réfléchies qui sont toutefois demeurées sans suite parce qu'il n'y avait pas de crise à ce moment-là. Par conséquent, sur le plan politique, il était impossible d'avancer, en raison des positions tranchées qui caractérisent si souvent les divisions sur toutes les questions politiques. Seule une crise fournit l'occasion de progresser, parce que tous en reconnaissent la nécessité.
Le dialogue au sujet de la politique étrangère du Canada a été lourdement dominé par les relations bilatérales, mais profondément asymétriques, du Canada et des États-Unis. Voilà vingt ans presque que le programme est dominé par les relations commerciales, qui continueront d'être une grande source de préoccupation, particulièrement en ce qui a trait aux relations transfrontalières durant une période de vive préoccupation des Américains au sujet de leur sécurité après la tragédie du 11 septembre 2001.
Confronté au coup porté par ces attaques, le gouvernement des États-Unis s'est lancé dans une guerre intensive contre le terrorisme. Il existe une documentation abondante et croissante sur les erreurs commises, bien que nous n'ayons pas encore le rapport officiel d'enquête sur les bavures des services de renseignement et de police. Or, la façon de traiter du financement, de la formation, du déplacement et du repaire des groupes terroristes relève essentiellement du renseignement de sécurité et de la police. Ce n'est pas une question dont il faut constamment saisir le public. Des progrès considérables ont été réalisés—par des professionnels—sur le plan international pour faire face à la nouvelle menace.
L'attaque en territoire américain a profondément affecté le débat qui s'est tenu récemment aux États-Unis au sujet du nouveau siècle américain, du rôle de l'unique hyper-puissance et du contrôle exercé par les États-Unis sur un monde en ébullition. Ce à quoi nous assistons avec l'attaque sur l'Irak fait partie de ce programme complexe d'hégémonie américaine: la menace de prolifération des armes de destruction massive et le terrorisme.
Les liens qui, selon le gouvernement des États-Unis, existent entre ces questions a été vivement contesté aux États-Unis même et encore plus à l'étranger. La grande surprise a été l'ampleur des mouvements de protestation qui ont vu le jour partout dans le monde dans le contexte mondial de l'Internet et de la nouvelle chaîne arabe Al-Jazeera, qui est regardée chaque jour par 50 millions de téléspectateurs, contre un million seulement pour CNN. Ces autres sources d'information ont une nette influence sur la façon dont le public perçoit les événements.
Au sujet de ce que j'ai dit concernant les profondes divisions qui existent, j'attire votre attention sur l'important éditorial paru aujourd'hui dans le New York Times, qui s'en prend vivement à l'administration Bush pour avoir créé cet important échec diplomatique. D'après le Times, on prétendra qu'il faut se rallier aux forces coalisées, maintenant que la guerre est commencée. Il affirme que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, que les États-Unis ont commis de graves erreurs, qu'il faut contester ces actes et les obliger à en répondre.
Ces commentaires viennent du coeur même de l'establishment responsable de la politique étrangère des États-Unis. Il faut tenir compte de la profondeur des divisions à Washington, au sein du gouvernement lui-même et certes parmi ceux qui, tout en appuyant la lutte au terrorisme, sont contre l'intervention militaire en Irak.
Certains analystes ont affirmé qu'il existe un nouvel affrontement entre les partisans du vieux nationalisme—qui met l'accent sur la coercition, l'affrontement avec l'ennemi et la domination—et de nouveaux mouvements post-nationalistes qui misent plutôt sur la société civile, sur les organismes non gouvernementaux nationaux et internationaux, sur la coopération et sur le respect des droits de la personne.
Nous avons constaté une grande évolution en ce sens au sein de la société canadienne et dans la politique étrangère du Canada. Bien qu'auparavant nous ayons considéré le développement, la diplomatie et les militaires comme des rivaux quand venait le temps d'obtenir sa part du budget, au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à un changement. Les Affaires étrangères travaillent de près avec l'ACDI et avec le ministère de la Défense nationale, ainsi qu'avec des organismes non gouvernementaux, et ils se partagent les responsabilités de rétablissement, de consolidation et de maintien de la paix. Il y a assurément eu une étroite collaboration entre les organismes gouvernementaux et les organismes non gouvernementaux pour élaborer le traité international sur les mines antipersonnel et la mise en place de la Cour pénale internationale.
¿ 
 (0915)
(0915)
Au sein même des forces armées canadiennes, nous avons pu voir d'importants changements dans la formation et les déploiements. On insiste en effet sur le travail avec les organismes d'aide humanitaire et d'aide au développement, qu'ils soient officiels ou non gouvernementaux. Le général Romeo Dallaire est un militaire de grande expérience qui articule avec beaucoup d'éloquence la nouvelle approche militaire canadienne. Il cite le règlement de la crise d'Oka comme exemple de succès remporté par la nouvelle formation prodiguée au Canada sur la façon de protéger les populations civiles lors d'affrontements intenses. Il la compare avec l'ancienne formation militaire qui misait uniquement sur la coercition.
On peut donc dire que quelque chose d'important est en train de se produire—j'espère que cela figure quelque part dans votre programme—dans les rapports entre la défense et la diplomatie, au moment même où nous vivons une période fort intéressante de changement.
Tout examen de la politique étrangère du Canada devrait insister pour renforcer l'efficacité et, certes, le financement de ces nouvelles approches canadiennes de coopération interministérielle et, plus particulièrement, sur le travail des organismes non gouvernementaux canadiens. On aura grand besoin de ce genre de travail pour la reconstruction et le développement de l'Irak qui dureront de nombreuses années, quand les États-Unis auront pleinement reconnu qu'ils n'ont qu'une expérience limitée et un faible engagement.
L'accent mis par les Américains sur la coercition, l'hégémonie et la puissance nuit à l'ouverture des sociétés et à l'admiration de valeurs comme la démocratie et le respect des droits de la personne qui, d'après les sondages, sont largement partagées partout sur la planète. Dans ce dossier épineux, le Canada a un important rôle à jouer, de concert avec d'autres intervenants animés des mêmes idées.
Aga Khan l'a bien dit: «Le Canada est actuellement la société la plus pluraliste de la planète... C'est là un trait unique au Canada et un incroyable atout pour l'humanité». C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand on y met le soutien économique, les services sociaux, le dialogue, le rapprochement au sein de la communauté et l'accent sur l'espoir dans l'avenir plutôt qu'un regard désespéré sur le passé.
Une autre question très épineuse que je vois à l'horizon, sur le plan international, est le conflit israélo-arabe. La grande souffrance du peuple palestinien figure haut dans la liste des doléances qui opposent l'Occident et le monde des Musulmans et des Arabes. De fait, il existe beaucoup de preuves que les Européens et un clan de nombreuses personnes au Département d'État, mené par Colin Powell, souhaitaient régler le conflit israélo-arabe avant de s'attaquer à l'Irak. C'est ce qui explique en partie la déclaration faite vendredi dernier par le président selon lequel il fallait renouveler l'appui au processus de paix et à un État palestinien et mettre fin au terrorisme.
Cette question suscite de vives émotions et, en Amérique du Nord, de fortes pressions, très souvent venues de groupes partisans du mode de l'affrontement et des deux camps, pourrais-je ajouter. L'escalade de la violence au cours des deux dernières années et demie dans l'intifada Alaqsa a sensiblement polarisé la situation, qui a été marquée depuis l'accord d'Oslo par une période brève, mais difficile d'échec des négociations. Des critiques émises récemment par des Israéliens, des Arabes et des Occidentaux qui savent très bien ce qui s'est passé ont lourdement blâmé les trois grands participants aux négociations d'Oslo, soit le gouvernement d'Israël, l'OLP et, plus particulièrement, le président des États-Unis, Bill Clinton.
Nous sommes en train de dessiner la «feuille de route du quartette» qui vise à créer un État palestinien viable et à régler les difficiles questions de frontières et d'établissements de réfugiés à Jérusalem. On va de l'avant avec les réformes palestiniennes, bien que le nouveau gouvernement d'Israël adopte une position très dure au sujet des grandes questions. Tant le public israélien que le public palestinien demeurent engagés à conclure une paix totale, et il faudra beaucoup de diplomatie de l'extérieur pour que les dirigeants tant palestiniens qu'israéliens appuient les concessions réciproques qu'ont élaborées en grande partie leurs propres diplomates.
L'International Crisis Group, un organisme non gouvernemental international établi à Bruxelles, a assumé un leadership précieux en vue de fournir le texte des accords définitifs entre Israël, les Palestiniens, le Liban et la Syrie.
Le Canada joue déjà un rôle central en vue d'établir une force internationale capable de superviser le retrait des Israéliens du territoire palestinien et de protéger les populations civiles, tant palestiniennes qu'israéliennes. Il faudrait que cela figure dans les grandes priorités à court terme de la politique étrangère du Canada.
Je vous remercie beaucoup.
¿ 
 (0920)
(0920)
[Français]


Le président: Merci, professeur Sigler.
Maintenant nous avons le privilège d'avoir avec nous M. Yves Fortier, président et associé principal chez Ogilvy Renault.
Monsieur Fortier, nous tenons aujourd'hui notre première réunion de dialogue sur la politique étrangère, la consultation du ministre des Affaires étrangères sur les orientations de la politique étrangère canadienne.
À titre d'information pour mes collègues, de juillet 1988 à janvier 1992, M. Fortier a occupé le poste d'ambassadeur et de représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies à New York, et en 1980 et 1990, il a représenté le Canada au Conseil de sécurité des Nations Unies. En octobre 1989, il a été nommé président de ce même Conseil de sécurité.
Bienvenue, monsieur Fortier.
Vous avez des notes, alors vous avez un bon 10 minutes à votre disposition pour discourir et nous parler. Par la suite, nous passerons aux questions et réponses.
S'il vous plaît, monsieur Fortier.
¿ 
 (0925)
(0925)


M. Yves Fortier (président et associé principal, Ogilvy Renault, À titre individuel):
Merci, monsieur le président.
Mesdames et messieurs membres du comité, je voudrais d'abord m'excuser de mon retard. J'ai été retenu par la circulation à l'entrée de la ville d'Ottawa, mais je ne voulais pas être impoli. Donc, encore une fois, mes excuses.
Monsieur le président, j'avais préparé quelques notes que je comptais vous livrer, mais eu égard aux événements des dernières heures, des derniers jours, j'ai pensé qu'il serait préférable que je réponde à vos questions, si questions il y a, comme avocat aujourd'hui, ce que j'étais avant d'avoir le privilège de représenter le Canada aux Nations Unies de 1988 à 1992 et ce que je suis redevenu quand je suis rentré à Montréal. Pour un avocat, un témoin est quelqu'un qui se présente non pas pour faire une déclaration, mais pour répondre à des questions. Alors, je suis disposé à répondre à vos questions.
Mais avant de ce faire, j'aimerais peut-être dire quelques mots sur ce que j'ai vécu quand je suis arrivé aux Nations Unies, en octobre 1988. Je ne suis pas et je n'ai jamais été un diplomate de carrière. J'étais, comme je viens de le mentionner, un avocat installé bien confortablement à Montréal lorsque le premier ministre d'alors, le très honorable Brian Mulroney, qui avait pratiqué le droit dans mon cabinet, m'a téléphoné pour me demander si j'étais intéressé à aller à New York, aux Nations Unies, à titre de représentant du Canada.
Le Canada était candidat à un siège au Conseil de sécurité à l'époque, et le premier ministre m'avait dit qu'il était confiant que le Canada serait élu, qu'il désirait avoir en poste quelqu'un qu'il connaissait, avec qui il avait déjà eu une relation amicale, une relation d'affaires aussi. Évidemment, ça n'avait jamais fait partie de mon plan de carrière, mais c'est avec plaisir et avec enthousiasme que je me suis rendu à New York.
Quand un ambassadeur arrive dans un poste, il y a une tradition: il doit présenter ce qu'on appelle «ses lettres de créance» au chef du gouvernement ou, dans le cas d'un poste multilatéral des Nations Unies, au secrétaire général. Alors, je me suis présenté. À l'époque, le secrétaire général était M. Perez de Cuellar. Je suis arrivé au rendez-vous avec mes lettres de créance et j'ai dit que j'étais vraiment Yves Fortier, l'ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies.
Comme le veut la tradition, il m'a invité, après avoir reçu ce document officiel, à sabler le champagne avec lui dans son cabinet. C'était un bon début, j'étais enthousiaste, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et je n'ai pas refusé l'invitation. Alors, j'ai eu ce premier dialogue avec celui qui allait devenir un ami durant les trois années qui ont suivi, le secrétaire général des Nations Unies. Il m'a dit quelque chose à l'époque dont je me souviens encore aujourd'hui. Encore à ce moment-là, quand on m'appelait monsieur l'ambassadeur, je pensais qu'il y avait quelqu'un derrière moi, parce que je n'étais pas habitué à réagir à ce titre. Il m'a dit que lorsqu'il voulait donner en exemple le pays qui est le meilleur ami des Nations Unies, qui contribue le plus aux Nations Unies, il choisissait le Canada. J'ai écouté, j'étais très fier d'entendre ce secrétaire général des Nations Unies me livrer ces propos.
¿ 
 (0930)
(0930)
Dans les minutes qui ont suivi, en revenant à pied à la mission du Canada, je me suis dit qu'il devait dire la même chose à tous les nouveaux ambassadeurs qui arrivaient et qui présentaient leurs lettres de créance. Mais j'ai vite réalisé que non, au cours des semaines et des mois qui ont suivi.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous étions en campagne pour obtenir un poste non permanent, un siège au Conseil de sécurité. À New York, dans les capitales, à Ottawa, des démarches étaient entreprises. Moi, ma responsabilité au Nations Unies était de rencontrer les ambassadeurs de tous les pays durant une période de trois à quatre semaines avant le vote, et c'est ce que j'ai fait. À l'époque, il y avait 140 ou 145 pays. Aujourd'hui, il y en a 190. Et partout où je suis allé, dans toutes les missions, j'ai entendu, avec certaines variations, le même message que celui que le secrétaire général des Nations Unies m'avait livré, à savoir que le Canada est le pays modèle aux Nations Unies, que lorsqu'on veut obtenir qu'une résolution soit approuvée, lorsqu'il y a une démarche à entreprendre, etc., on frappe toujours à la porte du Canada.
En effet, le jour des élections, à la fin du mois de novembre, le Canada a obtenu le plus grand nombre de votes qu'un pays ait jamais obtenus aux Nations Unies, et nous avons été élus au Conseil de sécurité.
Je raconte cette histoire, monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du comité, pour mettre en relief peut-être ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le Canada a déployé des efforts considérables. Mon ami et successeur, Paul Heinbecker, a accompli selon moi un travail remarquable et remarqué à New York ces dernières semaines. Le rôle que le Canada a joué, comme le professeur Sigler le mentionnait il y a quelques instants, celui de tenter de réconcilier les vues divergentes des clans qui s'opposaient, est dans la meilleure tradition onusienne. Qu'il ait échoué, on ne peut pas le lui reprocher. Au contraire, on ne peut que louer les efforts que le Canada a déployés.
Mais hier soir, j'entendais le premier ministre, M. Chrétien, déclarer à la Chambre des communes que le Canada n'allait pas participer à cette coalition, et je me suis souvenu d'un texte que j'ai présenté l'année dernière à l'Université de Toronto et dont j'aimerais vous lire un extrait. Je l'avais intitulé «Un Québécois Canadien in the ROC's Court». C'était à la conférence Pierre Genest. Je disais:
[Traduction]
| Il y a 100 ans, des troupes canadiennes, dont les Strathconas—certains de leurs éléments sont actuellement en Afghanistan—, se battaient aux côtés des troupes britanniques, sous commandement britannique, durant la guerre des Boers. Comme l'ont écrit les éminents Barry Cooper et David Bercuson, les Canadiens ont participé à cette initiative militaire parce que le gouvernement du jour, sous la direction de Wilfrid Laurier, souhaitait accroître l'influence du Canada au sein de l'empire britannique. À l'époque, dans les faits, la Grande-Bretagne était incontestablement «le soleil autour duquel gravitait le Canada», bien qu'une grande incertitude, dont on a beaucoup parlé, ait régné au Canada quant à la distance que le pays devait maintenir par rapport au soleil. |
Remplacez le Royaume-Uni par les États-Unis et vous avez là un résumé du dilemme avec lequel est aux prises le Canada actuellement. Le grand débat au sujet de la souveraineté du Canada qui a eu lieu durant le premier tiers du XXe siècle a témoigné de deux vues divergentes, dont l'une se retrouvait dans les politiques de Laurier. Lui et son successeur conservateur, Robert Borden, croyaient que le Canada gagnerait en autonomie et en influence comme pays en participant pleinement aux affaires de l'empire. De fait, on attribue à Borden une présence canadienne importante à la table de négociations de la paix à la fin de la Première Guerre mondiale, grâce aux contributions et aux sacrifices de notre pays sur le front ouest, durant ce conflit.
L'autre point de vue défendu par William Lyon Mackenzie King voulait que le Canada acquière l'autonomie recherchée uniquement en se tenant à distance de la Grande-Bretagne et surtout des plans de défense britanniques. Cette politique également a été efficace, comme en témoigne éloquemment le Statut de Westminster.
Il faut cependant reconnaître que ces politiques contradictoires, qui ont chacune connu leur moment de gloire, témoignaient de deux séries de circonstances diamétralement opposées—la guerre et la paix. De toute évidence, chacune convenait au contexte particulier qui lui a donné naissance.
Les États-Unis sont actuellement, peut-on dire, encore plus puissants par rapport au reste du monde que ne l'était la Grande-Bretagne, il y a un siècle. Le dilemme auquel est confronté le Canada demeure néanmoins essentiellement le même qu'alors et comme il a toujours été tout au long des nombreux grands débats qui ont marqué le XXe siècle. Des Canadiens raisonnables continuent de ne pas s'entendre quant à la façon dont le Canada devrait réagir à ce que les Français appellent l'hyper-puissance. Le centre de notre système solaire s'est peut-être déplacé, mais la question demeure de savoir quel devrait être le rayon optimal de l'orbite canadienne autour du nouveau soleil américain.
La façon dont le Canada a réagi au cours des derniers mois—c'était en janvier 2002—aux honteuses attaques du 11 septembre et l'introspection collective engendrée à la fois par les attaques et par la réaction de notre gouvernement illustrent bien la durabilité et la complexité de ce dilemme. Il me vient à l'esprit—et ce n'est pas la première fois—que les Canadiens ont ceci d'unique qu'ils sont particulièrement enclins à vivre des crises d'identité. Nous sommes peut-être les seuls parmi les peuples du monde à ne jamais sembler plus heureux que lorsqu'ils sont aux prises avec un débat au sujet de leur souveraineté, de leur unité, de leurs valeurs—bref, de leur identité, surtout par rapport aux États-Unis.
¿ 
 (0935)
(0935)
[Français]
Je vous livre ces quelques propos que j'ai partagés avec les étudiants à l'Université de Toronto il y a un peu plus d'un an parce que je crois qu'ils sont toujours d'actualité. La décision du gouvernement du Canada qui a été prise dans les dernières heures de ne pas se joindre à la coalition qui va évidemment être menée par les États-Unis témoigne d'une volonté d'affirmer la souveraineté du Canada. Le Canada aurait pu dire «Aye, aye, Sir!», comme l'Australie l'a fait, comme la Grande-Bretagne l'a fait. On aurait pu s'attendre à ce que le Canada, voisin intime des États-Unis, qui reçoivent 85 p. 100 de nos exportations, dépendant on ne peut plus des humeurs des États-Unis, en bout de ligne, dise oui. Qu'il ait choisi de dire non est sûrement dans la meilleure tradition onusienne. Nous sommes partisans du multilatéralisme, nous allons continuer à travailler au sein des organisations internationales, nous allons continuer à tenter d'influencer les décisions qui sont prises aux Nations Unies, mais dans le cas présent, nous préférons nous abstenir.
Dans l'immédiat, d'après moi, c'est la bonne décision. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, même si en me relisant je croyais avoir vu dans la boule de cristal certaines choses qui auraient peut-être pu m'échapper. Je crois qu'à long terme, cependant, il va y avoir un prix à payer. Si la coalition menée, gérée par les États-Unis remporte une victoire rapide, si des armes de destruction massive sont trouvées en Irak, si les Irakiens chantent, dansent dans les rues, évidemment, ceux qui auront dit non vont devoir faire amende honorable et avouer qu'ils auraient peut-être dû dire oui, mais qu'ils ne pouvaient le faire sans que la coalition ait la bénédiction des Nations Unies.
Donc, selon moi, c'était la bonne décision, c'est la bonne décision, et je suis fier de mon pays, je suis fier de mon gouvernement. Merci.
¿ 
 (0940)
(0940)


Le président: Merci beaucoup pour vos remarques, monsieur Fortier. J'ai une petite requête à formuler, compte tenu de votre expérience aux Nations Unies et surtout compte tenu des événements présents et du fait que nous tenons des consultations sur les orientations de la politique étrangère canadienne. J'aimerais, si c'était possible, avoir les notes que vous aviez préparées. C'est peut-être un autre petit sujet pour nos recherchistes. S'il vous plaît, j'apprécierais si vous pouviez les remettre à nos recherchistes après la séance. Nous allons maintenant passer aux questions et réponses.
[Traduction]
Nous entamons le tour de table de cinq minutes. M. Day sera le premier à prendre la parole.
[Français]


M. Stockwell Day (Okanagan—Coquihalla, Alliance canadienne): Merci, monsieur le président.
Monsieur Fortier, merci bien pour votre service distingué à notre pays. Bien sûr, nous sommes fiers de votre engagement pour nous. Même si je ne suis pas de votre avis, merci bien pour votre service.
[Traduction]
Monsieur Sigler, il faut faire vite. Je vous poserai donc simplement quelques brèves questions. Avec un peu de chance, elles seront brèves. Si vous n'êtes pas capable de répondre à toutes les questions, je dois prendre la parole à votre université demain, et nous pourrons peut-être inverser les rôles à ce moment-là : je prendrai la parole, après quoi vous pourrez me poser quelques brèves questions.
Voici la première. Vous avez commenté l'ampleur et l'importance des manifestations en faveur de la paix. Leur attribuez-vous la même ampleur que celles qui visaient à protester contre la mondialisation auxquelles nous avons assisté au cours des dernières années? Devrions-nous nous en émouvoir autant?
Deuxième question, pour ce qui est de la relation entre la défense et la diplomatie, êtes-vous d'accord avec la proposition voulant que nous ayons perdu de notre influence diplomatique, surtout à la table de l'OTAN, au cours des sept ou huit dernières années en raison de la réduction de notre contribution militaire?
Troisième question, pourriez-vous commenter une proposition selon laquelle la raison d'être d'un militaire devrait être simplement de dissuader et de détruire l'ennemi et que si l'on confond avec les rôles qui reviennent aux organismes humanitaires, qu'on les applique aux militaires, c'est là que les choses se compliquent?
Enfin, pourriez-vous commenter—vous avez mentionné la souffrance des réfugiés palestiniens—le fait qu'Israël ait absorbé au cours des dernières décennies un nombre incroyable de réfugiés venus du monde entier, notamment quelque 900 000 personnes chassées de l'Irak, et le fait que les pays arabes refusent d'accueillir les réfugiés palestiniens?
Je vous serais reconnaissant de tout ce que vous pourriez me dire en trois minutes.


Le président: Monsieur Sigler, vous avez maintenant la parole.


John Sigler: Merci d'être si rapide.
Au sujet de l'importance de la manifestation, je ne mettrais pas complètement sur le même pied le mouvement anti-mondialisation... On retrouve bien sûr des éléments propres à l'anti-mondialisation. Ce que je tiens surtout à souligner, c'est l'effet extraordinaire des sources d'information actuelles, sans compter leur diversité et ce, grâce à la toile.
Les manifestations qui se sont déroulées à ce moment-là ont sans aucun doute été les plus importantes jamais organisées à l'échelle de la planète et dans de nombreux pays. Washington ainsi que bien d'autres instances ont été abasourdies pendant près de 48 heures face à l'ampleur de la protestation contre le problème intérieur posé par la coalition des pays disposés à partir en guerre. Je voulais simplement dire qu'il s'agit d'un nouveau phénomène; nous n'avons jamais rien vu de semblable auparavant—même si on avait pu le présager en disant que les manifestations anti-mondialisation témoignaient en fait de la coordination internationale des mouvements de protestation. Je ne pense pas toutefois que, dans le cas qui nous intéresse, ce soit la même chose.
À propos de la défense et de la diplomatie, je suis certainement d'accord avec vous, nous avons perdu de notre influence en raison du sous-financement en matière de défense. Presque tout le monde est d'accord sur ce point et bien sûr, dans le dernier budget, le gouvernement commence à s'occuper de la question du sous-financement qui perdure depuis longtemps.
À de nombreux égards, c'est lié à l'autre question que vous posez au sujet de la définition de défense militaire. Vous dites qu'elle sert tout d'abord à détruire l'ennemi, ce qui correspond à un genre de philosophie que l'on qualifie de nationaliste—la philosophie militaire traditionnelle stipulant que ce genre d'entraînement...on peut lire énormément d'ouvrages canadiens sur l'histoire de ce changement. Je vous invite simplement à écouter Roméo Dallaire, qui insiste beaucoup sur la nécessité d'aller plus loin que ce genre d'entraînement militaire.
¿ 
 (0945)
(0945)


M. Stockwell Day: Je pense qu'il est un bon exemple, puisque c'est lui qui a invité les Nations Unies à intervenir au Rwanda, ce dont elles se sont abstenues, ce qui a mené à un génocide de plus d'un million de personnes.


John Sigler: Oui, mais il ne faut pas oublier le rôle joué par les États-Unis, que Washington continue d'omettre de mentionner lorsqu'il compare le Kosovo et le Rwanda. Tout le monde sait parfaitement bien que ce sont les États-Unis qui, très clairement, ont refusé au Conseil de sécurité... et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier.
Pour ce qui est de la question des réfugiés palestiniens, de toute évidence vous voulez parler du grand nombre de ceux qui sont arrivés après la création, en 1948. On s'est efforcé de relier cette question à celle des réfugiés, mais comme vous le savez peut-être, le Canada a présidé, contre son gré... Nous voulions nous occuper de la question de l'eau dans le cadre du processus d'Oslo, mais on nous a demandé de nous occuper de celle des réfugiés et je dois dire que la diplomatie canadienne, fidèle à elle même, a réagi avec efficacité.
À la toute première séance du Groupe de travail sur les réfugiés qui s'est déroulée à Ottawa, les Israéliens ont convenu que le cas des personnes originaires des pays arabes ne serait pas soulevée dans le cadre global de la question des réfugiés. C'est l'entente officielle: Ces questions sont distinctes. Il est un fait que les éditoriaux des journaux occidentaux et d'Israël notamment en font constamment mention, mais il est convenu que dans le cadre des négociations diplomatiques, cette question quelle qu'elle soit, ne doit pas être confondue avec celle des réfugiés palestiniens.


Le président: Merci.
Je cède maintenant la parole à Mme Lalonde, s'il vous plaît.
[Français]


Mme Francine Lalonde (Mercier, BQ): Merci à vous deux. J'aimerais avoir votre avis, tous les deux, sur cette situation dramatique que nous vivons. C'est une situation dramatique parce que les États-Unis, avec leurs alliés fidèles, ont décidé de claquer la porte du Conseil de sécurité, qui refusait leur proposition visant à permettre de faire la guerre rapidement. Ils ont, en discréditant le Conseil de sécurité, décidé de se lancer dans une guerre qui n'est pas reconnue par la majorité des experts comme étant légale en vertu du droit international et encore moins légitime, pour un ensemble de circonstances que vous connaissez comme moi.
Comment faire, vous qui avez une connaissance des Nations Unies, malgré cette situation, pour donner l'espoir que la communauté internationale ne sera pas seulement à la remorque de la nouvelle doctrine stratégique américaine?
[Traduction]


John Sigler: Vous faites référence au grand spécialiste juridique international, surtout lorsque vous soulevez la question...
[Français]


Le président: Monsieur Fortier. M. Sigler pourra peut-être ajouter quelque chose ensuite.


M. Yves Fortier: Merci, monsieur le président.
Madame Lalonde, la question est de taille.


Mme Francine Lalonde: Oui, je sais.


M. Yves Fortier: Vous dites que la guerre qui s'annonce est illégale.
Mme Francine Lalonde: D'après la majorité des experts.
M. Yves Fortier: Je vais répondre d'abord en tant que juriste international; c'est mon créneau aujourd'hui. Je vais vous dire ce qu'un client que j'avais il y a bien longtemps me disait. Il aurait bien aimé trouver un jour un avocat manchot qui ne puisse dire: «on the one hand, on the other hand». C'est souvent le cas lorsque des questions de nature juridique sont soulevées.
Les juristes, et non les moindres, ont des opinions divergentes. Je lisais un article dans The Times de Londres il y a quelques jours dans lequel on citait certaines sommités en droit international, de l'Université d'Oxford et de l'Université de Cambridge. L'un disait qu'une guerre qui n'est pas sanctionnée par le Conseil de sécurité, nonobstant le fait qu'il n'y a pas cette 18e résolution que les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Espagne, entre autres, recherchaient, n'est pas illégale aujourd'hui, eu égard aux 16 résolutions qui ont été adoptées par le Conseil de sécurité depuis 1991 et qui enjoignent l'Irak de se désarmer sinon il devra faire face à de graves conséquences, toutes des résolutions qui ont été adoptées sous l'égide du chapitre VII de la Charte des Nations Unies portant sur les menaces à la paix et à la sécurité. L'autorisation pour un pays membre des Nations Unies d'agir comme les États-Unis ont décidé d'agir aujourd'hui est validée par ces résolutions qui sont déjà en place. C'est une opinion.
Il y a d'autres non moindres sommités qui disent que non, que la résolution 1441 de novembre 2002, entre autres, et les résolutions qui l'ont précédée n'ont jamais expressément autorisé un recours à la force. Donc, sur le plan purement juridique, il y a des opinions...
¿ 
 (0950)
(0950)


Mme Francine Lalonde: J'ai dit la majorité, donc je savais qu'il y avait une minorité.


M. Yves Fortier: Sur le plan diplomatique, on a parlé tout à l'heure du Rwanda. On pourrait parler du Kosovo, on pourrait parler des gestes que la France a posés en Côte d'Ivoire il n'y a pas tellement longtemps. Ce sont tous des gestes qui n'ont jamais été sanctionnés par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui n'ont jamais été qualifiés d'illégaux.
Je suis un aficionado des Nations Unies. En 1990-1991, j'ai tout fait ce que j'ai pu et le Canada a fait beaucoup pour s'assurer que les États-Unis ne partent pas en guerre seuls pour déloger l'Irak du Koweït. Heureusement, c'était l'euphorie à l'époque. Rappelez-vous, c'était après la chute du mur de Berlin, après la désintégration de l'Union soviétique. Tout baignait dans l'huile. Parfois, j'entendais l'ambassadeur soviétique, devenu l'ambassadeur russe, faire des interventions et je croyais que c'était l'ambassadeur américain qui parlait tellement il suivait le bâton de conducteur des États-Unis. Alors, à l'époque, il y a eu une résolution qui a autorisé ce que l'on sait.


Mme Francine Lalonde: Oui, il y avait eu invasion du Koweït.


M. Yves Fortier: Oui, il y avait eu invasion du Koweit, absolument. Aujourd'hui, la deuxième résolution que recherchaient plusieurs pays, dont la France, la Russie et plusieurs autres, allait faire l'objet d'un veto, et les États-unis ont décidé de passer outre à cette résolution forts, disent-ils, de l'autorisation de légitimité qui leur est conférée par la résolution 1441 et par les autres résolutions.


Mme Francine Lalonde: Voyons donc. Ils doivent se faire payer cher.


Le président: Merci, monsieur Fortier. Nous allons maintenant passer à M. Calder.
[Traduction]
Monsieur Calder, s'il vous plaît.


M. Murray Calder (Dufferin—Peel—Wellington—Grey, Lib.): Merci beaucoup, monsieur le président.
Monsieur Sigler, vous avez soulevé plusieurs points au cours de votre exposé. Si en fait, la guerre doit avoir lieu, je crois qu'elle va se terminer très rapidement en terrain découvert, mais qu'elle va s'enliser à Bagdad et que nous allons probablement nous retrouver dans une situation semblable à celle d'Ortona, lors de la Deuxième Guerre mondiale, et à celle de Stalingrad.
En plus, ce conflit est différent de celui de 1991, puisque les nouvelles sont maintenant instantanées. Par conséquent, lorsque les premières housses mortuaires seront photographiées et envoyées aux États-Unis... Je vous pose donc la question suivante : vous semblez dire qu'il y a des tensions entre le Département d'État et le Pentagone et, en fait, les tensions actuelles sont telles qu'elles pourraient indiquer une division. Je me demande donc, tout d'abord, ce qui oriente la philosophie du Pentagone. S'inquiète-t-il en fait de l'image d'un tigre de papier, pour commencer? Deuxièmement, quelles seraient les incidences du Project for the New American Century?
¿ 
 (0955)
(0955)


Le président: Monsieur Sigler.


John Sigler: D'après votre question, je vois que vous saisissez très bien les divergences qui se manifestent à Washington.
Pour ce qui est des mauvaises nouvelles, vous pouvez émettre des hypothèses aussi facilement que moi. C'est, bien sûr, tout le parallèle établi entre ce conflit et celui du Vietnam. Par contre, il ne faut pas oublier que le Département d'État et la CIA étaient contre l'intervention au Vietnam, à laquelle s'opposaient aussi l'aviation et la marine, mais que, par suite d'une cabale au sein de l'armée, le président s'est vu contraint d'intervenir. Il y a donc un parallèle vu que, comme vous le savez fort bien, les décisions prises par des entités responsables ne sont pas toujours unanimes à propos de questions comme celles-ci. Il y a toujours des divergences de vue.
Celles que vous soulignez mettent l'accent sur un parti pris idéologique de la part d'un groupe de civils au Pentagone. Il ne s'agit pas de philosophie militaire—absolument pas. Les militaires sont là pour répondre aux désirs des politiciens et non pour faire du lobbying et les militaires américains sont excellents dans ce domaine.
Par contre, ceux qui prennent ces décisions et je regrette d'avoir à le dire, sont des docteurs en science politique, qui, pour la plupart, n'ont aucune expérience militaire, mais qui, depuis quelque temps au sein du système américain, sont chargés d'exercer un pouvoir militaire extraordinaire.
Le Canada n'agit pas de la sorte, fort heureusement. Nos politicologues restent dans les universités, comme il se doit.
Ce que je dis en connaissance de cause, puisque je m'intéresse depuis longtemps à la politique de Washington, c'est que ce qui est particulièrement troublant, c'est de voir un tel petit groupe prendre la décision d'attaquer l'Irak. Il ne faut donc pas oublier, dans le contexte du débat au Conseil de sécurité et ailleurs, qu'il s'agit d'un très petit groupe qui se retrouve au premier plan.
Charles Freeman est président du Middle East Policy Council, influent groupe de réflexion sur le Moyen-Orient à Washington. C'est un ancien ambassadeur dans cinq pays arabes, ainsi que l'arabologue par excellence du Département d'État, qui vient juste de prendre sa retraite. Dans une allocution prononcée au Congrès, il a déclaré qu'un tout petit groupe de débiles mentaux s'est emparé de la politique étrangère américaine et a placé le président devant un choix impossible: l'humiliation politique découlant d'un retrait ou une guerre terriblement dangereuse.
Il a été également secrétaire adjoint à la Défense sous l'administration Clinton, mais il est diplomate de carrière. Ce sont donc les propos tenus par des gens en place aux États-Unis et c'est ce qui explique le débat houleux sur la sagesse d'une telle intervention.
Ceci étant dit, j'espère que les terribles scénarios envisagés ne vont pas se concrétiser, mais il faut bien y penser, puisque par définition, les gens réagissent, et que nous ne savons absolument pas comment les Irakiens vont réagir. Je m'inquiète moins de la réaction irakienne et des combats en Irak que des éventuelles retombées sur le monde arabe et musulman. On le saura dès les premières heures de lancement des missiles, mais on ne peut le prédire, même si nous avons relevé les cotes d'alerte, car tout le monde s'entend pour dire qu'il y a véritablement danger.


Le président: Merci, monsieur Sigler.
Je cède maintenant la parole à Mme McDonough.


Mme Alexa McDonough (Halifax, NPD): Merci beaucoup, monsieur le président.
Je suis sûre que nos invités de ce matin savent que les priorités établies par notre comité dans le cadre de son plan de travail pour l'année visent essentiellement à aborder la question du rôle du Canada dans le monde d'aujourd'hui dans le contexte du dialogue sur la politique étrangère, et celle des relations du Canada avec le monde arabe et musulman.
Vous comparaissez devant notre comité à un moment très critique et je crois que nous devrions peut-être remercier notre personnel d'avoir trouvé le moment qui s'imposait, ou bien s'agit-il uniquement de hasard. C'est à mon avis une chance incroyable que d'entendre votre point de vue sur ces questions.
D'innombrables questions se posent, mais je vais me limiter à deux d'entre elles portant sur un éventuel calendrier. Tout d'abord, quel rôle devrait revenir au Canada. Je ne veux pas parler du rôle qu'il doit jouer dans un avenir incertain, mais celui qu'il doit jouer aujourd'hui et demain, ainsi que dans les semaines à venir, vu les antécédents de notre pays en la matière. Je pose simplement cette question, non pas pour en débattre vraiment, mais juste pour essayer de situer le contexte de ce que nous vivons actuellement.
Le premier ministre a annoncé hier que le Canada a décidé de ne pas appuyer la guerre de Bush, ce dont je le félicite. Le Conseil de sécurité n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une nouvelle résolution autorisant une intervention militaire. Le Canada s'est démené, sans succès malheureusement, pour trouver un compromis afin de rallier toutes les parties. Il est un peu effrayant de penser que nous tentions en fait d'obtenir une résolution autorisant une intervention militaire en dernier ressort, et il est regrettable que nous ayons échoué.
Que faire maintenant? C'est la question que je pose. Il ne fait aucun doute que le Canada a un rôle humanitaire de premier plan à jouer; c'est un fait. Cela risque de ne pas durer éternellement, mais dans le monde de la diplomatie, nous cherchons avant tout—et je crois que tous les partis s'entendent sur ce point—à faire en sorte que nous jouions ce rôle de la manière la plus responsable possible. Quelles mesures le Canada devrait-il prendre, tout d'abord, dans la situation immédiate vis-à-vis l'Irak et, deuxièmement, dans le contexte de l'atroce conflit israélo-palestinien dont on ne voit plus la fin?
Je me suis rendue dernièrement au Moyen-Orient où l'on m'a fait comprendre que le Canada a un rôle unique à jouer. Notre pays est très respecté. Pourquoi le Canada n'en fait-il pas plus? Que devrions-nous faire? Ces deux questions sont évidemment reliées.
À 
 (1000)
(1000)


Le président: Merci beaucoup, madame McDonough.
Je veux simplement vous dire que si vous utilisez vos cinq minutes pour faire des commentaires, vous n'aurez pas de réponses.
Monsieur Fortier ou monsieur Sigler, s'il vous plaît.


Mme Alexa McDonough: Le Président ne m'accorde que 35 secondes.


Le président: D'accord.


M. Yves Fortier: Monsieur le président, nous avons convenu que c'est moi qui répondrais à ces deux questions en premier. Je pense pouvoir vous répondre assez brièvement. Vos questions portent essentiellement sur le Canada et le rôle du Canada au sein des Nations Unies.
Quel rôle le Canada devrait-il jouer aux lendemains de la guerre? Les Nations Unies vont jouer un rôle, tout comme leurs organisations. Je suppose—et je ne pense pas trop me tromper—que la guerre va être déclarée d'ici la fin de la semaine et, qu'à l'instar de toutes les guerres, elle va être sanglante. Il y aura une reconstruction. De l'aide sera requise. Le PMUD, l'UNICEF et bien d'autres organisations des Nations Unies, auxquelles le Canada participe très activement, joueront un rôle et, à mon avis—je crois que le premier ministre l'a d'ailleurs dit, ou je l'ai entendu dire, hier je crois, ou bien était-ce peut-être M. Graham, le ministre des Affaires étrangères—le Canada aura un rôle à jouer après la guerre, dans le contexte des Nations Unies; le Canada sera présent.
Qu'en est-il maintenant de la situation vis-à-vis l'Irak? Il me semble évident que d'après le message que le président Bush a transmis hier au monde entier que la diplomatie multilatérale internationale ne joue plus. Les efforts du Canada—qui, comme je l'ai souligné plus tôt, s'inscrivaient dans la meilleure tradition, à mon avis, du rôle du Canada au sein des Nations Unies—ne servent plus à rien. Il n'y a rien que le Canada puisse faire dans l'immédiat, que ce soit au sein des Nations Unies ou ailleurs, vis-à-vis l'Irak.
Pour ce qui est de la question d'Israël et de la Palestine, du problème du Moyen-Orient toujours aigu, soumis à l'adage oeil pour oeil dent pour dent, problème qui perdure depuis trop longtemps, le Canada a-t-il un rôle à jouer? À mon avis, oui. Ce rôle se résume à de la diplomatie discrète vis-à-vis Washington. Vous avez déjà entendu le président faire il y a quelques jours une déclaration au sujet de la feuille de route que ses alliés, dont le Canada, j'ai raison de le croire, l'incitent à établir. C'est un rôle que le Canada peut jouer. Ce n'est évidemment pas un rôle de premier plan mais plutôt un rôle en coulisses, de la diplomatie discrète à la Lester Pearson.
À 
 (1005)
(1005)
[Français]


Le président: Merci, monsieur Fortier.
Nous allons maintenant passer à Mme Carroll.
[Traduction]


Mme Aileen Carroll (Barrie—Simcoe—Bradford, Lib.): Merci, monsieur le président. Je ne savais que c'était mon tour, si bien qu'il me faut réfléchir quelques instants.
Monsieur Sigler, j'espère que vous pourrez nous remettre votre déclaration liminaire sous une forme ou une autre. Je comprends que vous l'avez probablement préparée sous forme de notes, mais j'aimerais beaucoup en avoir copie. Comme vous, je commence ma journée par la lecture de l'éditorial du New York Times, toujours très pertinent.
J'aimerais poser une question particulière plutôt que générale. J'ai eu le grand honneur de me trouver la semaine dernière à la Haye à l'occasion de l'inauguration de la Cour pénale internationale. Deux anciens procureurs de Nuremberg étaient présents, deux Américains, Ben Ferencz—j'espère ne pas mal prononcer son nom—dont c'était le 83e anniversaire, et également un M. King. Il était évident qu'ils étaient consternés en raison de l'absence des Américains. Le rôle du Canada, si ouvert, fort admiré par toutes les personnes présentes, est bien sûr quelque chose dont nous avons tous conscience, mais c'est sans doute la convergence de tous ces événements qui m'en a véritablement fait saisir l'importance.
Tout en gardant le procès de Nuremberg à l'esprit, dans le contexte du droit international, je trouve tout à fait remarquable que le président Bush ait fait allusion hier soir à l'un des principes de Nuremberg, à savoir que nous serons jugés même si nous plaidons l'ignorance. À mon avis, c'est par suite du procès de Nuremberg qu'il a été décrété que toute forme d'agression va à l'encontre de certaines des lois établies à ce moment-là; nous avons dû ensuite attendre 50 ans avant la création de la Cour pénale internationale. Je trouve difficile... même si, après avoir écouté M. Fortier, je sais que les avis seront partagés quant à l'interprétation du droit international à l'égard de l'intervention américaine, je me pose des questions au sujet des décisions prises à Nuremberg et de votre point de vue à cet égard.
J'aimerais bien sûr savoir ce que M. Sigler a à dire, mais aussi entendre les observations de M. Fortier.


John Sigler: Comme je me trouve entre deux éminents spécialistes du droit international—votre associé et M. Fortier, je préfère leur céder la parole.


M. Yves Fortier: Comme je me trouvais à l'étranger la semaine dernière, je n'ai pas lu d'articles à propos des interventions faites à La Haye lors de l'inauguration de la Cour pénale internationale, créée sous l'instigation du Canada et de mon ami et ancien collègue aux Nations Unies, Philippe Kirsch—c'est un fait reconnu. Il était, comme on le dit dans les cercles diplomatiques, mon numéro deux, et il aurait dû être le numéro un, car le peu que je sache des Nations Unies, je l'ai appris de Philippe, qui possède de vastes connaissances en matière de droit international et à propos des Nations Unies en particulier.
À mon avis, les principes de Nuremberg ont bien résisté au passage du temps. J'aimerais bien entendre mon ami, votre distingué collègue, M. Cotler, qui, j'en suis sûr, pourrait nous éclairer autant que moi à ce sujet. Ces principes ont résisté au passage du temps et sont toujours applicables aujourd'hui, mais, je dois vous dire, que dans certains milieux, ils sont critiqués comme étant des principes réservés aux gagnants ou, plus précisément, qu'ils représentent la justice du vainqueur. Merci, monsieur Cotler.
Cela fait partie de ce que Bismarck appelait la realpolitik. Bien sûr, une fois la guerre terminée, le vainqueur a le luxe de dire que l'ennemi avait tort et qu'il avait raison. Les criminels de guerre sont dans les rangs de l'ennemi pas dans les nôtres. Mais si les rôles sont inversés, c'est la même chose. Par contre, je persiste à croire que s'il y a des gens comme Milosevic, comme Idi Amin Dada, comme Pol Pot, comme Duvalier ou comme Saddam Hussein qui a gazé son propre peuple, qui a assassiné les Kurdes dans le Nord, qui a attaqué deux de ses voisins, l'Iran et ensuite le Koweït... Il a attaqué l'Iran avec la bénédiction des États-Unis, toutefois—ne l'oublions pas—dans les années 80.
Ces gens-là sont les dirigeants, où étaient les dirigeants, de leur pays respectif et ils devraient être punis; le principe sur lequel se fonde la Charte des Nations Unies, qui était fort valable en 1945 et respecté, selon moi, jusqu'à la fin des années 80 ou jusqu'au début des années 90—le principe de la souveraineté absolue des nations, du fait que même si le régime est dirigé par un Pol Pot ou un Idi Amin Dada, il s'agit d'une nation souveraine, d'un pays souverain, ce qui donne à son dirigeant toute liberté d'action à l'intérieur de ses frontières—ne tient plus. On est arrivé à la conclusion que ce principe n'était pas applicable dans l'ex-Yougoslavie.
Je me trouvais à New York à ce moment-là et je me souviens des débats au cours de rencontres officielles ou non— je parle surtout des rencontres de ceux d'entre nous qui sommes avocats—sur la souveraineté des nations qui, comme je l'ai dit, était l'un des principes fondateurs de la charte des Nations Unies; on se demandait alors s'il tenait toujours aujourd'hui ou si, face à des personnes comme Milosevic ou Saddam Hussein, la communauté internationale ne devrait pas mettre le hola et dire que des situations comme celle de Srebrenica—en Bosnie ou en Serbie—sont inacceptables et que toute personne responsable de ces crimes contre l'humanité, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, devrait être punie, et que, par conséquent, nous avons besoin d'une cour internationale.
À 
 (1010)
(1010)
C'est très différent du principe de Nuremberg, du chemin ayant été parcouru depuis. Ces principes sont toujours en vigueur.


Le président: Merci.
Nous allons maintenant céder la parole à M. Casey.


M. Bill Casey (Cumberland—Colchester, PC): J'aimerais poursuivre dans la foulée des questions de Mme Lalonde qui se demande si cet exercice est légal ou non. Vous avez dit d'une part que la résolution 1441 n'exprimait pas la notion de conflit militaire autorisé, mais que ce n'était pas par accident... Si je comprends bien—et peut-être pourriez-vous commenter—lorsque les États-Unis ont proposé cette résolution, elle contenait l'expression « conflit militaire », ce qui n'était pas acceptable et ils ont dû donc la retirer. Ils ont négocié pendant trois ou quatre semaines pour trouver d'autres termes.
À 
 (1015)
(1015)


M. Yves Fortier: C'est exact.


M. Bill Casey: Par conséquent, tout le monde savait que la résolution 1441 ne prévoyait pas automatiquement de conflit militaire. J'aimerais donc savoir ce que vous en pensez et je dois dire que, jusqu'ici, j'apprécie votre opinion.
Par ailleurs, pensez-vous que d'autres pays vont demander aux Nations Unies de vérifier si cette guerre est illégale?


Le président: Monsieur Fortier.


M. Yves Fortier: Pour répondre à votre première question, je dirais que vous avez raison. J'ai également fait un suivi des différentes ébauches ayant abouti à la résolution 1441, laquelle, comme chacun sait, a été adoptée à l'unanimité.
Au départ, les États-Unis voulaient inclure dans le paragraphe de conclusion une disposition disant que si Saddam Hussein ne désarmait pas, il exposerait son pays à la guerre. Finalement, on a préféré parler de «graves conséquences». C'est là qu'est la zone grise car on ne s'entend pas pour dire si les graves conséquences envisagées dans la résolution 1441, advenant le cas où l'Irak ne respecterait pas ses obligations—il faut se rappeler que cette résolution a été adoptée sous l'égide du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies—, autorisent l'ONU à... Et il ne les a pas respectées. Cela ne fait aucun doute. L'Irak a violé la résolution 1441 et les 16 autres résolutions qui l'ont précédée.
Est-ce que parler de graves conséquences sous-entend qu'on peut recourir à des moyens militaires? Pour les États-Unis et de nombreux juristes internationaux, comme je l'ai dit plus tôt à Mme Lalonde, la réponse est oui. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Cela tient les juristes occupés. Il y a toujours deux points de vue, deux opinions.
Quant à votre deuxième question de savoir s'il est possible ou probable qu'un pays revienne maintenant devant le Conseil de sécurité pour tenter de faire condamner... tout ceci n'est que baliverne. C'est rêver en couleurs. Cela n'arrivera jamais. Toutefois, ce qui pourrait arriver, c'est qu'un groupe de pays demande la tenue d'une réunion spéciale de l'Assemblée générale—et là, il n'y a pas de droit de veto—et condamnent les États-Unis. Aujourd'hui, ils pourraient le faire; mais je ne sais pas s'ils y arriveraient une fois la guerre commencée.


Le président: Monsieur Casey.


M. Bill Casey: Je suis loin d'être un spécialiste de la question, mais il me semble que toute cette affaire a été gérée avec beaucoup d'amateurisme. Il n'y a eu aucun consensus. Aucun effort n'a été déployé pour obtenir un consensus dès le début. Il est étrange que tout le monde ou presque s'entende sur le problème. Beaucoup appuient les objectifs, mais la façon dont tout a été articulé ne me paraît pas du tout professionnelle.


M. Yves Fortier: Ceci sera ma plus brève réponse de la journée: je suis d'accord avec vous.


Le président: Monsieur Casey, il vous reste une minute.


M. Bill Casey: Continuons, alors.


M. Yves Fortier: Je peux vous donner une réponse plus étoffée.


M. Bill Casey: Ce n'est pas nécessaire. Celle que vous m'avez fournie me convient.


M. Yves Fortier: Le manque de professionnalisme est à déplorer dans les deux camps. Lorsque je dis que je suis d'accord avec vous, je reconnais que la diplomatie a échoué, mais des deux côtés.


M. Bill Casey: Absolument.
C'est M. Sigler qui a parlé du Groupe de travail sur les réfugiés. Les pays arabes ne veulent pas que ce Groupe recommence ses travaux, même si cela devait permettre de régler l'un des plus graves problèmes du Moyen-Orient. Qu'en pensez-vous? Pourquoi les pays arabes ne veulent-ils pas que le Groupe de travail sur les réfugiés reparte de zéro?


Le président: Monsieur Sigler.


John Sigler: Vous demandez une réouverture du processus d'Oslo dans son ensemble. De manière générale, toutes les parties s'entendent, tant du côté israélien que palestinien, pour dire que le processus d'Oslo a échoué. Cela ne signifie pas qu'on a écarté toute possibilité de créer deux États; cela veut simplement dire que les méthodes utilisées, consistant à confier la responsabilité de la gestion des problèmes aux deux parties, ont été un échec, et ce, pour un ensemble de raisons complexes.
J'aimerais insister sur l'orientation à prendre; cela répondra partiellement aux questions de Mme McDonough sur le Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle j'ai attiré votre attention sur les travaux de l'International Crisis Group, une ONG extraordinairement prestigieuse. Son conseil d'administration compte 10 anciens chefs d'État, huit anciens premiers ministres et une dizaine d'anciens ministres des Affaires étrangères, dont Barbara McDougall. C'est une organisation extrêmement représentative; elle a mis sur pied une équipe d'experts qui s'occupent de chaque crise dans le monde et travaillent sur le terrain avec les parties concernées. Ces experts ont d'ailleurs présenté des textes d'accords que la majorité des Palestiniens et des Israéliens appuient, même en ce qui concerne la question des réfugiés.
Très franchement, ce n'est pas le problème des réfugiés qui a semé la discorde au point d'entraîner une rupture des négociations à Camp David et à Taba. En fait, les Israéliens avaient même accepté la définition des réfugiés, mais pas le droit de l'appliquer. Il a ensuite fallu composer avec la conjoncture politique, et l'OLP s'était engagée à tenir compte des problèmes démographiques d'Israël.
C'était donc une formule qui ralliait certaines personnes; il n'en demeure pas moins que d'autres continuent de se battre car elles n'ont pas aimé la façon dont les choses ont tourné. L'International Crisis Group a répondu à tous ceux qui prétendent que ces deux peuples ne peuvent pas régler leurs différends. Cela n'est pas conforme à la réalité. J'ai siégé à quelques-unes des réunions du Groupe de travail sur les réfugiés et j'ai pu observer une très grande courtoisie entre les négociateurs palestiniens et israéliens. L'idée selon laquelle ces deux peuples se haïssent et sont incapables de se parler est un non-sens.
Les travaux de l'International Crisis Group reposent sur de solides fondements diplomatiques. Fait intéressant, on n'en entend pas parler dans nos médias. Tout le monde continue de ressasser les vieilles histoires de haine et de violence quand, en réalité, les diplomates canadiens sont extrêmement efficaces dans le jeu de la diplomatie discrète—et là-dessus je rejoins l'opinion de M. Fortier. Les diplomates canadiens ne souhaitent pas qu'il y ait beaucoup de publicité autour de ce qu'ils font car leur position est politiquement controversée au pays.
À 
 (1020)
(1020)


Le président: Merci, monsieur Sigler.
Nous passons maintenant à M. Cotler.


M. Irwin Cotler (Mont-Royal, Lib.): Cette question s'adresse à M. Fortier, en sa qualité d'éminent juriste international et de diplomate.
Comme vous le savez, d'après le principe juridique international généralement reconnu de Grundnorm, l'usage de la force est interdit, à deux exceptions près, c.-à-d. si c'est pour exercer son droit à l'autodéfense en réponse à une agression armée et à la suite d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies dictée par une violation patente de la paix et de la sécurité.
J'ai abordé ces questions hier soir; malheureusement, je n'ai pas votre expérience ni votre expertise, mais je vais essayer de me rattraper.
J'aimerais revenir à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies dont vous avez parlé. Selon moi, cette résolution n'est pas auto-exécutoire. Même s'il y a eu violation patente, c'est au Conseil de sécurité de l'ONU—et non aux États-Unis, à la Grande-Bretagne ou à n'importe quel autre pays—de déterminer: a) s'il y a effectivement eu violation patente; b) si de sérieuses conséquences s'imposent; et c) si ces sérieuses conséquences incluent le recours à la force. Cela ne s'est pas produit et, de mon point de vue, cette exception ne s'applique pas.
En ce qui concerne le premier point sur le droit à l'auto-défense, je vous rappelle que le président Bush a défendu l'argument selon lequel, depuis les attentats du 11 septembre, il fallait instaurer une doctrine d'utilisation préventive de la force contre le terrorisme, les armes de destruction massive et les États voyous. Il a implicitement invoqué la doctrine de la suprématie pour justifier l'utilisation de la force par les Américains contre l'Irak.
J'aimerais que vous nous disiez de manière générale si, à la lumière des attentats du 11 septembre, nous devons changer notre interprétation du droit à l'auto-défense prévu à l'article 51, et dans quelle mesure la position adoptée par Bush est justifiée.


Le président: Monsieur Fortier.


M. Yves Fortier: Merci, monsieur le président.
Monsieur Cotler, vous venez de poser une question très judicieuse et je suis ravi d'y répondre.
Dans mon esprit, il ne fait aucun doute que ce qu'ont exprimé les États-Unis si souvent par la voix de leur président—la dernière fois c'était hier soir—s'inscrit dans le contexte de l'après 11 septembre. Nous avons tous entendu le président Bush dire hier soir que ceux qui oseraient les attaquer sont des lâches, des terroristes, etc. Il tente de justifier l'action qu'il a décidé d'entreprendre—en l'occurrence la guerre—en affirmant défendre son pays contre les terroristes, comme c'est évident, qui ont frappé les États-Unis le 11 septembre 2001.
Je n'ai pas entendu les termes utilisés—à ma connaissance, il n'y a eu aucune allusion à l'article 51 de la Charte de l'ONU—, mais on peut très bien invoquer l'argument selon lequel il s'agit bel et bien d'une guerre pouvant être menée en vertu du droit de légitime défense conféré par les Nations Unies. Ces terroristes existent; et comme le président Bush a jugé bon de le dire, Saddam Hussein a soutenu des membres du réseau al-Qaïda à l'intérieur des frontières de son pays. Par conséquent, l'Amérique doit se défendre pour prévenir tout nouvel attentat semblable à ceux du 11 septembre, d'où les mesures de sécurité accrues dans les aéroports, les ports, etc. Cela pourrait se résumer à cette simple phrase: «nous avons le droit de nous défendre».
En outre, vous devez savoir, monsieur Cotler, qu'à part la Guerre de Corée, qui a reçu l'aval des Nations Unies parce que l'ambassadeur de l'Union soviétique n'était pas dans la salle au moment du vote sur la résolution, aucun des conflits qui ont eu lieu depuis la création de l'ONU en 1945 n'a été autorisé par cette dernière.
C'est donc l'histoire qui se répète, en quelque sorte, et puis il y a ce droit de veto accordé à certains pays—vestige d'une époque révolue qui ne reflète plus la réalité géopolitique du monde d'aujourd'hui, comme nous le savons tous. Par ailleurs, les États agissent ou réagissent en fonction de leurs intérêts particuliers, et il est très improbable... Pourquoi pensez-vous que c'est l'OTAN, sous la pression des États-Unis, qui est finalement intervenue au Kosovo? Eh bien, c'est parce que les Russes ont dit clairement qu'ils n'approuveraient jamais une résolution du Conseil de sécurité, jusqu'à ce que les États-Unis aient annoncé qu'ils mèneraient l'action au Kosovo étant donné que les Européens ne pouvaient pas le faire. Cette intervention n'a pas été autorisée par le Conseil de sécurité car la Russie menaçait d'opposer son veto.
Dans le cas de l'Irak—j'ai répondu un peu plus tôt à M. Casey que c'était loin d'être une bonne manoeuvre diplomatique—, la France a dit qu'elle utiliserait son veto, quelle que soit la résolution proposée.
À 
 (1025)
(1025)


Le président: Merci, monsieur Fortier.
Monsieur Martin.


M. Keith Martin (Esquimalt—Juan de Fuca, Alliance canadienne): Je vous remercie, messieurs Sigler et Fortier, d'être ici aujourd'hui. Ce que vous dites est fascinant.
Je fais partie de ceux qui considèrent que l'invasion américaine de l'Irak aura une incidence négative sur notre sécurité et la leur, et ce, pour toutes sortes de raisons. Certes, cela va compromettre leur stabilité économique—ce qui risque d'ailleurs d'entraîner la chute de l'administration actuelle—et, par extension, il y aura des répercussions néfastes sur l'économie canadienne. Je tiens à dire également que je partage la position actuelle du premier ministre qui consiste à ne pas appuyer les Américains dans leur intention d'envahir l'Irak.
Ceci dit, comment pouvons-nous inciter les Américains à utiliser leur immense puissance pour régler les problèmes très compliqués d'émancipation politique et économique de pays où il y a un terreau favorable au terrorisme? Comment pouvons-nous aider les Américains, même s'ils ont terni leur image, à mettre leur immense pouvoir au service d'initiatives multilatérales destinées à régler sur le long terme des problèmes extrêmement complexes pour assurer notre sécurité collective?
Ma deuxième question porte sur la réforme du système des Nations Unies à laquelle M. Sigler a fait allusion.
Je crois que nous sommes aussi mal préparés pour prévenir des génocides que nous l'étions en 1939. Monsieur Fortier, vous avez rappelé avec justesse les nombreuses tragédies qui se sont succédées depuis. Il faut s'attaquer à ce problème. Comment le Canada peut-il engager d'autres pays sur la voie de la réforme du Conseil de sécurité et des IFI pour éviter que ne se reproduisent les génocides du passé?
À 
 (1030)
(1030)


Le président: La parole est d'abord à M. Sigler.


John Sigler: Pour répondre à votre dernière question, vous savez certainement que le Canada a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de cette ébauche de convention sur l'intervention humanitaire pour la protection des populations civiles. C'est une avancée cruciale. Bien sûr, ce n'est encore qu'une ébauche de traité, qui a d'ailleurs été préparée ici, à Ottawa. Il faut faire un travail de sensibilisation beaucoup plus important car le but est d'empêcher que ne se reproduise ce qui est arrivé au Kosovo, par exemple. Même s'il y avait la menace du veto russe, nous étions confrontés à une situation humanitaire critique et il fallait protéger les populations civiles. C'est ce qui a justifié l'élaboration de la nouvelle ébauche de protocole d'intervention, en dépit de toute la question de la souveraineté.
Puis on en revient à la situation en Irak. Même si certains épisodes du passé sont terribles, dans l'état actuel des choses, il n'y a rien qui permet de redouter un génocide ou un nettoyage ethnique. J'adhère absolument à l'analyse expliquant les raisons pour lesquelles la diplomatie a échoué.
Permettez-moi de m'inspirer de quelques-unes de nos remarques précédentes pour répondre à votre première question. Je doute très fortement que nous puissions réaliser le type de réforme structurelle juridique... Les institutions changent selon un processus d'ensemble, et force est de constater l'énorme accroissement de l'aide humanitaire consentie au travers des programmes de l'ONU. Ces derniers avaient la réputation d'être assez inefficaces et mal faits, mais il y a eu d'incroyables progrès depuis quelques années, particulièrement grâce à la collaboration avec des organisations non gouvernementales.
J'ai essayé de mettre l'accent sur cette nouvelle coopération qui marque certainement le rôle du Canada dans le monde actuel. Une bonne partie de notre prestige est attribuable aux résultats extraordinaires obtenus par les ONG canadiennes qui oeuvrent à l'échelle internationale. C'est vrai depuis longtemps, mais ça l'est encore plus aujourd'hui en raison de cette étroite collaboration.
Ce que je veux dire, particulièrement à la lumière de la question entourant la légalité de l'intervention américaine, c'est que je ne pense pas que le Canada s'embarquera dans cette voie. Il se centrera strictement sur l'aide humanitaire, s'occupera de régler les questions urgentes et participera à la reconstruction de l'Irak car les États-Unis auront besoin d'une coalition de pays de bonne volonté, et non pas de volontaires prêts à partir en guerre, pour faire face à la situation humanitaire dans laquelle se trouve le peuple irakien.
Vous avez pu voir que Kofi Annan a déjà mis en place un plan détaillé, élaboré par les Nations Unies, pour l'aide humanitaire. Celui-ci a d'ailleurs été critiqué par les Français car, selon eux, c'est comme si nous acceptions qu'il allait y avoir une guerre. Mais dans son esprit, ce plan était dicté par la nécessité. Vous verrez que les Canadiens joueront un rôle extrêmement actif à l'avenir, au-delà de la situation actuelle, pour tenter de faire sortir indemnes les Nations Unies de cette crise, même si ce type d'activité ne réglera pas tous les problèmes politiques entourant le Conseil de sécurité.


Le président: Merci, monsieur Sigler.
La parole est maintenant à M. Eggleton.


M. Art Eggleton (York-Centre, Lib.): Messieurs, je pense que beaucoup d'éminents juristes s'évertueront à défendre la légalité ou l'illégalité de cette guerre pendant encore longtemps. Mais en dépit de tout ce que disent les juristes, George Bush va précipiter le monde dans la guerre à moins qu'un miracle ne se produise dans les prochaines heures et que Saddam Hussein quitte l'Irak avec sa famille. Nous souhaitons tous que cela arrive, mais il ne faut pas trop compter là-dessus.
Je suis absolument d'accord avec M. Fortier lorsqu'il dit que nous avons raison d'être fiers de la position adoptée par notre gouvernement de ne pas intervenir en Irak. Je crois que M. Bush commet une grave erreur. Il s'est lancé dans une action injustifiée. Il agit sous la pression de plusieurs personnes dont a parlé M. Sigler; j'en connais d'ailleurs quelques-unes pour avoir traité avec elles à maintes occasions pendant que j'étais ministre de la Défense. Ces faucons, ainsi que plusieurs autres personnes, semblent avoir le contrôle de l'exécutif et certainement des pensées du président américain sur la question.
Vous avez également parlé de ce que pourrait faire le Canada dans un scénario d'après-guerre; permettez-moi de parler de ce qu'il faudrait faire entre-temps. En admettant que nous finissions par entrer en guerre, comment contrôlerons-nous la situation? Comment la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies pourront-ils maîtriser les événements? Il y a un risque élevé que cette guerre crée de l'instabilité dans la région et un choc de civilisations.
Le président des États-Unis a beaucoup manqué de tact au début de la campagne de lutte contre le terrorisme, en qualifiant la mission en Afghanistan de croisade. Il s'est rapidement rétracté, mais cette attitude présente des risques extrêmement élevés. D'ailleurs, je pense que lorsque les conflits de 1914 et 1939 ont éclaté, on était loin de penser que ce seraient les Première et Deuxième Guerres mondiales. Mais la situation évolue. Comment pouvons-nous empêcher qu'elle n'aboutisse à une troisième guerre mondiale? Que peut faire la communauté internationale pour garder le contrôle en sachant, malheureusement, que cette crise va se solder par un conflit armé?
Après la guerre, il y aura probablement un gouverneur militaire en Irak pendant une certaine période, comme McArthur au Japon. Qui est capable de mesurer le ressentiment et les difficultés que cela provoquera?
Il y a donc beaucoup de risques, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Mais comment pouvons-nous maîtriser la situation?
À 
 (1035)
(1035)


Le président: Monsieur Sigler ou monsieur Fortier.


John Sigler: Il s'agit d'une question extrêmement sérieuse sur les dangers immédiats. L'un de ceux qui m'a le plus inquiété émane d'une déclaration faite la semaine dernière par Michael Ledeen, de l'American Enterprise Institute, au sujet des personnages qu'il côtoie au sein de l'administration américaine.
Ledeen était le sous-secrétaire adjoint à la défense responsable de l'affaire concernant l'Iran et les Contras. Un autre scandale de l'administration américaine que Colin Powell avait fortement dénoncé à l'époque. Ledeen travaille maintenant pour l'American Enterprise Institute et il a dit qu'il s'attendait à ce que l'attaque contre l'Irak entraîne une réponse du Hesbola, de la Syrie, de l'Iran et peut-être même de la Lybie. Cela signifie que nous entrerions véritablement dans une guerre contre le terrorisme car nous devrions alors nous défendre contre un ennemi terrible réagissant à l'attaque de l'Irak. C'est le pire scénario que j'ai jamais pu imaginer car il prône l'expansion de la guerre et entretient la peur.
Vous pouvez être certains que des gens travaillent sans relâche pour éviter d'en arriver là, particulièrement au sein de la Ligue arabe, en s'assurant que la Syrie et le Liban resteront en dehors du conflit. Peuvent-ils contrôler les différents acteurs dans toute cette guerre contre le terrorisme? Des néo-conservateurs américains avancent que les États qui protègent ces groupes terroristes sont considérés comme des terroristes eux-mêmes—ce qui laisse croire que ces groupes terroristes ne sont pas autonomes.
Ce n'est pas facile de répondre à cette question. Certains États appuient ces groupes, mais il se passe d'autres choses. Dans le cas d'al-Qaïda, nous avions uniquement affaire à des talibans, lesquels ne représentent pas un État au sens strict du terme.
Mais je crois que la grande menace est celle que vous avez évoquée. Quels sont les dangers d'une escalade vers une confrontation majeure? Je pense que le Conseil de sécurité doit être extrêmement vigilant et chercher la façon d'éviter pareille situation. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse simple.
[Français]


Le président: Merci, monsieur Sigler.
[Traduction]
Nous allons maintenant entendre M. Bergeron.
[Français]


M. Stéphane Bergeron (Verchères—Les-Patriotes, BQ): Merci, monsieur le président.
Si vous me le permettez, messieurs, je vais revenir à la question du dialogue sur les affaires étrangères. C'est, je pense, l'objet du débat d'aujourd'hui, même si on peut difficilement faire abstraction des événements qui monopolisent présentement la scène internationale.
D'ailleurs, à cet égard, j'aimerais revenir sur une analyse passablement lucide que vous avez faite, monsieur Fortier, du soleil autour duquel évolue le Canada sur la scène internationale, à savoir les États-Unis.
En fait, l'un des grands défis auxquels est présentement confronté le Canada consiste à définir la marge de manoeuvre dont il dispose, en termes de politique étrangère, face à cette hyperpuissance. Cette dernière émerge du système bipolaire qui a été instauré après la Seconde Guerre mondiale. On craint que dans le contexte actuel, les États-Unis tentent de redéfinir le droit international; celui-ci s'appuyait sur ce système bipolaire pour reconnaître l'existence d'une hyperpuissance sur la scène internationale.
Il faut donc se demander quelle est la marge de manoeuvre du Canada sur la scène internationale face à cette hyperpuissance. Vous avez commencé à répondre à cette question en faisant référence à la décision de ne pas participer à l'opération qu'a prise le Canada hier. J'aimerais néanmoins que vous--et peut-être aussi M. Sigler--nous donniez votre avis, de façon plus globale, sur ce que pourrait constituer la marge de manoeuvre du Canada, ainsi que sur notre positionnement sur la scène internationale à l'égard de ce soleil autour duquel nous évoluons.
J'aimerais vous faire part d'une citation qui se lit comme suit: «En temps de paix, la politique étrangère du Canada consiste à combattre le Québec.»
On pourrait penser qu'il s'agit là d'une nouvelle élucubration découlant de la paranoïa séparatiste; or, l'auteur de cette citation n'est ni Jacques Parizeau, ni Bernard Landry, ni même Lucien Bouchard; elle est attribuable au sénateur américain Joseph Biden, qui représentait l'État du Delaware depuis 1972 au Congrès.
À mon avis, dire que la politique étrangère du Canada se résume en temps de paix à essayer d'isoler le Québec sur la scène internationale constitue une analyse pour le moins intéressante. Quelle est votre position à l'égard d'une telle affirmation alors qu'on en est à redéfinir la politique étrangère du Canada?
À 
 (1040)
(1040)


Le président: Monsieur Fortier, commencez par la première, et procédez rapidement.


M. Yves Fortier: Merci, monsieur le président.
Vous avez fait un excellent exposé en posant votre question, monsieur Bergeron. Je suis en profond désaccord avec cette déclaration du sénateur Biden, dont je connais par ailleurs certaines prises de position particulièrement remarquées aux États-Unis. Si je ne m'abuse, il a déjà été président, à une époque, du Comité des affaires étrangères du Sénat américain.
Quel est le rôle du Canada? Quelle est la marge de manoeuvre du Canada par rapport à cette hyperpuissance qui existe aujourd'hui et qui se manifeste, comme on le voit, de plus en plus? Selon moi, cette marge de manoeuvre se situe à deux niveaux.
D'abord, les États-Unis et le Canada seront toujours des pays amis, des alliés dans le sens large du mot. Entre amis, on peut avoir des différends. Hier soir, j'ai entendu M. Graham donner une excellente entrevue à CBC. On est en désaccord sur le rôle que les États-Unis viennent de s'approprier aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ait cessé d'être des amis des États-Unis. Or, entre amis, comme je l'ai dit, on peut se parler. Il a eu une conversation avec le secrétaire d'État Colin Powell, à la fin de l'après-midi, et je crois, d'après ce qui a été rapporté, évidemment, que le secrétaire d'État Powell a dit:
[Traduction]
«Nous comprenons pourquoi le Canada a adopté cette position.»
[Français]
On peut donc continuer à agir en coulisse, on peut continuer à agir aux plus hauts niveaux. Les relations entre le premier ministre et le président, les relations au niveau des ministres, au niveau des fonctionnaires, au niveau de notre ambassadeur à Washington, c'est la quiet diplomacy dont on parlait plus tôt. À mon avis, il n'y a rien qui condamne cette relation d'ami à ami. Elle va se poursuivre, j'en suis convaincu.
Il n'est pas improbable, par contre, qu'on ait un prix à payer, que ce soit dans le dossier du bois d'oeuvre ou dans celui du saumon du Pacifique, que je connais bien pour avoir négocié à ce sujet avec les Américains il y a quelques années. La mémoire de tout pays, la mémoire d'une hyperpuissance, est longue. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est difficile d'être une superpuissance, mais c'est aussi difficile de vivre avec une superpuissance, comme les 190 autres pays membres des Nations Unies l'ont constaté.
À 
 (1045)
(1045)


Le président: Merci, monsieur Fortier.


M. Yves Fortier: Je respecte la consigne.
[Traduction]


Le président: Monsieur Peterson.
[Français]


L'hon. Jim Peterson (Willowdale, Lib.): Vous avez encore 30 secondes pour répondre.


M. Yves Fortier: Merci.
Et au niveau multilatéral, là où nous avons toujours excellé, comme je l'ai dit, dans l'après-guerre, il y aura un rôle à jouer pour les Nations Unies, et le Canada va jouer son rôle pleinement, j'en suis convaincu.


Le président: Monsieur Peterson.


M. Jim Peterson: Merci beaucoup, monsieur le président.
M. Bergeron vient de voler ma question, mais je dois vous féliciter, monsieur le président, pour ces deux témoins excellents.
Ayant perdu ma question à cause de M. Bergeron, j'aimerais vous poser une question à vous, monsieur Sigler.
[Traduction]
Concernant le Moyen-Orient, quand croyez-vous que des mesures formelles seront prises entre les Israéliens et les Palestiniens en vue d'arriver à une solution plus permanente, maintenant que l'accord d'Oslo s'est avéré un échec total? En quoi consisteront ces mesures?


John Sigler: Il faut voir où en sont les discussions sur la feuille de route du quartette—formé par les États-Unis, la Russie, l'Union européenne et les Nations Unies—qui illustre de façon intéressante le travail qu'effectue la coalition dans ce domaine. Colin Powell a participé à cet effort, et Tony Blair aussi.
D'après l'International Crisis Group, cette feuille de route a ceci de problématique qu'elle doit faire l'objet de négociations entre les parties. Elle prévoit, comme première étape, la fin de la violence des deux côtés. Et quand je dis des deux côtés, je fais allusion à la question importante des attentats-suicides et de la menace qu'ils représentent, comme on a pu le constater lors des récentes élections israéliennes.
Si cette démarche revêt beaucoup d'importance à l'heure actuelle, compte tenu du discours qu'a prononcé le président vendredi dernier, c'est parce qu'on vient de nommer un nouveau premier ministre palestinien qui, en fait, a été l'architecte du processus d'Oslo. Il est en faveur depuis longtemps de la reconnaissance de l'État d'Israël, de l'établissement de relations pacifiques avec ce pays. Donc, on connaît sa position, mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est qu'il a lui-même vivement dénoncé le recours aux attentats-suicides.
Nous avons donc déjà, du côté palestinien, un leader qui peut venir à bout des craintes des Israéliens, qui soutiennent que personne ne tient compte de leurs vues. D'où l'importance du moment choisi pour présenter la feuille de route.
Or, la position du gouvernement israélien est très intéressante en ce sens qu'ils ont mis sur pied cette coalition parce que Sharon veut donner l'impression qu'il accepte la feuille de route, malgré la centaine d'amendements qu'Israël vient de présenter.
Ce que craignent les Palestiniens, c'est l'éclatement de l'accord consensuel lui-même, car si nous ne faisons que maintenir la cohésion de la coalition israélienne, qui réunit au moins deux parties qui s'opposent à la création d'un État palestinien, qui refusent qu'on mette fin à la construction de colonies, avis que partage le premier ministre... Il faut trouver un moyen de contourner cette difficulté, ce qui n'est pas une tâche facile.
On avait espéré, et les Britanniques ont beaucoup insisté là-dessus, soumettre le plan du quartette avant la tenue des élections israéliennes, pour montrer que la communauté internationale s'attachait à trouver un moyen d'instaurer une paix globale. On voulait encourager les Israéliens à élire un gouvernement qui serait prêt à collaborer avec la communauté internationale à ce chapitre.
Or, comme la Maison blanche était soumise à de fortes pressions, il a été décidé, contre l'avis de Colin Powell, que les États-Unis présenteraient la feuille de route du quartette après les élections israéliennes. Bien entendu, cela complique grandement les choses, car nous devons maintenant voir comment nous allons procéder, puisqu'il est fort probable que la mise en oeuvre de cette initiative aboutisse à une impasse en raison du gouvernement israélien.
Ce que j'essaie de dire, c'est que 70 p. 100 des Israéliens, même s'ils appuient Ariel Sharon, jugent ses politiques inefficaces. Ils sont en faveur de la conclusion d'un accord de paix global, pourvu qu'on arrive à trouver des partenaires crédibles de l'autre côté. Voilà pourquoi on a tellement insisté pour qu'il y ait un changement au niveau du leadership palestinien.
Il y a donc de l'espoir, mais aussi des obstacles politiques persistants, chose à laquelle vous êtes vous mêmes habitués.
À 
 (1050)
(1050)


M. Jim Peterson: Merci.
Monsieur Fortier, quand vous étiez...


Le président: Monsieur Peterson, votre temps est écoulé.
Je tiens tout simplement à vous dire que nous avons deux motions à examiner, et que nous devons quitter la salle 15 minutes avant la fin de la réunion, soit à 11 heures, car le Comité de l'environnement doit s'y réunir.
Je vais d'abord lire les deux motions, qui sont très simples, et je vais ensuite demander à Mmes Redman et McDonough et à M. Martin de poser des questions très brèves, sans aucun préambule. Nous entendrons ensuite les réponses.
Les deux motions sont les suivantes : que le comité soit l'hôte d'un déjeuner de travail pour le vice-ministre de la République du Panama, le 18 mars 2003; et que le comité tienne un petit déjeuner de travail avec une délégation australienne dirigée par le président de la Chambre des représentants, soit le lundi 31 mars, soit le mardi 1er avril.
Des voix : D'accord.
Le président : Nous allons maintenant entendre les trois questions, sans aucun préambule.
Madame Redman, vous avez 30 secondes.


Mme Karen Redman (Kitchener-Centre, Lib.): Merci, monsieur le président.
Ma question est très simple. Dans quelle mesure le dossier de l'Irak mine-t-il la crédibilité de l'ONU, et quels changements doit-on apporter à l'Organisation pour qu'elle continue de jouer un rôle efficace à l'échelle internationale?


Le président: Nous allons maintenant entendre la question de Mme McDonough.


Mme Alexa McDonough: Vous avez évoqué, plus tôt, la possibilité de tenir une assemblée générale. Il a également été question d'organiser une initiative en faveur de la paix, selon la formule ou le modèle de Pearson. À votre avis, est-ce qu'une telle initiative serait souhaitable? Quels en sont les avantages et les inconvénients?


Le président: Monsieur Martin.


M. Keith Martin: Monsieur Fortier, étant donné que le comité n'arrive même pas à rencontrer des membres du Congrès quand il se rend aux États-Unis, existe-t-il un mécanisme qui nous permettrait, en fait, d'avoir des échanges constructifs, en tant que représentants élus, avec nos homologues américains?


Le président: Nous allons maintenant passer aux réponses.


M. Yves Fortier: Peuvent-elles être aussi brèves que les questions?
Madame McDonough, vous avez parlé de l'impact qu'a ce dossier sur l'ONU. L'Organisation a été jugée inutile à bien des reprises depuis la ratification, en 1945, de la Charte des Nations Unies.
À mon avis, l'ONU va être en mesure de surmonter le fait qu'on ait contourné le Conseil de sécurité. C'est une institution très solide, une institution que la communauté internationale... je n'aime pas cette expression. Qu'est-ce qu'on entend par «communauté internationale»? C'est une institution dont le monde a plus que jamais besoin. Il faudra, plus que jamais, recourir, faire appel, à la diplomatie multilatérale. L'ONU saura relever le défi.
Certains changements s'imposent au niveau de la composition du Conseil de sécurité, des membres permanents. J'ai quitté les Nations Unies il y a 11 ans. Je faisais partie d'un comité qui allait décider des changements à apporter au Conseil de sécurité. Douze ans plus tard, ce comité existe toujours.
Si vous voulez, par exemple, retirer à la France ou au Royaume-Uni le droit de veto qu'ils possèdent, vous devez soumettre la question au Conseil de sécurité—et ils ont un droit de veto. Peut-être pas demain... mais les Nations Unies sauront relever le défi, à mon avis.
Pour ce qui est de l'initiative en faveur de la paix—je m'excuse; j'espère avoir répondu à votre question. En ce qui concerne l'assemblée générale, cela dépend de la question de savoir s'il y a guerre ou pas. À mon avis, aucune réunion ne sera convoquée avant le début des hostilités.
La troisième question porte sur rôle des représentants élus. Il serait très présomptueux de ma part de répondre à la question. Je suis certain que vous jouez un rôle actif et que vous pouvez faire beaucoup à titre de particulier et en tant que comité. Votre comité est un microcosme du Canada. Il est important que tous les points de vue représentés ici soient clairement expliqués aux Canadiens, que le gouvernement explique clairement les décisions prises par le comité aux Canadiens et aux représentants en poste à Washington.
M. Sigler a parlé plus tôt de l'influence qu'exercent les ONG en général et en particulier. Ce qui m'a étonné, entre autres, à mon arrivée aux Nations Unies, c'est de voir à quel point les organisations non gouvernementales canadiennes sont respectées, l'influence qu'elles exercent. Bien entendu, je ne dis pas que ce comité-ci est une ONG. Mais le comité pourrait très bien parler au nom de certaines de nos ONG les plus influentes.
C'est incroyable, absolument incroyable. Je dois admettre que je me posais des questions au sujet de l'utilité des ONG. J'ai effectué un virage à 180 degrés—pas à 360, comme le laissent entendre certains de mes amis—quand j'ai vu à quel point les ONG canadiennes étaient influentes et que leurs vues étaient bien accueillies par l'ONU.
À  (1055)
(1055)
[Français]

Le président: Merci beaucoup, M. Fortier. Merci beaucoup, M. Sigler.
[Traduction]
Merci à tous les deux d'être venus nous rencontrer.
[Français]
Je pense que cette participation fut très appréciée par tous mes collègues. Encore une fois, merci beaucoup.
La séance est levée.