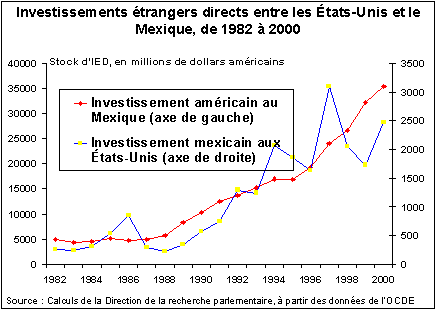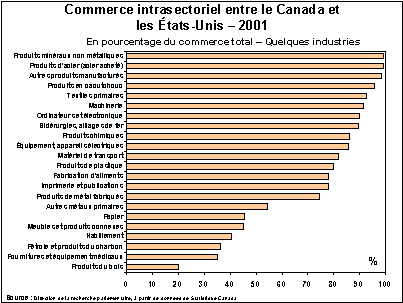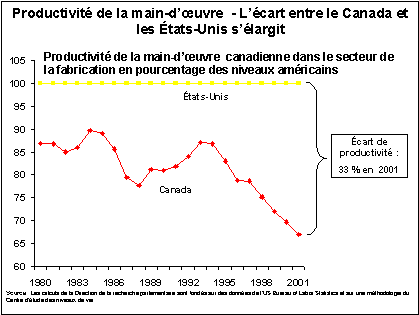FAIT Rapport du Comité
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
CHAPITRE 2 : COMPRENDRE UNE AMÉRIQUE DU NORD EN ÉVOLUTION Il y aura toujours des aspects que les États-Unis, le Canada et le Mexique aimeraient mieux ne pas avoir en commun, mais même alors l’Amérique du Nord demeurera une trinité réticente, dont les membres seront toujours ensemble, quoique pas toujours du même avis. Nos avenirs sont inextricablement liés, que nous le voulions ou non. Anthony DePalma, Le Canada est un pays nord-américain, géographie oblige. À cette réalité s’ajoutent, surtout en ce qui concerne les États-Unis, une amitié, des alliances et un partenariat de longue date, comme le président John Kennedy l’a si bien souligné dans une allocution devant le Parlement canadien en 19611. Comme nous le disons dans le chapitre 1, toutefois, rien n’est nécessairement « manifeste » (c.-à-d. prédestiné ou interdisant toute possibilité de choix) dans la trajectoire des relations du Canada avec son puissant voisin, ou encore dans l’évolution future d’une région nord-américaine post-ALENA comportant des relations plus intégrées, y compris avec le Mexique. Certes, nous partageons un continent, mais c’est au Canada et aux Canadiens de décider de la façon dont nous le partageons. Depuis que le Canada existe, la place qu’il occupe au sein de l’Amérique du Nord fait l’objet de débats2. Pourtant, l’entrée dans un nouveau siècle marque peut-être une phase nouvelle et beaucoup plus complexe dans une évolution qui a été longue, incertaine, voire « ambivalente ». Donc, où va le Canada dans une Amérique du Nord en changement? Savons-nous quel Canada nous souhaitons dans le contexte de l’Amérique du Nord que nous souhaitons? Ou bien, ne faisons-nous que commencer à nous poser ce genre de questions, même si les formidables liens économiques que nous entretenons avec nos partenaires de l’ALENA éclipsent pratiquement toutes nos autres relations commerciales et financières? Comme le déplore le journaliste américain Anthony DePalma, qui s’est fait « biographe » de notre continent : « Nous savons que l’Amérique du Nord existe, mais nous ne la connaissons pas ». Pourtant, un peu plus loin, il a affirmé : « Le commerce de la drogue, le commerce international, l’immigration, les échanges culturels, les communications de masse, une défense partagée, tout cela sont des liens qui transcendent nos frontières et qui nous entraînent inévitablement vers l’intégration de l’Amérique du Nord en une seule entité continue3 ». Ce raisonnement audacieux a été émis avant le 11 septembre 2001. À n’en pas douter, les impératifs communs aux Nord-Américains en matière de protection contre le terrorisme s’ajouteraient aujourd’hui à cette liste. La plupart des Canadiens, toutefois, soutiendraient certainement que la recherche d’une relation plus étroite entre partenaires nord-américains, sur la base de certains intérêts mutuels concrets, ne se compare pas à la voie hautement institutionnalisée d’une intégration, politique tout autant qu’économique, où se sont engagés les États de l’Union européenne. Pour la plupart des Canadiens, la perspective d’une union analogue en Amérique du Nord semble peu probable, même à long terme4. Sur un continent au paysage très varié, où d’évidentes asymétries démarquent les partenaires, l’avenir des relations demeure incertain. Comme le reconnaît un récent rapport de recherche sur les éventuels scénarios d’une intégration nord-américaine, projet réalisé avec le soutien du gouvernement, et comme les témoignages entendus par le Comité l’ont confirmé, il est également possible d’envisager un déroulement inverse, à savoir l’affirmation d’un multilatéralisme plus large, une prise de recul du Canada par rapport aux partenariats nord-américains ou l’échec des options visant une intégration plus profonde. Les perspectives les plus vraisemblables, toutefois, semblent annoncer le maintien d’un statu quo principalement bilatéraliste, peut-être sous une forme améliorée, ou d’une institutionnalisation plus poussée, quoique probablement assez limitée, des relations nord-américaines trilatérales5. Au chapitre 5, le Comité reviendra sur les aspects de ces options, qui reposent sur des conjectures, et notamment sur les appels à l’édification d’une « communauté nord-américaine » trilatéraliste, entre autres sur la thèse défendue devant nous par divers universitaires comme Robert Pastor6, ainsi que sur la « vision nord-américaine » préconisée par les hauts représentants du gouvernement Fox et d’autres responsables mexicains. Pour l’instant, nous désirons concentrer notre attention sur la compréhension de certaines des principales caractéristiques du paysage empirique nord-américain. Nous nous reportons aussi aux enquêtes récentes menées dans les trois pays sur les attitudes du public, qui continueront d’influer sur le contexte dans lequel le Canada établira ses politiques, que l’une ou l’autre de ces visions futuristes de l’intégration se réalise ou non.
Comme l’indiquent le profil socioéconomique de la région, dans l’encadré 1, et l’exposé approfondi sur le nouvel espace économique nord-américain, dans la partie B du présent chapitre, l’intensification des liens économiques qui rattachent le Canada, les États-Unis et le Mexique est manifeste. De fait, dès la fin des années 1990, les échanges internationaux dépassaient les échanges interprovinciaux dans huit des dix provinces canadiennes7, et le volume des échanges du Canada dans l’ALENA est maintenant le double de celui du commerce interprovincial. Le Mexique est devenu encore plus dépendant commercialement à l’égard des marchés américains que le Canada et d’une façon encore plus asymétrique. Au cours de la dernière décennie, ces liens croissants se sont en outre accompagnés de plans d’action gouvernementaux qui, à quelques exceptions protectionnistes près, ont largement soutenu une libéralisation des flux de biens, de services, d’investissements et de capitaux, sinon de travailleurs, dans l’ensemble de l’économie continentale. Les effets plus larges de ces tendances économiques nord-américaines sont variés et difficiles à désagréger, notamment par rapport aux facteurs plus généraux tels les restrictions gouvernementales destinées à l’élimination des déficits budgétaires, l’évolution technologique ou d’autres forces de la « mondialisation ». En évaluant les gains et les pertes nets, William Kerr, de l’Estey Centre a également souligné que « tout effort majeur de libéralisation des échanges commerciaux tel l’ALENA implique un processus d’ajustement extrêmement long8 ». Les tenants, de même que les détracteurs, des accords commerciaux critiquent la performance socioéconomique du Canada depuis l’entrée en vigueur de ces instruments. Par exemple, Jayson Myers est d’avis que le Canada est « un marché qui s’est encore appauvri au cours des dix dernières années du fait du déclin du revenu réel par habitant et de la dépréciation du dollar […]. Le Canada court le risque de devenir une économie plus marginalisée en Amérique du Nord9 ». Quant aux porte-parole du monde du travail et aux membres de la société civile qui réprouvent les accords de libre-échange, ils soutiennent souvent que la productivité promise et les augmentations réelles de salaires ne sont guères évidentes. Par ailleurs, Teresa Cyrus a cité des recherches selon lesquelles l’exposition à la concurrence commerciale semble n’avoir guère pesé sur la hausse des niveaux de pauvreté ou sur les inégalités de revenu10. Les données fiables sont souvent difficiles à trouver ou sont contestées quant à leur interprétation, même pour ce qui concerne les effets économiques de l’ALENA. Il n’est guère étonnant donc qu’un analyste canadien, dans un examen critique à paraître bientôt, juge les effets sociaux à large échelle de l’ALENA difficiles à mesurer et demande que les affirmations promotionnelles émanant des pouvoirs publics soient contrebalancées par d’autres observations moins rassurantes11. Il demeure nécessaire de faire mieux comprendre les conséquences réelles d’une éventuelle intégration nord-américaine, en tenant compte, dans les trois pays, de toute une série d’inquiétudes du public à cet égard. Comme on le voit dans l’encadré 1, les trois pays d’Amérique du Nord ont enregistré une hausse progressive de leurs indicateurs du « développement humain » depuis l’enclenchement du libre-échange. Toutefois, les disparités relatives posent toujours des problèmes sur le plan des politiques, alors que le Mexique dans son ensemble affiche un niveau de vie de beaucoup inférieur à ceux du Canada et des États-Unis. D’après des résultats de recherche présentés au Comité par Mario Polèse, certaines parties de l’Amérique du Nord sont mieux placées que d’autres pour tirer profit de la libéralisation des liens économiques continentaux; par exemple, à l’intérieur du Canada, l’Ontario a raffermi sa position économique dominante, tandis qu’au Mexique, il existe une forte démarcation nord-sud12. Bien entendu, les disparités régionales et sociales persistantes sont, pour les gouvernements, un défi à l’élaboration de politiques capables de répondre correctement aux effets à la fois cumulatifs et inégaux des changements économiques qui surviennent en Amérique du Nord. Un défi trilatéral commun se pose aussi; ce point sera abordé plus en détail au chapitre 5. À ce jour, toutefois, les trois pays ont eu très peu de discussions de fond à cet égard. Le sentiment d’un « projet de société » nord-américain partagé est encore moins apparent, en dépit du débat mené au cours des négociations de l’ALENA au sujet de l’adjonction d’une éventuelle « dimension sociale » à l’accord et des appels de l’actuel président du Mexique, Vicente Fox, en faveur d’une « vision » plus vaste du développement de l’Amérique du Nord. Même entre le Canada et les États-Unis, les niveaux élevés et croissants d’interdépendance économique ne semblent pas avoir entraîné autant de convergences sur le plan des politiques qu’on aurait pu le croire, l’espérer ou le craindre13. En ce qui concerne les attitudes et les sentiments du public au sujet de l’identité nationale, nous nous trouvons là aussi devant un tableau compliqué et souvent ambigu, si l’on en croit la multitude de sondages menés auprès de groupes d’opinion canadiens, américains et, dans une moindre mesure, mexicains, en particulier depuis le 11 septembre 2001. Parfois, ces « instantanés » de l’humeur publique ajoutent plus de confusion que de clarté. Néanmoins, selon l’une des conclusions les plus fréquentes, dans les trois pays, une majorité de gens semblent de plus en plus réceptifs à l’idée de relations économiques plus étroites (malgré une ambivalence persistante quant à savoir à qui profitent les accords comme l’ALENA); cependant, la plupart des citoyens tiennent au maintien des différences à l’égard des valeurs nationales des pays respectifs ainsi que de leurs identités politiques distinctes. Ce type de conscience nationale semble en tout cas caractériser l’opinion publique générale au Canada et pourrait même s’être accentuée, même si les élites du secteur privé tendent de plus en plus à favoriser une intégration continentale14. Une analyse actualisée émanant de World Values Survey, où sont comparées des données de 2002 et de 1990, montre que le soutien des répondants canadiens à l’égard de liens économiques plus serrés avec les États-Unis a augmenté (de 71 % à 79 %), tout comme l’adhésion à un « effacement de la frontière » (de 24 % à 35 %). Toutefois, les éléments recueillis montrent également une association positive entre un appui à l’égard de liens économiques plus serrés entre le Canada et les États-Unis et « des niveaux plus élevés de fierté nationale canadienne ». Cette constatation pousse Neil Nevitte à conclure que ce point de vue, ainsi que les opinions diversifiées sur les valeurs distinctives et les craintes au sujet de la culture, font de l’intégration politique une perspective peu alléchante pour la plupart des Canadiens. Il faut donc, à tout le moins, éviter toute hypothèse hâtive voulant que ce destin soit en fait une « pente dangereuse » qui deviendra la conséquence inévitable d’une intégration économique plus poussée15. Les données recueillies dans le cadre d’un vaste projet de recherche sur l’opinion publique, mené dans les trois pays par les Associés de recherche EKOS, telles que publiées en juin 2002, lors d’une conférence sur l’intégration nord-américaine, indiquent à la fois des tendances à la divergence et à la convergence (ce qui, dans une perspective historique, n’est peut-être pas étonnant16). Voici à ce sujet quelques exemples tirés des conclusions de cette enquête trinationale unique, telles que présentées par le président d’EKOS, Frank Graves17 :
Plusieurs sondages de l’opinion canadienne au sujet des relations continentales ont été menés plus récemment par le Centre de recherche et d’information sur le Canada (CRIC) en marge des conférences « BorderLines », axées sur l’avenir des relations entre le Canada et les États-Unis18. On y apprend que de nombreux Canadiens souhaitent que notre pays adopte une approche indépendante dans les affaires nationales et internationales et s’opposent à une « américanisation » des politiques canadiennes. Comme l’a déclaré Andrew Parkin, directeur adjoint de la recherche du CRIC : L’analyse de ces données indique que les Canadiens ont le sentiment d’avoir des valeurs et des politiques publiques différentes de celles des Américains et que cette différence mérite d’être préservée [...]. Toutefois ce n’est pas là une manifestation d’antiaméricanisme. Les sondages indiquent aussi que les Canadiens souhaitent une coopération étroite avec les États-Unis dans les domaines de l’économie et de la sécurité de l’Amérique du Nord. Ce que cela signifie, très simplement, c’est que les Canadiens tiennent à leur différence et souhaitent préserver leur indépendance19. Pour ce qui a trait à la coopération économique entre le Canada et les États-Unis, la dernière étude du CRIC, menée par les maisons de sondage CROP et Environics en septembre et octobre 2002, indique que 63 % des répondants canadiens sont favorables à une circulation libre des travailleurs à travers la frontière, et que 53 % pensent qu’une monnaie commune avec les États-Unis serait une bonne chose, même si une majorité s’oppose à l’adoption du dollar américain. Globalement, le soutien manifeste des Canadiens à l’égard d’un resserrement des liens économiques doit être envisagé dans le contexte d’un souci constant pour la souveraineté et d’un solide attachement aux valeurs proprement canadiennes. Voici comment Andrew Parkin résume ces constatations : Les Canadiens sont favorables à une coopération économique avec les États-Unis même au point de favoriser un marché transfrontalier de l’emploi ou une monnaie commune, deux mécanismes déjà en place dans l’Union européenne. Cependant, ils ne souhaitent pas l’adoption du dollar américain ni l’harmonisation des politiques bancaires et fiscales. De plus, ils récusent l’exportation massive d’eau, car ils considèrent les réserves d’eau douce du Canada comme une précieuse richesse qui n’est pas à vendre. Les Canadiens souhaitent que le Canada poursuive sa coopération économique avec les États-Unis, sans renoncer à son indépendance et sans compromettre sa spécificité la plus caractéristique20. Selon d’autres données récentes recueillies par le Centre de recherche et d’information sur le Canada, l’effet du 11 septembre sur les attitudes des Canadiens avait diminué un an plus tard. Si seulement 13 % des Canadiens interrogés souhaitaient des liens plus lâches avec les États-Unis immédiatement après les attentats, cette proportion était revenue à 35 % en septembre 2002, tandis que seulement 28 % souhaitent des liens plus serrés. Des majorités allant d’un plancher de 60 % en Ontario à un plafond de 80 % en Saskatchewan voient également les États-Unis comme tirant plus d’avantages du commerce bilatéral, ce qui à n’en pas douter traduit le mécontentement issu des actuels points de friction. De même, près des trois quarts considèrent que le Canada offre une meilleure qualité de vie que les États-Unis, cet avis étant le fait surtout des jeunes Canadiens21. Bref, quelles devront être les prochaines étapes du partenariat nord-américain? La réponse est loin d’être évidente, et certainement pas automatique ou « inévitable », au vu de tendances aussi fluctuantes et, parfois, conflictuelles. Selon le Comité, il faut y voir moins un problème que l’occasion de façonner l’avenir en conformité avec les valeurs et les intérêts de la population canadienne. Il y a là, en effet, une possibilité d’élaborer les politiques de manière à rattraper les facteurs dynamiques des liens transfrontaliers croissants, dans un contexte difficile, que les universitaires spécialistes des affaires internationales et les observateurs des relations Canada-États-Unis décrivent comme un climat d’« interdépendance complexe » asymétrique22. C’est aussi une possibilité qui vient renforcer le raisonnement présenté au chapitre 1 au sujet des options qui s’offrent encore au Canada, quant aux choix politiques qui seront certainement nécessaires pour s’adapter à une Amérique du Nord en évolution. L’avenir de l’Amérique du Nord selon le point de vue des témoins Au cours d’une de nos premières tables rondes, George Haynal, ancien sous-ministre adjoint (Amériques) au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a répondu comme suit à sa propre question « Mais qu’est-ce que l’Amérique du Nord? » : À ce stade, l’Amérique du Nord se compose de trois pays hautement différents : la puissance mondiale dominante, une démocratie industrielle de taille moyenne à l’avant-poste du monde moderne et un grand pays en développement, dynamique et émergent. Ces trois pays ont entre eux quatre types de relations, certaines plus développées que les autres. Deux d’entre elles, qui sont organiques et ont des racines historiques et un rôle énorme, sont celles entre le Canada et les États-Unis et entre les États-Unis et le Mexique. Quant à l’autre, entre le Canada et le Mexique [...], elle est actuellement en cours d’édification selon des modalités particulièrement ingénieuses. La dernière […] est la relation trilatérale, dont l’aboutissement pourrait être une forme de communauté nord-américaine23. Cet énoncé résume clairement la situation passée et actuelle de relations nord-américaines triplement bilatérales et trilatérales, comme prologue aux possibilités futures de la relation nord-américaine dans son ensemble. Le Comité examinera en détail la promesse des relations Canada-Mexique et des relations trilatérales au chapitre 5. Mais, pour l’heure, soulignons que l’ampleur de cette promesse dépend largement, en premier lieu, de l’effort que les Canadiens sont disposés à déployer pour réaliser le plein potentiel de ces relations nord-américaines à niveaux multiples. Il n’est guère étonnant que certains détracteurs et sceptiques de l’intégration nord-américaine se soient montrés impatients devant ces arguments. Rod Hill a déclaré : « Je ne vois aucune raison pour que nous commencions à nous considérer comme des Nord-Américains. […] c’est là une mentalité intégrationniste. […] Où est passé l’internationalisme pearsonien? » Pour faire bonne mesure, il a ajouté : « Ce n’est pas parce que le Mexique se trouve sur le même continent que nos relations doivent être spéciales. Je pense que nous devrions nous considérer comme des citoyens du monde plutôt que de promouvoir l’idée que nous sommes en quelque sorte des Nord-Américains, car ce n’est pas le cas24 ». David Orchard s’est appuyé sur des doléances déjà anciennes pour défendre un rejet agressif d’un rapprochement Canada-États-Unis. Toute autre attitude serait une « reddition » a-t-il affirmé25. D’autres, plus ouverts à la perspective d’un partenariat nord-américain, ont toutefois fait des mises en garde quant aux fins et aux moyens de sa construction. Pour Stephen Clarkson, « Il ne fait aucun doute que l’intégration nord-américaine — et par conséquent la place du Canada dans la nouvelle architecture continentale — est la grande question d’actualité en matière de politiques ». Toutefois, conclut-il : « Nous devons reconnaître que le seul objectif légitime du gouvernement consiste à améliorer, et non à réduire, la qualité de vie des Canadiens — et selon des conditions définies par nous, et non pas par l’Oncle Sam26. » Laura Macdonald considère que beaucoup d’arrangements restent mal définis, malaisés et incomplets, soutenant que nous devons nous demander non seulement ce qu’est l’Amérique du Nord mais « quel type d’Amérique du Nord » nous souhaitons. Comme elle l’a expliqué : L’Amérique du Nord est une région qui a poussé de façon spontanée sans qu’une réflexion sous-tende son tracé futur, son architecture, si vous voulez. […] avant le 11 septembre, on s’inquiétait au Canada du déclin apparent de l’importance qu’a le Canada à Washington avec l’arrivée au pouvoir de gens du Sud-Ouest des États-Unis, de la croissance du nombre d’électeurs latinophones et du regain d’importance du Mexique dans la politique étrangère et dans la vision mondiale qu’ont les États-Unis du monde. Nous croyions constater une détérioration de la relation privilégiée et de l’instauration d’un difficile partenariat nord-américain. Je dis difficile du fait de la jalousie mutuelle des deux partenaires subordonnés, le Canada et le Mexique, qui rivalisaient entre eux pour s’attirer l’attention et l’affection des États-Unis. Comme nous le savons, tant le Canada que le Mexique ont conclu des accords de libre-échange avec les États-Unis pour avoir un accès privilégié à l’économie américaine et ne souhaitaient pas partager ces avantages entre eux27. Si, aux yeux de Laura Macdonald, l’ALENA a fini par entraîner les relations Canada-Mexique dans l’assemblage, elle estime ce qui suit : Les étapes précédentes de l’intégration nord-américaine se sont caractérisées par une représentation inadéquate de larges secteurs sociaux, d’où une hostilité contre-productive et une confrontation entre le gouvernement, le secteur des affaires et la société civile. Je crois donc que toute étape ultérieure vers l’intégration devrait s’accompagner d’un dialogue constructif comme, en fait, l’a entrepris ce comité et peut-être même d’une révision de certains éléments de l’ALENA, comme le chapitre 11, un point que la majorité de la société civile juge épineux. Le Canada devrait également appuyer l’établissement de liens entre les membres de différents secteurs de la société civile, comme ceux des femmes et des Autochtones, à travers les trois pays28. Parmi les tenants de liens nord-américains forts, certains envisageaient la question surtout, sinon exclusivement, sous l’angle canado-américain. Reginald Stuart, par exemple, a évoqué un patrimoine juridique partagé et « une culture largement commune », qui a débouché sur « deux versions […] complémentaires de la culture nord-américaine ». Il voit également les relations nord-américaines comme des « relations dispersées », définies « non seulement comme des relations d’État à État, mais aussi de provinces à État, […] comme des attaches régionales, et aussi comme un tissu de liens entre les gens, les cultures, les valeurs et les sociétés29 ». En ce qui concerne la négociation des accords nord-américains, Michael Hart estime que le Canada devrait axer principalement son attention et ses efforts sur sa relation avec les États-Unis et remettre à plus tard les éventuelles démarches trilatérales. Il a dit : Je ne pense pas que le facteur Mexique doive nous dissuader d’aller de l’avant. Les États-Unis ont une attitude différente à l’égard du Mexique. Celui-ci n’a pas réagi de la même façon aux événements du 11 septembre. Certes, nous avons un accord nord-américain commun, mais le Canada et les États-Unis ont bien des choses en commun que le Mexique ne partage pas, et de même le Mexique et les États-Unis ont de nombreuses choses en commun que ne partage pas le Canada. Il est donc essentiel pour l’instant que les deux États qui, avec les États-Unis, constituent l’Amérique du Nord aillent de l’avant en parallèle plutôt qu’à l’unisson. Plus tard, ils pourront déterminer s’ils ont suffisamment d’intérêts pour justifier une démarche commune30. Le Comité reviendra sur ces questions au chapitre 5. Pour l’instant soulignons que cette suggestion d’un double bilatéralisme en quelque sorte, ou d’une « Amérique du Nord à deux vitesses » comme l’a décrite Christopher Sands dans son témoignage de l’automne dernier31, est conforme à notre sentiment quant à la façon dont les pouvoirs publics de Washington transigent encore séparément avec leurs partenaires nord-américains. Dans certains milieux, on se rend compte que certains dossiers prennent une dimension de plus en plus nord-américaine et qu’il faudrait peut-être instaurer des mécanismes ou des organismes pour les gérer. Mais, à en juger par les rencontres que nous avons eues dans la capitale des États-Unis, pour l’instant, les Américains n’ont guère considéré de façon active, et encore moins mis en pratique, les éventuelles ambitieuses orientations trilatérales de l’Amérique du Nord réclamées notamment par Robert Pastor, ancien haut-fonctionnaire de l’Administration Carter. Ce désintérêt des pouvoirs publics américains contraste nettement avec les messages que nous avons reçus à maintes reprises de nos interlocuteurs mexicains de tous niveaux, y compris de certains membres du Congrès mexicain et de son comité sénatorial responsable de l’Amérique du Nord. Les Mexicains reconnaissent que l’intégration de l’Amérique du Nord n’a pas de « forum politique » et manque peut-être aussi d’une formulation claire et d’un objectif commun. Selon Mme Guadalupe González, du Centro de Investigación y Docencia Económicas, l’Amérique du Nord étant une « région en devenir », où l’on dénote des opinions sociales diverses et une double inquiétude, induite par la vulnérabilité des uns et des autres à l’égard du pouvoir américain, « il n’existe pas de vision unique de l’avenir de l’Amérique du Nord […ou du] type ou modèle d’intégration qui est réalisable et souhaitable32 ». Toutefois, les témoins mexicains, à l’unanimité, ont dit souhaiter une relation plus serrée avec le Canada, laquelle selon eux supposerait une démarche trilatérale plus fructueuse. Pendant les audiences que nous avons tenues au Canada, les témoins ont à plusieurs reprises appelé à une vision intégrée et à long terme de l’Amérique du Nord. Brian Stevenson, de l’université de l’Alberta, a conclu comme suit son intervention : « Même si nous profitons énormément de nos bonnes relations bilatérales avec les États-Unis, nous sommes également très vulnérables à cause de ces dernières. Notre prochaine étape devrait être de transformer les trois relations bilatérales en une communauté nord-américaine. C’est dans notre intérêt national33 ». Stacey Wilson-Forsberg et Donald MacKay, de la Fondation canadienne pour les Amériques (FOCAL) ont souligné que « le point faible évident du Canada est celui de la méconnaissance du Mexique, et ce, malgré le fait qu’il existe plusieurs personnes et institutions qui sont versées en la matière. C’est peut-être dû en partie à cette lacune qu’il a été si difficile de considérer le Mexique dans nos discussions sur l’Amérique du Nord. C’est pour cette raison que le modèle d’intégration à deux vitesses gagne du terrain au Canada et nous pensons qu’il peut s’avérer particulièrement inquiétant34 ». Stephen Blank, professeur à la Pace University de New York, a également rappelé au Comité qu’une importante intégration économique « de bas en haut » était déjà en cours avant les accords de libre-échange, qui pour lui ont été conclus par suite de « changements de l’environnement économique qui s’étaient déjà produits ». Plus l’ALENA réussit et plus les liens économiques s’intensifient à l’intérieur de ce qui est, en fait, une « communauté économique nord-américaine », plus la contradiction est grande avec un « système de gouvernance réduit à sa plus simple expression » à l’échelon nord-américain. Il y voit le défi suivant : « Le grand projet nord-américain qui nous attend, dans lequel les intérêts du Canada peuvent et doivent être maximisés, est la formation d’une alliance appuyant l’avènement d’une communauté nord-américaine ». Il voit là non pas un grand dessein axé sur l’homogénéisation, mais une entreprise de participation à la fois publique et privée, à plusieurs niveaux et fondée sur les intérêts de tous. Non, je n’envisage pas une identité nord-américaine à l’avenir. […] Nous devons plutôt viser à établir une conception qui reconnaisse les intérêts que nous partageons, à titre d’Américains du Nord, pour un système économique continental plus libre, dans le cadre d’une infrastructure économique efficace appuyant ce système, et qui comporte l’engagement d’intégrer tous les citoyens pour que chacun profite de la participation à cette communauté nord-américaine. Nous partageons des intérêts. Je ne crois pas que l’identité soit en cause35. Guy Stanley, de l’université d’Ottawa, estime lui aussi que les Canadiens se doivent « d’élaborer une stratégie nord-américaine faite au Canada ou, plus précisément, un projet de société nord-américaine. Le Canada est particulièrement bien placé pour le faire, mais nous ne l’avons pas fait. C’est surtout le Mexique qui a pris l’initiative ». Il a ajouté : « Certains peuvent hésiter à avancer dans cette direction, par crainte de la standardisation, c’est-à-dire l’adoption de normes que nous n’accepterons pas volontiers. Bien au contraire, le fait d’établir un cadre clair de gestion nord-américain protégerait la diversité et lui permettrait de mieux s’épanouir qu’à l’heure actuelle36. » Placer le Canada en position de mieux réagir Les détracteurs de l’intégration nord-américaine pourront difficilement être convaincus des mérites d’une intégration plus poussée ou plus large. Mais la plupart d’entre eux reconnaîtraient sûrement que les décideurs canadiens doivent avoir accès aux meilleures sources de données qui soient afin d’être dans une position aussi solide que possible pour analyser les grandes tendances et réagir aux multiples faits nouveaux qui surviennent en Amérique du Nord et influent sur les intérêts et les valeurs du Canada. L’une des grandes idées du présent chapitre est que toute complaisance à cet égard affaiblira la capacité du Canada de choisir, quels que soient les objectifs que les Canadiens souhaitent voir leurs gouvernements atteindre dans un contexte nord-américain en évolution rapide. Certes, ce contexte est dominé par la puissance des États-Unis, mais il est très hétérogène et il comporte également le Mexique, pays dynamique et en évolution rapide, qui compte déjà plus de trois fois la population du Canada. Des travaux visant à amplifier la base de connaissances du Canada sont déjà en cours. C’est le cas, par exemple, du Projet de recherche sur les politiques (PRP) appuyé par le gouvernement fédéral et son volet sur les Liens nord-américains. Ces travaux sont axés en grande partie sur les conséquences, du point de vue des politiques publiques canadiennes, d’un espace économique nord-américain de plus en plus intégré37. Et comme Janine Ferretti, alors directrice exécutive de la Commission nord-américaine de coopération environnementale de l’ALENA, à Montréal, a déclaré au Comité : « Je pense que nos trois pays ont besoin d’information pour mieux comprendre la réalité, les priorités, les tendances et les défis de l’Amérique du Nord38. » À ce sujet, Stephen Blank a également fait un commentaire éloquent : […] en qualité d’éducateur, je tiens à dire que beaucoup de dirigeants des gouvernements, des médias et des universités connaissent bien mal l’évolution de l’Amérique du Nord, en dépit de son importance croissante dans nos vies. Très peu de ressources sont consacrées à l’éducation et à l’information de la population. Il n’y a presque pas d’instituts universitaires sur l’Amérique du Nord, de programmes de professeurs invités ou d’échanges d’étudiants à ce sujet, et pas de fonds pour financer la recherche en collaboration. Il n’existe ni centre ni fondation qui soient voués à la recherche sur l’Amérique du Nord. L’écart entre ce qui se passe et ce que nous en savons est énorme. Ce déficit d’information est manifestement la plus grande faiblesse de notre système nord-américain39. Bien entendu, l’avenir de l’Amérique du Nord c’est bien plus que l’intégration économique, les effets de l’ALENA ou les prochaines étapes. Essentiellement, il devrait englober ce qui est le plus souhaitable pour les plus de 400 millions de citoyens que regroupent les trois pays souverains qui partagent cet espace économique de 12 000 milliards de dollars. Cela suppose la mobilisation de toute une série d’intervenants et du public en général dans les trois pays. Cela suppose des enquêtes sur les diverses situations dans lesquelles vivent ces gens et sur les interactions qui leur importent le plus. Cela suppose une facilitation des transferts de connaissances, des communications et du réseautage à de nombreux niveaux. L’une des recommandations de Laura Macdonald est d’« encourager le gouvernement à offrir un plus grand soutien à la recherche et à l’éducation dans le domaine des études nord-américaines40 ». Le Comité souscrit à cette idée. Tous les paliers de l’administration publique canadienne devraient collaborer, chacun dans ses sphères de compétence respectives, pour renforcer ce soutien. Toutefois, nous pensons qu’une tâche bien plus lourde nous attend, car il s’agit de préparer les Canadiens et de mieux positionner le Canada pour réagir de façon réaliste et adéquate aux défis du contexte politique d’une Amérique du Nord en évolution. À cet égard, peut-être les instruments existants d’élaboration des politiques, par exemple le projet des Liens nord-américains du PRP, peuvent-ils être élargis et mieux utilisés pour diffuser les résultats des recherches, en vue de discussions et de débats publics. De fait, nous verrions d’un bon œil que l’on envisage la création d’une entité axée sur le savoir, un centre d’excellence par exemple, qui soit plus visible et qui ait pour mission de renforcer notre capacité d’analyser tous les aspects et toutes les conséquences sociales d’une intégration nord-américaine. Une initiative canadienne de ce genre pourrait appeler la contribution des États-Unis et du Mexique et, à terme, se transformer en un projet d’ampleur nord-américaine. En ce qui concerne les objectifs nord-américains du Canada en particulier, en matière de politique étrangère, peut-être le Centre canadien pour le développement de la politique étrangère pourrait-il jouer un rôle plus actif, en créant des liens entre les professionnels du service extérieur, les parlementaires, les universitaires, d’autres chercheurs, les groupes d’intérêts et les organismes de la société civile. Les technologies de l’information pourraient également être utilisées pour améliorer les rapports interactifs avec la population en général. Les réponses ne sont sans doute pas évidentes. C’est pourquoi il est encore plus important et plus opportun pour nous, Canadiens, de nous demander quel type d’Amérique du Nord nous souhaitons. Recommandation 6 Afin de rendre le Canada et les Canadiens plus à même de relever les défis d’un contexte politique nord-américain — Mexique compris — en évolution rapide, le gouvernement devrait :
Recommandation 7 Plus précisément, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international devrait chercher les moyens d’approfondir la connaissance et la compréhension des relations nord-américaines du Canada, en particulier avec les États-Unis mais aussi avec le Mexique. Le MAECI devrait aussi favoriser la participation du public à l’établissement d’une meilleure définition et à la promotion des objectifs de politique étrangère du Canada en Amérique du Nord. Par exemple, on pourrait confier au Centre canadien pour le développement de la politique étrangère la mission de créer des liens à cet égard entre les professionnels du service extérieur, les parlementaires, les universitaires, les autres chercheurs, les groupes d’intérêts et les organismes de la société civile. On pourrait également recourir aux technologies de l’information pour améliorer les échanges interactifs avec la population en général. B. L’AMÉRIQUE DU NORD EN CHIFFRES : VUE D’ENSEMBLE D’UNE ÉCONOMIE ÉMERGENTE Tendances économiques dans les années 1990 : intégration accrue et regard vers l’extérieur Près de 15 ans se sont écoulés depuis que l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALE) a donné le coup d’envoi à une période d’intégration économique sans précédent en Amérique du Nord. À mesure que tombaient les obstacles tarifaires et non tarifaires, le commerce et les investissements entre le Canada, les États-Unis et le Mexique s’envolaient. L’Amérique du Nord est devenue, en fait, un marché intérieur unique. Face à une concurrence de plus en plus forte, les entreprises des trois pays s’adaptent au nouveau contexte économique en spécialisant leur production et en exploitant leurs avantages comparatifs et leurs forces régionales. Le reste de ce chapitre plante le décor du chapitre 4 intitulé « Gérer et promouvoir la relation économique nord-américaine : les principaux enjeux ». En effet, il donne un aperçu de l’intégration et de l’interdépendance accrues qui se sont installées en Amérique du Nord au cours des années 1990. La fin des années 1980 et la décennie 1990 ont été marquées par la réduction substantielle des barrières au commerce et à l’investissement. En 1994, la conclusion du cycle d’Uruguay des négociations commerciales au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a entraîné une réduction des barrières tarifaires et non tarifaires à l’échelle mondiale. La même année a été mis en place l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui faisait fond sur l’expérience canado-américaine de libéralisation acquise et qui facilitait grandement la circulation des biens et des services. De plus, tout au long des années 1990, le Canada et le Mexique — surtout ce dernier — ont signé des accords de commerce bilatéraux un peu partout dans le monde. Dans le cas du Mexique, la libéralisation du commerce a joué un rôle de premier plan dans une série de réformes économiques et politiques entreprises vers la fin des années 1980. Le Mexique a négocié activement des accords de libéralisation du commerce dans le cadre de sa stratégie visant à devenir la plaque tournante du marché de l’ensemble des Amériques. En plus de l’ALENA, le Mexique a signé, au cours des 10 dernières années, des accords avec le Chili, la Colombie, le Venezuela, Israël, la Norvège, la Suisse, l’Union européenne et la plupart des pays d’Amérique centrale. Par suite de la disparition de certaines barrières commerciales, à l’échelle tant mondiale que nord-américaine, les exportations et les importations ont joué un rôle de plus en plus grand dans la croissance économique au cours de la dernière décennie. Au Canada, l’économie nord-américaine la plus axée sur les exportations, les exportations de biens et de services représentaient, en 2000, 46 % du PIB national, comparativement à 28 % dix ans plus tôt et 21 % en 1970. Les importations ont connu une hausse similaire, mais, depuis quelques années, le surplus commercial croissant du Canada signifie que les importations sont inférieures aux exportations dans l’économie nationale. C’est le Mexique qui a connu les plus importantes transformations en matière d’orientation économique. Dans la majeure partie des années 1970, moins de 10 % du PIB mexicain provenaient des exportations. Or, cette proportion a augmenté vers la fin des années 1970 et tout au long de la décennie 1980, mais elle a explosé après 1994, atteignant 45 % du PIB en 2000. Dans le cas des importations, l’augmentation a été encore plus spectaculaire. Les réformes économiques nationales de la fin des années 1980 qui, comme nous l’avons mentionné précédemment, mettaient l’accent sur la libéralisation du commerce, ont donné lieu à une poussée des importations au Mexique. En 1987, les importations représentaient 12 % du PIB national mexicain; en 2000, elles représentaient 52 %.
En comparaison, les États-Unis demeurent une économie assez fermée. En 2000, les exportations de biens et de services équivalaient à un peu moins de 13 % de la production économique totale. S’il est vrai que ce chiffre semble conservateur lorsqu’on songe au Canada et au Mexique, la contribution des exportations au PIB américain a presque doublé, si l’on pense au taux de 7 % calculé immédiatement avant la signature de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Les importations ont augmenté un peu plus rapidement, surtout depuis quelques années : les importations de biens et de services ont atteint 17 % du PIB en 2000. La croissance exceptionnelle du commerce en Amérique du Nord est en grande partie responsable de l’importance accrue du commerce pour les économies du Canada, des États-Unis et du Mexique. Le commerce des marchandises entre les trois pays signataires de l’ALENA s’établissait à 945 milliards de dollars en 2001, une augmentation de près de 350 % par rapport à la valeur des exportations dans le marché nord-américain en 1990.
Des trois pays signataires de l’ALENA, le Mexique est celui qui a enregistré les meilleurs gains dans les années 1990. Le commerce bilatéral avec le Canada et les États-Unis a bondi de 431 % depuis 1990, ce qui dépasse largement le rythme de croissance du Canada et des États-Unis. Le commerce du Mexique avec ses partenaires de l’ALENA a atteint 376 milliards de dollars en 2001, grâce à la forte poussée de ses exportations. Les exportations du Mexique vers ses partenaires de l’ALENA en 2001 ont progressé de 484 % par rapport à 1990. Pour leur part, les importations en provenance du Canada et des États-Unis ont augmenté de 374 % pendant la même période.
En tant que première économie de l’Amérique du Nord, les États-Unis sont aussi le principal partenaire commercial au sein de l’ALENA. Leur commerce bilatéral avec le Canada et le Mexique s’est élevé à 930 milliards de dollars en 2001, en augmentation de 247 % par rapport à 1990. Ce rythme de croissance est inférieur à celui du Mexique, mais il est supérieur à la croissance des importations et des exportations du Canada. Contrairement au Mexique et au Canada, la croissance du commerce aux États-Unis est attribuable aux importations. En effet, les importations en provenance du Canada et du Mexique ont grimpé de 278 % de 1990 à 2001, tandis que les exportations vers ces pays ont progressé de 210 %. Compte tenu de la croissance importante de leurs importations, les États-Unis affichent un déficit commercial substantiel et croissant par rapport à leurs partenaires de l’ALENA. Même si son commerce bilatéral avec ses partenaires de l’ALENA a progressé considérablement depuis 1990, le Canada a connu la plus faible croissance en matière d’échanges bilatéraux des trois pays signataires de l’accord. Par rapport à 1990, le commerce bilatéral du Canada en 2001 a grossi de 189 % — un bond de 215 % des exportations et une augmentation de 157 % des importations. En raison de la faible hausse des importations canadiennes, plus particulièrement en provenance des États-Unis, et de la place de choix que les États-Unis occupent auprès des exportateurs canadiens, le Canada enregistre le plus gros surplus commercial des trois pays. 2. Développement de l’interdépendance Étant donné que les économies des pays membres de l’ALENA sont de plus en plus axées sur le commerce et que les échanges commerciaux progressent de façon exceptionnelle entre les trois nations, les économies du Canada, des États-Unis et du Mexique sont devenues de plus en plus interdépendantes au fil des ans. Compte tenu de la vigueur de l’économie américaine, sur le plan pratique, cela signifie que la croissance économique du Canada et du Mexique est de plus en plus tributaire du rendement des États-Unis.
Cette constatation s’applique davantage au Canada qu’au Mexique. Le Canada possède en effet l’économie la plus ouverte en Amérique du Nord et l’une des économies industrielles de la planète les plus axées sur le commerce. Or, les États-Unis étant depuis longtemps la principale destination de ses exportations, la croissance économique canadienne a, depuis des décennies, suivi de près celle de l’économie américaine. Cette situation est particulièrement frappante depuis les années 1990 : les deux pays ont vécu une récession au début des années 1990, ont connu une forte poussée à compter de 1997 et ont subi une forte baisse du taux de croissance annuelle en 2001. Un retour en arrière permet de constater que la variation entre le rendement des économies canadienne et américaine s’est amenuisée considérablement au fil des ans. Dans les années 1970, la différence de la croissance annuelle du PIB réel se situait à 1,8 %. Dans la décennie 1980, elle est passée à 1,1 %, puis à 1,0 % dans les années 1990. Depuis deux ans, elle n’est plus que de 0,3 %41. Au Mexique, l’économie n’est pas aussi dépendante du commerce qu’au Canada, mais, comme le montre le graphique ci-dessous, la situation se transforme radicalement. À mesure que l’économie mexicaine se tourne vers le commerce international, l’influence des États-Unis — son principal partenaire commercial — s’accroît. Dans les années 1970 et 1980, la croissance du PIB mexicain a été très différente de celle des États-Unis, en partie à cause de la volatilité des schémas de croissance qui caractérisait le Mexique à l’époque. L’écart moyen entre les taux de croissance américain et mexicain dans les années 1970 se situait à 3,9 %; dans les années 1980, il était supérieur, atteignant 4,4 %. Cependant, dans les années 1990, à mesure que le commerce s’intensifiait, l’économie mexicaine a commencé à s’aligner sur celle des États-Unis. En effet, l’écart moyen s’élevait à 2,4 % seulement et aurait été sensiblement inférieur sans la crise du peso mexicain en 1995.
3. Les échanges commerciaux et les investissements en Amérique du Nord L’expansion spectaculaire du commerce et des investissements en Amérique du Nord, surtout depuis l’entrée en vigueur de l’ALENA en 1994, est évidente dans les relations bilatérales des pays signataires de l’accord. Les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis sont de loin les plus importantes et les mieux développées, mais le commerce et les investissements entre les États-Unis et le Mexique, et entre le Canada et le Mexique, connaissent également un progrès considérable. L’examen attentif des trois ensembles de relations commerciales bilatérales révèle combien les économies nord-américaines sont interdépendantes. Sauf quelques exceptions, les trois pays exportent des marchandises similaires dans le marché nord-américain. Cette constatation donne à penser que le Canada, les États-Unis et le Mexique non seulement appuient des industries très interdépendantes, mais aussi qu’ils favorisent une spécialisation croissante des produits et des procédés. a) Le Canada et les États-Unis Le commerce entre le Canada et les États-Unis est le plus considérable de toute l’Amérique du Nord. Les échanges bilatéraux ont totalisé 569 milliards de dollars en 2001, une augmentation de 185 % par rapport à 1990, et équivalaient à 60 % de tous les échanges infrarégionaux en 2001. Les exportations vers le nord (des États-Unis vers le Canada) ont atteint 218 milliards de dollars, tandis que les exportations vers le sud (du Canada vers les États-Unis) se sont chiffrées à 351 milliards de dollars. Le Canada a enregistré un surplus commercial de 132 milliards de dollars avec les États-Unis en 2001. Le Canada est le principal partenaire commercial des États-Unis, et vice-versa. Cependant, quoique les États-Unis reçoivent la majeure partie des exportations canadiennes, le Canada occupe seulement une place légèrement plus importante pour les exportateurs américains que leurs autres principaux partenaires commerciaux. Chaque année, 87 % des exportations canadiennes sont destinées aux États-Unis; seulement 22 % des exportations américaines vont au Canada. Contrairement à ce qui caractérise ses exportations, le Canada dépend moins des États-Unis comme source d’importations. Les importations au Canada en provenance des États-Unis connaissent un déclin, même si le commerce sud-nord a bondi de 150 % depuis 1990. La croissance rapide des importations d’autres pays — la Chine et le Mexique en particulier — ont contribué à la baisse de la proportion des importations canadiennes qui proviennent des États-Unis. En 1998, 68 % des importations canadiennes (un record) arrivaient des États-Unis. Trois ans plus tard, ce pourcentage était tombé à 64 %, son plus bas niveau depuis 1990. De la même façon, le Canada est plus important comme destination des exportations que comme source d’importations pour les États-Unis. Le commerce vers le sud a progressé de 215 % depuis 1990, mais la proportion des importations américaines provenant du Canada a diminué légèrement, atteignant 19 % en 2001. Comme au Canada, l’augmentation substantielle des importations américaines en provenance du Mexique et de la Chine, surtout à la fin des années 1990, est en grande partie responsable de cette situation. Donc, malgré la multiplication des échanges commerciaux bilatéraux entre le Canada et les États-Unis, les relations commerciales entre les deux pays s’essoufflent dans le contexte nord-américain. La croissance du commerce canado-américain depuis 1990 n’atteint pas la moitié de la croissance respective des échanges commerciaux entre les États-Unis et le Mexique et entre le Canada et le Mexique. Par conséquent, même si les échanges commerciaux bilatéraux entre le Canada et les États-Unis représentaient encore 60 % du commerce nord-américain en 2001, ce chiffre est très inférieur à celui de 1990, lorsque les échanges canado-américains représentaient près de 75 % du commerce infrarégional.
Les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis visent une multitude de produits : matières premières, dérivés des matières premières, biens manufacturés ou produits de la fabrication lourde et de la technologie. Cependant, peu importe le lieu d’origine des exportations, la majorité d’entre elles se regroupent dans quelques catégories clés.
Les exportations canadiennes de matériel et d’outillage, y compris les appareils électriques et électroniques, sont aussi considérables, représentant un peu moins de 14 % des exportations totales vers les États-Unis. Finalement, les produits forestiers comme la pâte de papier, le papier, le bois d’œuvre et les articles de bois constituent un peu plus de 10 % des exportations vers nos voisins du Sud. Deux catégories de produits représentent un peu plus de la moitié de toutes les exportations américaines au Canada. Au premier rang : le matériel et l’outillage, y compris les appareils électriques et électroniques, qui comptent pour un peu moins du tiers des exportations vers le Canada en 2001. Au deuxième rang : les véhicules motorisés et leurs pièces, représentant 18 % des marchandises américaines expédiées au Canada en 2001. Les autres exportations sont réparties entre une gamme de produits, dont les produits chimiques, les articles de caoutchouc, le plastique et les métaux. Lorsqu’on examine de plus près les acteurs de la scène commerciale au Canada, on constate que l’Ontario mène le peloton des exportateurs provinciaux aux États-Unis. En 2001, l’Ontario a vendu 188 milliards de dollars de marchandises à des acheteurs aux États-Unis, ce qui représente environ 54 % du total des exportations canadiennes vers ce pays. Le commerce entre l’Ontario et les États-Unis est alimenté par l’intégration économique accrue de la province et des États voisins. Le tiers des exportations ontariennes internationales sont destinées au Michigan, en raison du secteur hautement intégré de l’automobile. Les véhicules motorisés et leurs pièces représentaient près de 40 % des exportations de l’Ontario aux États-Unis en 2001. Le Québec et l’Alberta sont, dans l’ordre, au deuxième et troisième rangs des exportateurs canadiens aux États-Unis. Les exportations des deux provinces sont évaluées respectivement à 60 et à 51 milliards de dollars. Le Québec, dont les exportations d’équipement aérospatial et de produits forestiers occupent le premier rang, échange surtout avec New York et les États du Nord-Est et produit 17 % des exportations canadiennes destinées aux États-Unis. Quant à l’Alberta, ce sont ses fortes ventes de pétrole et de gaz qui expliquent sa part de 15 %. Cependant, contrairement à la plupart des autres provinces, l’Alberta ne concentre pas ses ventes américaines dans les États voisins. En fait, beaucoup des États destinataires de ses produits — Washington, Michigan, Illinois, Minnesota et Ohio — sont situés le long des grands pipelines nord-américains. Même si l’Ontario possède l’économie la plus synchronisée avec celle des États-Unis et s’il domine le commerce canadien avec ce pays, il ne fait pas figure de chef de file en matière de croissance des exportations vers les États-Unis. L’Ontario a maintenu en moyenne une croissance annuelle de ses exportations vers notre voisin du Sud de 10,5 % de 1990 à 2001, mais ce sont l’Alberta et les Maritimes qui ont connu la plus forte croissance. Les exportations de l’Île-du-Prince-Édouard vers les États-Unis ont grimpé de 17,4 % par année depuis 1990. Cependant, les exportations internationales de l’Ontario sont plus tributaires des marchés américains que celles des autres provinces canadiennes. En 2001, plus de 93 % des exportations internationales de l’Ontario ont été vendues aux États-Unis, ce qui est, de loin, la plus grande proportion de tout le pays. Le Nouveau-Brunswick, l’Alberta et l’Île-du-Prince-Édouard occupent le deuxième rang : chacune de ces provinces a expédié en 2001 environ 89 % de ses exportations internationales vers les États-Unis. À l’opposé, la Saskatchewan et Terre-Neuve–Labrador — les deux provinces situées le plus à l’écart des grands marchés américains — exportent peu aux États-Unis : 59 % et 66 % respectivement. En plus de la multiplication des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis depuis la signature de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis en 1989, l’investissement étranger direct (IED) entre les deux pays a progressé. C’est particulièrement vrai dans les mois qui ont suivi immédiatement la récession du début des années 1990. Les investissements canadiens aux États-Unis sont passés de 60 milliards de dollars en 1990 à 154 milliards de dollars en 2000 (valeur à la fin de l’exercice), une augmentation de 157 %. Les investissements américains au Canada étaient légèrement supérieurs en 2000, se situant à 186 milliards de dollars, mais ils n’ont pas progressé aussi vite que les investissements canadiens aux États-Unis. L’IED américain au Canada en 2000 était de 121 % supérieur à son niveau de 10 ans auparavant. Les États-Unis sont une destination privilégiée pour l’IED canadien, mais l’inverse est moins vrai. En 2000, les États-Unis ont bénéficié de plus de la moitié de l’IED canadien dans le monde entier. Par opposition, le Canada n’a reçu que 10 % de l’IED américain la même année. Dans les deux cas, cependant, la croissance de ces investissements au cours de la décennie 1990 n’a pas maintenu le rythme de l’augmentation de l’IED des deux pays ailleurs dans le monde. Par conséquent, le Canada n’est plus aussi attrayant aux yeux des investisseurs américains; et la situation inverse est également vraie. En 2000, la proportion de l’IED canadien aux États-Unis, comparativement au total des investissements à l’étranger, a chuté (elle se situait à 61 % en 1990), tandis que les investissements américains au Canada en 1990 représentaient 16 % du total de l’IED américain, la même année.
Des trois relations bilatérales en Amérique du Nord, celle entre le Canada et le Mexique est de loin la plus petite. Le Canada et le Mexique ont échangé 14,8 milliards de dollars de marchandises en 2001, ce qui représente seulement 1,6 % du commerce réalisé dans le cadre de l’ALENA. S’il est vrai que la valeur des échanges commerciaux entre le Canada et le Mexique n’est pas énorme, elle n’a cessé de croître depuis quelques années. Or, les échanges commerciaux bilatéraux entre le Canada et le Mexique connaissent la plus forte croissance de toute la zone de l’ALENA : 517 % depuis 1990, grâce à une poussée des exportations mexicaines au Canada. Les ventes de marchandises mexicaines au Canada ont septuplé depuis 11 ans, atteignant 12,1 milliards de dollars en 2001. Les exportations canadiennes à destination du Mexique ont aussi augmenté de façon appréciable, mais pas au même rythme que les exportations mexicaines. De 656 millions de dollars en 1990, les exportations canadiennes sont passées à 2,7 milliards de dollars en 2001. Bien que cette augmentation de 313 % paraisse considérable, la balance commerciale penche résolument en faveur du Mexique.
La croissance spectaculaire des échanges commerciaux entre le Canada et le Mexique, et ce, dans les deux sens, signifie que l’un et l’autre deviennent petit à petit des partenaires commerciaux privilégiés. Bien que seulement 0,7 % des exportations canadiennes en 2001 aient abouti au Mexique, cette proportion est néanmoins supérieure au taux de 0,4 % de 1990. En vérité, le Mexique est la seule grande destination des exportations canadiennes, à l’exception des États-Unis, qui ait vu sa part du marché grandir depuis 1990. Le Mexique se trouve désormais au sixième rang des pays destinataires des exportations du Canada. Par ailleurs, le Mexique voit sa part des importations canadiennes s’accroître également : en 2001, environ 3,5 % des importations canadiennes provenaient du Mexique — contre 1,3 % en 1990 — ce qui situe ce pays au quatrième rang des sources d’importations du Canada. Le commerce avec le Canada revêt également une grande importance pour le Mexique. En effet, les données sur le commerce de ce pays semblent indiquer que le Canada est sa deuxième destination commerciale (2,0 % de ses exportations à l’échelle mondiale en 2000). Par ailleurs, cette même année, 2,3 % des importations du Mexique provenaient du Canada. Cela signifie que notre pays occupe le quatrième rang des pays qui exportent au Mexique. Mentionnons qu’il existe des facteurs qui nuisent à l’examen des échanges commerciaux entre le Canada et le Mexique. La plupart des marchandises transitant par les États-Unis, il est difficile d’en déterminer avec exactitude l’origine et la destination. Il est probable que les exportations canadiennes au Mexique sont de beaucoup sous-évaluées42. Des projets de rapprochement des données sont en cours entre les deux pays.
Néanmoins, c’est le secteur des exportations agricoles canadiennes qui a connu le plus gros essor. Les exportations de céréales, d’oléagineux et d’autres produits connexes sont passées de 10 millions de dollars en 1990 à plus de 500 millions de dollars en 2001 et représentent aujourd’hui 19 % du total des exportations au Mexique. En outre, les produits d’origine animale, comme la viande, les produits laitiers et les œufs, ont également connu une hausse et constituent maintenant plus de 13 % des exportations canadiennes au Mexique. Les produits agricoles sont devenus des exportations usuelles vers le Mexique, mais d’autres produits canadiens ont aussi connu une percée rapide. Des 25 principales catégories d’exportations du Canada, seulement 7 n’ont pas au moins doublé de 1990 à 2001 et seulement 2 ont subi une baisse. Les exportations mexicaines au Canada se concentrent dans la catégorie des véhicules motorisés, du matériel et de l’outillage. En particulier, le Mexique est un manufacturier important d’appareils électroniques : ses exportations dans ce domaine ont presque décuplé depuis 1990. Regroupées, la catégorie des véhicules motorisés et de leurs pièces et celle du matériel et de l’outillage électriques et électroniques représentent près de la moitié des exportations mexicaines au Canada. Lorsqu’on ajoute le reste du matériel et de l’outillage, ces deux catégories atteignent tout près de 75 % de toutes les exportations. Bien que les exportations du Mexique au Canada soient dominées par quelques secteurs clés, ce ne sont pas les seuls à avoir connu une forte hausse. La position de presque toutes les principales catégories de produits, de l’habillement aux instruments scientifiques, s’est améliorée de manière considérable dans les marchés canadiens. Tout comme dans le cas des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis, l’Ontario domine les exportations canadiennes au Mexique. Sous l’impulsion des ventes de véhicules motorisés et de leurs pièces, l’Ontario a expédié au Mexique des marchandises évaluées à près de 1,4 milliard de dollars en 2001, ce qui représente exactement la moitié des exportations canadiennes vers ce pays. Les provinces des Prairies ont exporté la majeure partie du reste : près de 35 % du total national. L’Alberta a exporté pour 489 millions de dollars au Mexique en 2001, tandis que la Saskatchewan et le Manitoba ont contribué respectivement pour 273 millions de dollars et 176 millions de dollars. Les céréales, les oléagineux et les produits d’origine animale constituent l’essentiel des exportations de ces provinces. Le Québec est la seule autre province qui a vendu pour plus de 100 millions de dollars de marchandises au Mexique en 2001. Les exportateurs de la Saskatchewan et du Manitoba sont les plus tributaires du marché mexicain. Le Mexique est la destination finale de 2,3 % des exportations de la Saskatchewan, mais de seulement 1,9 % de celles du Manitoba. Le Mexique reçoit moins de 1 % des exportations internationales des autres provinces. Cette situation pourrait changer dans un avenir rapproché, étant donné que plusieurs provinces ont enregistré une augmentation de leurs exportations vers le Mexique. Cinq provinces ont fait un bond incroyable; les autres n’ont pas été aussi avantagées. La Saskatchewan, le Manitoba, l’Alberta, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador sont en tête de cette remontée. Chacune de ces provinces a vu ses exportations croître en moyenne d’au moins 20 % par année depuis 1990. Parmi les autres, l’Ontario a maintenu une croissance robuste de 12 % par année depuis 1990. Cependant, les exportations des quatre provinces restantes ont augmenté de moins de 10 % par année. De façon générale, les pays en développement donnent la priorité à l’obtention d’une aide pour développer leur économie nationale plutôt qu’à l’investissement à l’étranger. Cela se voit dans les relations d’investissement entre le Canada et le Mexique : l’IED circule du nord au sud. Les investissements entre les deux pays ont été fortement touchés par la signature de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Le stock d’IED canadien au Mexique est demeuré stable tout au long des années 1980, mais la décennie suivante a été témoin d’une explosion des investissements canadiens en sol mexicain : l’IED est passé de 245 millions de dollars en 1990 à 3,5 milliards de dollars 10 ans plus tard.
En fait, le Mexique est devenu un lieu d’investissement privilégié pour le Canada au cours des années 1990, mais il demeure néanmoins un destinataire modeste par rapport à d’autres pays, comme les États-Unis. En 1990, seulement 0,2 % du stock d’IED canadien visait le Mexique. Dix ans plus tard, cette proportion est passée à 1,1 %. c) Les États-Unis et le Mexique Les échanges commerciaux entre les États-Unis et le Mexique occupent le deuxième rang dans la région de l’ALENA. Les États-Unis et le Mexique ont échangé des marchandises évaluées à 361 milliards de dollars en 2001, soit 38 % de tout le commerce intérieur nord-américain. Les échanges commerciaux entre les deux pays se sont accrus de 428 % depuis 1990. Bien que cette augmentation soit inférieure à celle des échanges commerciaux entre le Canada et le Mexique, elle excède néanmoins, et de beaucoup, l’augmentation des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis de 1990 à 2001. Les exportations mexicaines vers les États-Unis sont particulièrement fortes, ayant progressé de 478 % depuis 1990 pour atteindre 204 milliards de dollars en 2001. Comme dans les relations canado-américaines, c’est le plus petit des deux pays qui exporte le plus. Le Mexique enregistre un surplus commercial de quelque 46 milliards de dollars avec les États-Unis.
Les relations commerciales du Mexique avec les États-Unis sont similaires à celles du Canada. Les États-Unis sont, de loin, la principale destination des exportations du Mexique, puisqu’ils reçoivent près de 89 % de toutes les exportations de ce dernier. De plus, le Mexique importe davantage des États-Unis que de tout autre pays. Environ 73 % des importations mexicaines proviennent des États-Unis. Contrairement au Canada cependant, la dépendance du Mexique à l’égard des États-Unis a diminué au cours des dernières années, malgré l’intensification des échanges entre les deux pays. Le Mexique est la seconde destination des exportations des États-Unis, mais il ne reçoit tout de même que 14 % du total des exportations américaines. Toutefois, le Mexique prend rapidement de l’importance pour les exportateurs américains : les exportations américaines au Mexique ont augmenté de 375 % depuis 1990, cet accroissement étant le plus considérable parmi les grands partenaires commerciaux des États-Unis, à l’exception de la Chine. Bien que la part canadienne dans le commerce extérieur des États-Unis soit demeurée relativement stable depuis 1990 (elle fluctue entre 21% et 24 %), sa part du commerce mexicain, exprimée en pourcentage de la totalité des échanges commerciaux américains, a doublé (elle était de 7 % en 1990). Au chapitre des importations, le Mexique progresse également sur les marchés américains. En 1990, 6,1 % des importations américaines provenaient du Mexique, mais, compte tenu de la forte croissance du commerce sud-nord au cours des années subséquentes, en 2001, le Mexique était à l’origine de près de 12 % des importations américaines. Le Mexique occupe désormais le second rang des pays dont les États-Unis importent.
Bien que le commerce vers les États-Unis soit composé principalement de matériel, et d’outillage, de véhicules motorisés et de leurs pièces, le Mexique exporte aussi une gamme de produits vers son voisin du Nord; la plupart d’entre eux ont fait un bond au cours des dernières années. Depuis 1990, presque toutes les principales catégories d’exportations vers les États-Unis ont au moins triplé. Les vêtements et les textiles, de même que les instruments scientifiques et techniques, ont progressé de façon très remarquable. Le commerce nord-sud — c’est-à-dire des États-Unis au Mexique — repose également sur la vente de matériel, d’outillage et de véhicules motorisés, preuve de l’intégration des industries et de la spécialisation des produits. Les exportations de matériel et d’outillage vers le Mexique constituent 39 % du total des exportations américaines. La vente de matériel et d’outillage électroniques et électriques constitue un quart de ce chiffre. Quant aux véhicules motorisés et à leurs pièces, ils représentent environ 11 % du total des exportations américaines au Mexique. La majorité des catégories d’exportations ont connu la même croissance. Toutes les principales exportations américaines au Mexique ont marqué des points depuis 1990. En fait, seulement deux des 25 principales catégories de produits n’ont pas triplé au cours des 11 dernières années. Les investissements entre le Mexique et les États-Unis sont dominés par les flux nord-sud. Les investissements américains au Mexique ont augmenté considérablement depuis la fin des années 1980, surtout depuis l’entrée en vigueur de l’ALENA en 1994. En 2000, ils ont atteint 35,4 milliards de dollars américains, une hausse de 243 % par rapport à 1990. Les investissements mexicains aux États-Unis, quant à eux, sont modestes, mais ont progressé de façon considérable depuis les années 1990, s’élevant à 2,5 milliards de dollars américains en 2000. Les États-Unis sont la principale source d’IED au Mexique. En 2000, environ 55 % des investissements étrangers au Mexique provenaient des États-Unis, ce qui représente une légère baisse par rapport aux 59 % de 1990. Pour les États-Unis, le Mexique représente environ 4 % du stock d’IED.
L’ALE et l’ALENA ont atteint leurs objectifs : augmenter le commerce et l’investissement en Amérique du Nord et réduire les obstacles qui s’y opposent. Le libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique a accéléré la tendance déjà ancienne au resserrement des liens économiques dans la région. En réalité, compte tenu de la taille relative des trois pays, ce processus d’intégration a fait en sorte que les exportations à destination des États-Unis sont devenues la pierre angulaire de la production économique nationale, tant du Canada que du Mexique. De fait, sans égards aux conséquences de l’ALENA, aux yeux du Canada, l’intégration économique de l’Amérique du Nord équivaut au développement de ses relations avec les États-Unis. Le commerce et l’investissement entre le Canada et le Mexique ont beaucoup augmenté au cours de la période post-ALENA, mais ils demeurent plus ou moins insignifiants face aux échanges Canada-États-Unis. Comme nous l’avons dit, le commerce bilatéral des marchandises entre le Canada et les États-Unis a atteint 569 milliards de dollars en 2001, tandis que le Canada et le Mexique échangeaient pour moins de 15 milliards de dollars au cours de cette même année. Les États-Unis représentent 76 % du commerce bilatéral mondial du Canada, et le Mexique seulement 2 %. a) L’intégration dans le domaine industriel De plus en plus, les industries canadiennes fonctionnent comme si l’Amérique du Nord, et les États-Unis en particulier, faisaient partie de leur marché national. Dans presque tous les secteurs, l’augmentation des exportations à destination des États-Unis a surpassé l’augmentation générale des livraisons manufacturières, au cours des années 1990. Cela donne à penser non seulement qu’une proportion croissante de la production intérieure canadienne est axée sur le marché américain, mais aussi que le marché nord-américain est de plus en plus essentiel à la réussite des entreprises canadiennes. Avec l’élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce, la plupart des industries d’Amérique du Nord, en particulier celles de la fabrication non fondée sur les ressources naturelles, ont accès aux mêmes fournisseurs de matières premières et de biens intermédiaires, tout en se faisant concurrence pour obtenir des parts de marché auprès de clients et de sources d’investissements communs. Les entreprises qui mènent des activités à la fois au Canada et aux États-Unis, ou encore au Mexique, pratiquent des échanges entre sociétés mères et filiales. Dans le cas des industries fortement intégrées, comme celle de l’automobile, les marchandises peuvent traverser la frontière canado-américaine plusieurs fois avant que le produit final ne soit terminé. La nature des échanges au sein de l’Amérique du Nord, dans de nombreuses industries, évolue donc en raison de la libéralisation du commerce et de l’intégration économique. L’accroissement de la concurrence et du commerce intra-entreprise en Amérique du Nord entraîne souvent une spécialisation industrielle plus poussée, car les sociétés ou les usines adaptent leur production de manière à exploiter leurs avantages comparatifs et à servir des créneaux spécifiques ou des marchés régionaux. Cela se traduit souvent par une focalisation des industries soit sur certains types de produits, soit sur telle ou telle étape de la production. La spécialisation et l’intégration de plus en plus fortes se reflètent dans la valeur des échanges intrasectoriels entre le Canada et les États-Unis. L’expression « commerce intrasectoriel » désigne les flux commerciaux bidirectionnels à l’intérieur de certaines industries. Si un pays domine le commerce dans tel domaine, les niveaux du commerce intrasectoriel y seront faibles. Au Canada, c’est le cas d’un certain nombre d’industries fondées sur les ressources naturelles et intégrées verticalement, dans lesquelles le Canada affiche un solde net substantiel des exportations. Les produits forestiers et les carburants fossiles en sont des exemples.
Toutefois, lorsque les échanges entre deux pays dans un secteur donné sont relativement équilibrés, cela peut traduire une certaine spécialisation des marchés au sein de cette industrie, ou une concurrence face à un marché précis. Dans ces cas, le commerce intrasectoriel sera plus important. Au Canada, cela est vrai de toute une série d’industries, y compris les produits minéraux, la sidérurgie et les produits de l’acier, le caoutchouc, les textiles, la machinerie, le matériel de transport et les biens de haute technologie. L’industrie du matériel de transport — le secteur de l’automobile en particulier — est l’une des plus intégrées d’Amérique du Nord. Depuis 1965, date de l’entrée en vigueur du Pacte de l’automobile, les liens se sont resserrés dans ce domaine. Les principaux constructeurs d’automobiles exploitent des usines et investissent un peu partout en Amérique du Nord. Ils pratiquent des échanges intensifs entre maisons mères et filiales et, s’appuyant sur la livraison juste à temps, comptent sur une libre circulation des produits à travers la frontière Canada-États-Unis. Les liens économiques qui existent dans le secteur de l’automobile contribuent à la forte intégration de l’un de ses principaux fournisseurs — l’industrie de l’acier. Les producteurs d’acier du Canada et des États-Unis se font concurrence à l’échelle du continent pour l’obtention de contrats, s’appuyant sur une livraison juste à temps et sur le bon fonctionnement d’une frontière sûre et efficace sur le plan commercial. La spécialisation au niveau de la production et le commerce intra-entreprise signifient que, comme les automobiles, les produits de l’acier peuvent passer la frontière canado-américaine plusieurs fois au cours d’un processus de fabrication. On constate également beaucoup de chevauchements transfrontaliers aux chapitres de l’investissement et de la propriété dans l’industrie de l’acier. L’Association canadienne des producteurs d’acier estime que plus de la moitié de ses membres ont des filiales aux États-Unis ou participent à des initiatives conjointes avec des sociétés américaines. Les entreprises situées de part et d’autre de la frontière se conforment aux mêmes normes et spécifications industrielles. L’ampleur de l’intégration de cette industrie est manifeste du fait que les industries canadiennes ont été exemptées des récentes mesures antidumping et compensatoires. À preuve de l’intégration poussée du secteur, le professeur Isaiah Litvak a indiqué au Comité, qu’à son avis, les producteurs d’acier du Canada, des États-Unis et du Mexique devraient envisager la création d’une association nord-américaine qui défendrait leurs intérêts communs. De fait, ce secteur est souvent présenté comme un modèle d’intégration économique nord-américaine. Les tenants d’un resserrement encore plus poussé des liens économiques, grâce à une union douanière par exemple, voient l’industrie de l’acier comme une bonne candidate pour une entente pilote. Nous y reviendrons plus en détails au chapitre 4. Le processus continu de l’intégration économique nord-américaine, notamment dans le secteur manufacturier, contribue également à l’évolution rapide d’un marché continental de l’énergie. L’énergie constitue un intrant essentiel de tous les autres biens. L’accès à une source d’énergie stable et fiable est capital pour l’ensemble de l’économie du continent, d’autant plus que l’intégration industrielle ne cesse d’augmenter. Par conséquent, le commerce continental de l’électricité, du pétrole et du gaz naturel monte en flèche, soutenu par une augmentation parallèle des investissements dans l’infrastructure énergétique, y compris dans les lignes de transport, les gazoducs et les pipelines. En avril 2001, compte tenu de l’importance stratégique de l’énergie, en particulier dans le contexte d’une conjoncture politique mondiale incertaine, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont créé le Groupe de travail nord-américain sur l’énergie. Ce dernier a pour mission d’améliorer le commerce de l’énergie en Amérique du Nord et de favoriser la coopération entre les trois gouvernements dans les dossiers communs de la région à cet égard, qui vont de l’infrastructure et des technologies au développement durable et à la protection de l’environnement43. b) La performance économique du Canada Avant l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALE) en 1989, on s’attendait généralement à ce que l’abaissement des barrières tarifaires, l’augmentation de la sécurité des investissements et l’établissement d’un système de commerce fondé sur des règles aurait pour effet, en resserrant les liens économiques entre les deux pays, d’entraîner un certain nombre de résultats positifs pour l’économie canadienne. Outre l’amélioration de l’accès au marché américain, grâce à l’ouverture du marché intérieur à la concurrence américaine, l’ALE accroîtrait, pensait-on, l’efficacité et la productivité des industries canadiennes. Cette augmentation allait à son tour entraîner une hausse de l’emploi et des revenus. Enfin, tous ces facteurs mis ensemble devaient engendrer une forte expansion économique au Canada. En fait, au cours des années 1990, les résultats économiques ont été mitigés. Certes, le Canada a connu une forte croissance à la fin de cette décennie, mais il a affiché un piètre rendement pendant les deux premiers tiers de celle-ci. Toutefois, les facteurs qui influent sur la performance économique sont tellement nombreux qu’il est difficile d’attribuer ce déclin aux seuls effets du libre-échange et de l’intégration économique. La récession qui a commencé à poindre pendant les années 1990 n’est pas le moindre de ces facteurs. Le Canada et les États-Unis ont tous deux mis en œuvre l’ALE au moment où leurs cycles économiques respectifs culminaient, et ils ont connu une récession peu après. Ce dernier phénomène n’était pas lié aux effets de l’accord commercial. Un certain nombre de nouvelles orientations ont également contribué à la faiblesse temporaire de l’économie canadienne entre le début et le milieu des années 1990. Citons notamment la mise en place par la Banque du Canada d’une politique de « stabilité des prix » — qui visait à ramener le taux d’inflation près de zéro. Pour cela, la banque devait maintenir une politique de taux d’intérêt élevés — à un moment où l’économie en difficulté aurait profité de taux plus bas. À court terme, il en est résulté un ralentissement de la reprise. De plus, la politique financière a également retardé la croissance, alors que les gouvernements fédéral et provinciaux s’efforçaient d’éliminer leurs déficits budgétaires respectifs. Quoi que occultés par les facteurs susmentionnés parmi d’autres, le libre-échange et l’intégration économique ont contribué au ralentissement temporaire de la croissance économique qu’a connu le Canada aux débuts des années 1990. Afin de réaliser les avantages à long terme attendus, à savoir l’expansion économique, les gains d’efficience et de productivité et la croissance des revenus, pour n’en citer que quelques-uns, l’économie canadienne a dû traverser une courte période d’ajustement à la suite de la mise en place du libre-échange. Bien des secteurs industriels soutenaient déjà une concurrence en franchise de droits avec les États-Unis, mais les sociétés appartenant aux secteurs lourdement protégés par des tarifs avant 1989, ont été forcées de s’adapter à la concurrence directe, et celles qui n’y ont pas réussi ont été éliminées du marché. La nouvelle répartition des ressources qui en a résulté dans l’économie canadienne s’est traduite dans les chiffres de l’emploi du secteur manufacturier au début des années 1990. Aux États-Unis, par contre, l’ajustement est passé relativement inaperçu. Certes, le Canada est la première destination des exportations américaines, mais à la fin des années 1980, il ne représentait que 21 % des ventes étrangères des États-Unis. Chez notre voisin du sud, étant donné son vaste marché intérieur et la diversification plus poussée de ses exportations, l’augmentation des liens économiques avec le Canada a eu des effets à court terme considérablement plus modestes. Cet ensemble de facteurs — la portée différente de la récession dans l’un et l’autre pays, le resserrement des politiques monétaires et financières au Canada et les rajustements structurels — ont fait que la croissance du PIB et de l’emploi des États-Unis ont largement dépassé l’expansion économique canadienne pendant la majeure partie des années 1990. Entre le milieu et la fin des années 1990, toutefois, les rajustements structurels avaient été faits, les modifications de la politique monétaire et financière avaient été apportées, et l’économie canadienne a commencé à prendre un essor certain. En effet, vers la fin de la décennie, la croissance du PIB et de l’emploi a de nouveau commencé à se comparer favorablement avec celle des États-Unis. L’économie canadienne a distancé l’économie américaine pendant quatre des cinq années allant de 1997 à 2001, et elle devrait le faire de nouveau en 2002. De même, sur le marché du travail, l’écart dans les taux de création d’emplois qui s’étaient élargis entre 1989 et 1998 a commencé à se refermer. Il est difficile, étant donné la quantité de facteurs, d’attribuer la faible performance économique qu’a connue le Canada au début des années 1990 aux retombées du libre-échange et du resserrement des liens économique avec les États-Unis. De même, les bons résultats récents ne peuvent s’expliquer uniquement par les effets de l’ALENA. Plusieurs autres données entrent en jeu, notamment les avantages que présente le dollar canadien faible, les conditions monétaires et financières améliorées et la robustesse de l’économie américaine, qui est un aimant pour les exportations canadiennes. Toutefois, les résultats récents du Canada correspondent aux avantages attendus à long terme de la libéralisation du commerce et de l’intégration économique. S’il est vrai que, par comparaison aux États-Unis, le Canada a amélioré d’une façon générale sa perspective économique au cours des années récentes, il est un domaine où cela n’est notoirement pas le cas. En effet, la productivité de notre main-d’œuvre n’a pas suivi le rythme de celle des États-Unis depuis le début des années 1990. Chez les Américains, la productivité a grimpé par suite d’une augmentation subite des investissements des entreprises dans les outillages et les équipements nouveaux, à la fin des années 1990. Même si l’économie canadienne a affiché des gains de productivité réguliers pendant la majeure partie de la décennie, elle a néanmoins perdu du terrain par rapport aux États-Unis. En conséquence, l’écart entre le Canada et les États-Unis sur le plan de la productivité de la main-d’œuvre s’est élargi depuis le milieu des années 1990, en particulier dans le secteur manufacturier. En 1995, il était de 17 %; six ans plus tard, il avait atteint 33 %.
L’amenuisement de cet écart est essentiel à la santé à long terme de l’économie canadienne et au maintien du niveau de vie des Canadiens. En général, lorsque la productivité augmente, le coût de la main-d’œuvre diminue (par unité d’extrant), ce qui ouvre la voie à une hausse des salaires et des niveaux de production. Ainsi, les gains de productivité sont-ils indispensables au maintien et à l’amélioration du niveau de vie du Canada. La nécessité d’améliorer les niveaux de productivité est particulièrement importante dans le contexte du resserrement des liens économiques entre le Canada et les États-Unis. Au fur et à mesure que s’intégreront les marchés économiques, les différences de taux de productivité auront de plus en plus d’influence sur les choix des entreprises et des investisseurs. Étant donné que la totalité du marché nord-américain sera accessible à partir d’un pays et de l’autre — ainsi que du Mexique — les sociétés et les investisseurs seront attirés par les régions qui offriront les avantages les plus intéressants. La productivité et l’innovation attirent l’investissement, qui à son tour favorise d’autres gains de productivité. Au moment où l’écart de productivité entre le Canada et les États-Unis s’élargissait, la part d’investissement étranger direct (IED) du Canada diminuait. Même si le montant de l’IED entrant au Canada a augmenté considérablement au cours des années 1990, la proportion de celui-ci par rapport à l’ensemble de l’Amérique du Nord a diminué. Avant l’entrée en vigueur de l’ALENA, certains craignaient que les investisseurs étrangers ne délaissent le Canada pour profiter de la main-d’œuvre à bon marché du Mexique. Comme Peter Harder, sous-ministre d’Industrie Canada, l’a déclaré au Comité, ce sont la productivité et le dynamisme du marché américain qui attirent les nouveaux investissements44. Comme l’a souligné M. Harder, l’un des grands défis du Canada consiste à améliorer sa productivité de manière à exploiter le « cercle vertueux » : la productivité attire l’investissement, lui-même source de productivité. Tous les progrès à cet égard non seulement améliorent le niveau de vie des Canadiens, mais jouent également un rôle critique dans l’accroissement de notre part du marché américain des importations, notamment au regard de la concurrence accrue du Mexique45. Certains citent la faiblesse de la productivité canadienne comme exemple de la façon dont le libre-échange et l’intégration économique ont échoué par rapport à la promesse de départ. Toutefois, comme c’est le cas des autres indicateurs économiques, le déclin relatif de la productivité ne peut être attribué exclusivement à l’intégration économique sans faire fi de toute une série d’autres facteurs. En outre, selon les recherches menées par le professeur Daniel Trefler de l’Université de Toronto, l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis et l’intégration économique entre les deux pays qui l’a suivi ont en fait eu des conséquences positives pour la productivité de la main-d’œuvre du secteur manufacturier au Canada, comme l’on s’y attendait avant la mise en œuvre de l’accord46. Cela donne à croire que, sans l’ALE, la productivité du Canada aurait sans doute été moindre que ne l’indiquent les données actuelles. On aurait pu s’attendre à ce que le libre-échange et l’intégration économique influencent dans le bon sens les taux de la croissance de la productivité, de plusieurs façons : le commerce allait peut-être accroître les extrants des entreprises, permettant aux usines de tirer profit des économies d’échelle au niveau de la production; l’investissement allait entraîner un recours accru aux capitaux et à l’équipement; la réduction des tarifs allait amener un déplacement de la production des sociétés peu efficaces en faveur d’entreprises plus productives; de nouvelles sociétés plus concurrentielles allaient remplacer les anciennes (les nouvelles entreprises ont tendance à être plus efficientes); et les sociétés allaient pouvoir ajuster leur production de manière à fabriquer des produits à plus grande valeur ajoutée. Ayant étudié ces possibilités, M. Trefler conclut que le roulement des installations — les plus anciennes étant remplacées par des équipements nouveaux, plus productifs — et les progrès considérables en matière de production ont été les deux sources des gains de la productivité liés au commerce au Canada. Ces études viennent appuyer l’argument général que nous avancions plus haut concernant la nécessité de nous mieux renseigner sur le phénomène que constitue l’espace économique nord-américain naissant, en nous fondant sur une analyse empirique attentive et continuelle des nombreux facteurs dynamiques qui influent sur le complexe environnement politique canadien.
|
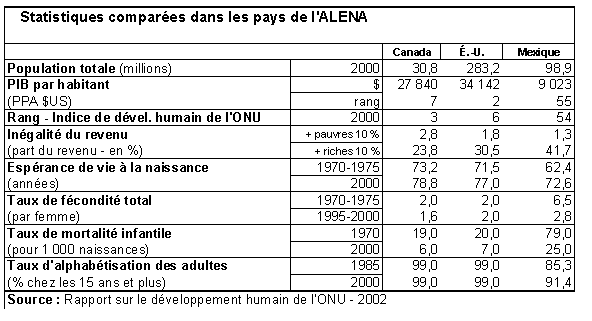
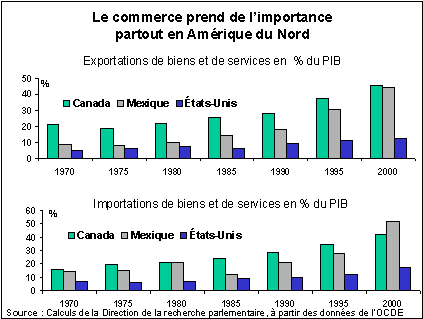
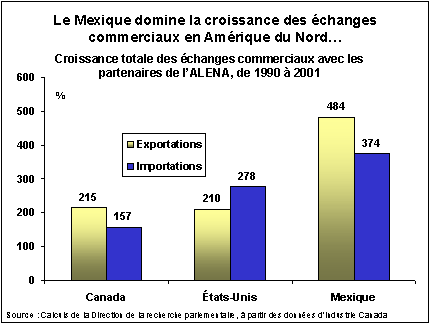
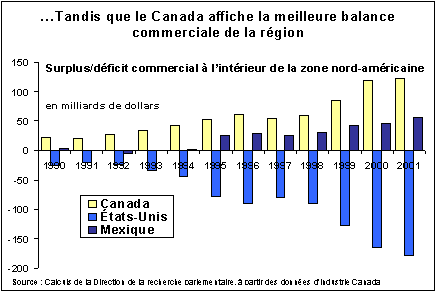
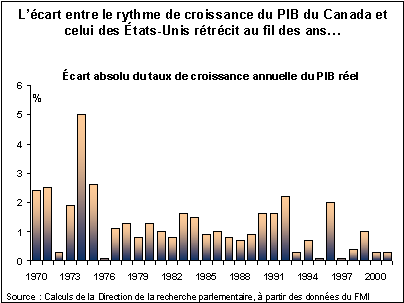
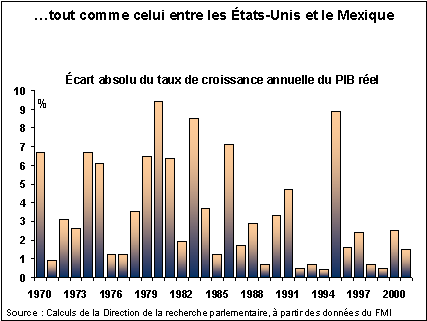
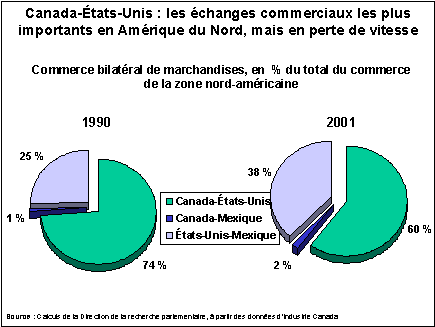
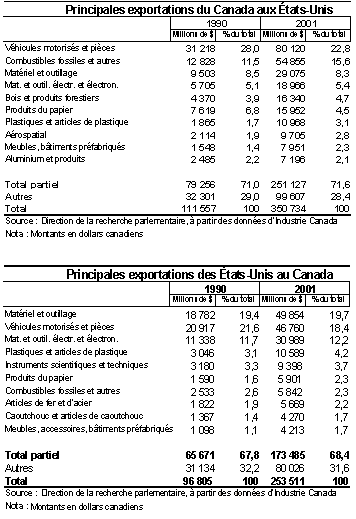 Dans le cas du commerce vers les États-Unis, quatre catégories de marchandises se partagent 66 % des exportations. Les véhicules motorisés et leurs pièces constituent la principale exportation canadienne (23 % du total en 2001). Le pétrole brut, le pétrole, le gaz naturel, le charbon et les autres combustibles fossiles se trouvent au second rang. Ces produits miniers non renouvelables composent environ 16 % des exportations du Canada.
Dans le cas du commerce vers les États-Unis, quatre catégories de marchandises se partagent 66 % des exportations. Les véhicules motorisés et leurs pièces constituent la principale exportation canadienne (23 % du total en 2001). Le pétrole brut, le pétrole, le gaz naturel, le charbon et les autres combustibles fossiles se trouvent au second rang. Ces produits miniers non renouvelables composent environ 16 % des exportations du Canada.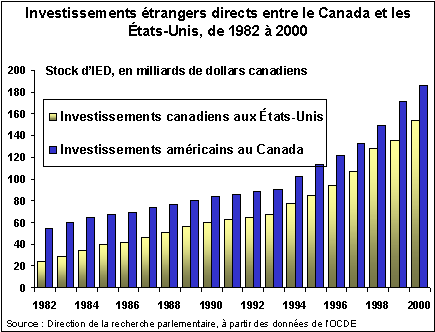
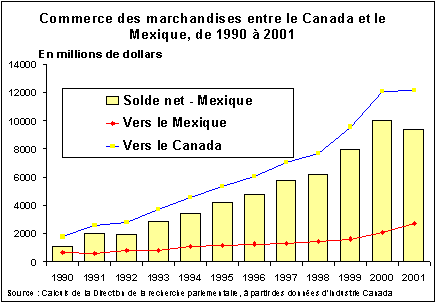
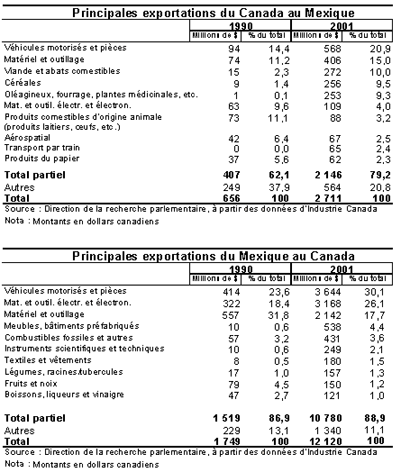 Les exportations canadiennes au Mexique se répartissent entre quelques grandes catégories, mais, contrairement aux exportations canadiennes aux États-Unis, les marchandises expédiées au Mexique représentent un mélange de biens manufacturés et de produits agricoles. La principale catégorie, les véhicules motorisés et leurs pièces, représentait un peu plus de 20 % du total des exportations en 2001 et était suivie de près par la catégorie du matériel et de l’outillage, y compris les appareils électriques et électroniques.
Les exportations canadiennes au Mexique se répartissent entre quelques grandes catégories, mais, contrairement aux exportations canadiennes aux États-Unis, les marchandises expédiées au Mexique représentent un mélange de biens manufacturés et de produits agricoles. La principale catégorie, les véhicules motorisés et leurs pièces, représentait un peu plus de 20 % du total des exportations en 2001 et était suivie de près par la catégorie du matériel et de l’outillage, y compris les appareils électriques et électroniques. 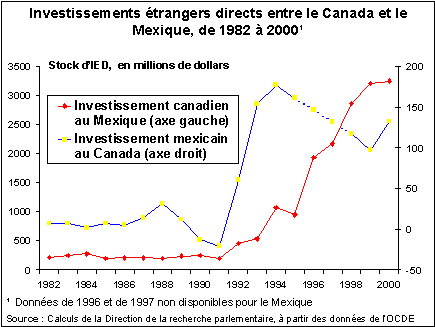
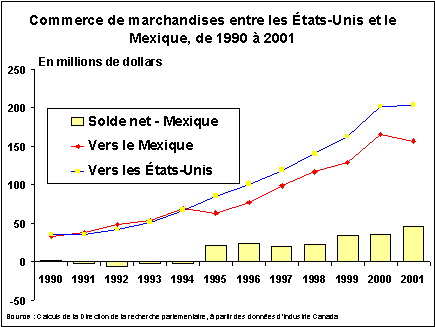
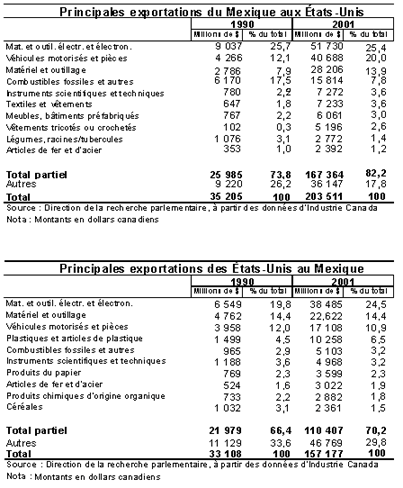 Le commerce entre les États-Unis et le Mexique se divise entre quelques grandes catégories de produits. Le matériel et l’outillage (surtout les appareils électroniques) et les véhicules motorisés et leurs pièces sont les principales catégories d’exportations mexicaines aux États-Unis : elles représentent près de 60 % du total des exportations mexicaines en 2001.
Le commerce entre les États-Unis et le Mexique se divise entre quelques grandes catégories de produits. Le matériel et l’outillage (surtout les appareils électroniques) et les véhicules motorisés et leurs pièces sont les principales catégories d’exportations mexicaines aux États-Unis : elles représentent près de 60 % du total des exportations mexicaines en 2001.