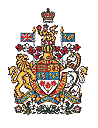:
Ma présentation va se dérouler en français, mais je suis prêt à répondre à vos questions en anglais.
J'aimerais d'abord remercier le comité de m'avoir invité. Je suis ici comme médecin spécialisé en santé du travail. Je vais décrire ce que fait un tel médecin dans un programme de surveillance médicale des membres des Forces canadiennes.
J'ai une expérience de 30 ans en médecine du travail. Dans le domaine dont on veut parler ce matin, soit l'état de stress post-traumatique, j'ai cinq ans d'expérience à la GRC, aux politiques, comme médecin-chef de la région centrale ou du quartier général.
L'une de mes responsabilités portait sur le déploiement des policiers dans les forces de maintien de la paix dans le monde. Jusqu'à maintenant, la GRC a déployé environ 2 000 membres dans tous les pays où l'armée déployait les siens. Comme médecin régional à la CSST de l'Outaouais, la Commission de santé et de sécurité du travail, je suis responsable de l'admissibilité des gens présentant des lésions psychologiques. Deux pour cent de tous les accidents du travail au Québec entraînent des lésions psychologiques, dont le stress post-traumatique.
Ce matin, j'aimerais d'abord vous expliquer ce qu'est un programme de surveillance médicale, ce que cela signifie et ce que cela peut offrir pour gérer ou mieux connaître l'état de stress post-traumatique.
Avant d'établir un programme, il faut voir ce qu'on fait. Il s'agit d'évaluer les risques. Est-il possible d'évaluer à quels risques sera exposé un militaire, puisqu'on ne sait jamais ce qui se passe et ce qui va se passer en ce qui le concerne, et que son travail est opérationnel? J'en parlerai plus tard.
Ensuite, il y a l'admissibilité. Comment peut-on reconnaître et évaluer quelqu'un qui vit des problèmes psychologiques? Qui fait cela? Est-ce le médecin militaire, le médecin civil? Où ira le militaire en détresse pour faire évaluer son programme? Une fois qu'on a admis qu'il existe une lésion de stress post-traumatique, que fait-on? Considère-t-on le militaire comme un membre dysfonctionnel à qui l'on donne une pension à vie? Le réhabilite-t-on? Que peut-il faire dans la société? On n'a pas toutes les réponses à ces questions, mais grâce à un programme, on peut savoir où on s'en va.
Une formation en santé du travail permet d'évaluer les risques. Dans tout travail, les risques sont gérables. Par exemple, en ce qui concerne les risques chimiques, on sait que les militaires sont exposés au plomb et on fait une prise de sang pour savoir si le taux de plomb est élevé.
En ce qui concerne les risques physiques, puisque les militaires sont exposés au bruit, on fait des audiogrammes pour savoir s'ils perdent l'ouïe. Cela permet de gérer leur problème s'ils en ont un et de savoir s'ils peuvent être indemnisés ou non.
Il y a des risques sur le plan de l'ergonomie. Cela me fait toujours sourire quand je vois à la télévision que l'armée a acheté tel ou tel équipement. Cet équipement est-il ergonomique? Le militaire peut-il s'asseoir confortablement pendant six à douze heures? J'ai fait quelques voyages en char d'assaut, et je peux affirmer que ce ne sont pas les meilleurs voyages que l'on puisse faire. On doit effectivement évaluer le volet ergonomique.
Il existe également des risques sur le plan biologique. On parle de guerres au moyen de virus, de l'anthrax, etc. Il existe des moyens de gérer cela.
Finalement, la discussion de ce matin porte sur les risques psychosociaux, le fameux stress post-traumatique, la dépression et l'anxiété.
Comment évalue-t-on les risques? Il faut visiter les postes. Il faut élaborer un scénario selon lequel militaire sera déployé, que ce soit en Afghanistan, au Kosovo, etc.
Il faut consulter la description de tâches. Un colonel responsable des communications ne joue pas le même rôle que le major ou le caporal qui est sur le champ de bataille. Les risques auxquels il est exposé sont donc différents. L'évaluation des risques dépend de ce que fait le militaire et de l'équipement qu'on lui donne. Si on lui donne un petit jeep non couvert, qu'il n'est pas armé et qu'il doit aller dans une zone en détresse, c'est plus stressant et plus désagréable. C'est ce qu'on appelle un risque.
En médecine du travail, il existe une théorie peut-être idéaliste, qui consiste à essayer de réduire le risque à zéro. Malheureusement, au cours des opérations policières et militaires, on ne peut pas réduire le risque à zéro. Il n'y a pas de risque zéro sur les champs de bataille ou lors de l'arrestation de quelqu'un.
Il existe cependant des façons d'essayer de tendre vers le zéro. Il y a tout l'équipement fourni. Par exemple, pour les policiers, il y a la veste anti-balles, le type de fusil. C'est la même chose pour les militaires. L'équipement, les véhicules et le reste sont importants. Si je sais que je suis dans un bon véhicule sécuritaire, qui pourra faire dévier les balles qui pourraient être tirées, je serai plus à l'aise. Ce sera moins stressant.
Deuxièmement, on doit avoir une formation appropriée. On en parle souvent. Si je n'ai jamais conduit un char d'assaut et que je dois le faire en Afghanistan, ce n'est pas comme conduire ici, sur la route 148. Il y a des différences. Il y a d'excellents programmes de formation. C'est important, la formation.
Troisièmement, il y a aussi la protection personnelle. Tout l'équipement qu'on peut avoir, par exemple les walkies-talkies pour la communication, devient très important. Finalement, une fois qu'on a du bon équipement, qu'on a bien formé nos militaires et qu'on s'est assuré qu'ils avaient tout l'équipement de protection et de communication nécessaire, il y a le programme de surveillance médicale. Qui placer dans telle fonction? On s'entend sur le fait que, pour conduire un char d'assaut, il faut avoir une bonne vision. Si on ne voit rien, même si on sait bien le conduire et qu'on a le meilleur équipement, on n'ira pas loin. On s'entend sur le fait qu'il faut faire vérifier sa vision.
Maintenant, sur le plan psychologique, c'est un peu plus flou. En d'autres mots, quand il s'agit de déterminer qui va conduire ces chars d'assaut et qui on va envoyer en Afghanistan, on peut vérifier l'aptitude des militaires par des examens physiques. Les militaires ont un programme assez bien fait en ce qui touche l'évaluation des risques. Quelqu'un qui souffre de haute tension artérielle et de diabète peut perdre sa vigilance et, s'il ne peut pas manger à midi tous les jours, son taux de sucre baissera et il pourra avoir des problèmes sérieux. On s'entend tous là-dessus.
Sur le plan psychologique, des tests ont été validés en ce qui a trait à la personnalité, pour savoir comment une personne réagit au stress. Dans certaines organisations, on fait ce test depuis 1998. On a donc une certaine expérience. Il n'y a pas un test qui donne des résultats infaillibles et sûrs à 100 p. 100. Ces tests ont été validés pour éliminer les gens qui ne peuvent pas travailler quand il y a du stress ou qui ont une condition préexistante qui peut se détériorer. Si une personne a déjà été malade psychologiquement, elle ne sera pas rejetée automatiquement, mais il faut vérifier comment elle réagit à cela. Le stress peut vous écraser ou vous faire grandir. Il faut découvrir l'expérience de l'enfance, l'expérience d'abus. Ici, il faut faire attention. Je connais mes amis des droits de la personne et je les respecte. Il ne s'agit pas d'éliminer tout le monde, mais si la condition du monsieur ou de la madame risque de se détériorer de façon catastrophique, je ne l'exposerai pas à cela. Les connaissances médicales sont de plus en plus poussées, et on sait que si la personne a tel problème, cela ne marchera pas.
Pour ce qui est de l'admissibilité d'une lésion professionnelle, on a toujours dit que les militaires étaient des gars armés avec des uniformes qui ne souffrent pas de stress post-traumatique. De plus en plus, la recherche scientifique nous indique que les microtraumatismes, des expositions à de petits risques, la peur de mourir, des situations catastrophiques, un enfant mort, des restes humains, etc., peuvent sans aucun doute affecter quelqu'un. Il faut s'occuper de cela. Souvent, en cas de stress post-traumatique, si le dépistage n'a pas été fait, la personne va sombrer dans l'alcool, la drogue, et elle aura des problèmes juridiques. On essaie d'identifier cela, parce que c'est clair, comme vous l'a dit madame mardi: on devient dysfonctionnel, on ne sait plus ce qui est important ou non, on est tout croche. Souvent, ce sont des signes qui nous font dire que la personne souffre peut-être de stress post-traumatique. Combien de fois dans ma carrière ai-je vu des gens qu'on congédiait et qui étaient malades. S'ils sont malades, il faut les soigner et après on verra ce qu'on fera. Cela arrive encore assez souvent. On sait que les militaires, comme les policiers, n'ont pas l'habitude d'aller voir le psychologue quand cela ne va pas bien. Les signes cliniques du stress post-traumatique ne sont pas évidents.
On a des spécialistes qui peuvent poser le diagnostic de stress post-traumatique, comme Mme Brillon qui est venue mardi, mais on n'en trouve pas à tous les coins de rue. On peut les compter sur les doigts de la main. Ce n'est pas évident de faire un tel diagnostic. Avant de poser un diagnostic de stress post-traumatique, il y a beaucoup de travail à effectuer. Tous les liens entrent en jeu. C'est très difficile à faire.
De plus, moins on y croit pas et plus on rend le diagnostic difficile, plus les symptômes augmentent. On nous demande alors si la personne exagère ses symptômes. Quand le gars voit un psychologue, il commence à comprendre pourquoi il est dysfonctionnel. Il commence à comprendre que tel jour, quand il n'a pas eu le temps de tirer, il a eu peur de mourir durant cinq minutes et après il est devenu dysfonctionnel. Le diagnostic est difficile à faire. Oui, il y aura plusieurs médecins, plusieurs psychologues. Et plus on aura tendance à avoir une confrontation, plus la symptomatologie sera grave, avec toutes les complications qui en découleront.
Pour que la personne soit admissible, elle doit avoir subi un traumatisme. Par le passé, on disait que le simple fait de voir ce genre de choses à la télévision pouvait causer un traumatisme. Aujourd'hui, c'est la perception qui compte. Des changements juridiques ont été apportés en ce sens. En d'autres mots, selon des notions défendables médicalement, le fait que la personne ait eu peur de mourir et qu'il y ait eu décompensation lors de l'événement pourrait être suffisant. C'est ce qui compte.
Pour ce qui est des militaires qui voient des amis mourir à la télévision, on a essayé d'établir un principe. Il faut que ces gens soient témoins de l'événement. Il peut s'agir, par exemple, d'une personne appartenant à un détachement dans lequel un char d'assaut a sauté au cours d'une mission. On a des lignes de conduite pour ce genre de cas. Il est évident que la jurisprudence permet de déterminer les balises.
Il est un peu curieux de constater, dans le cas du stress post-traumatique, autant pour les policiers que pour les militaires, qui détermine l'admissibilité. La rumeur veut que la première demande soit toujours refusée. Pourtant, si un militaire se fracture le bras en tombant d'un char d'assaut, on ne remet pas la chose en question. Ce n'est pas le cas pour le stress post-traumatique, et je suis un peu mal à l'aise face à cela. En effet, si on détermine, diagnostic à l'appui, qu'il y a eu un traumatisme, l'addition est facile à faire. Mais qui le fait?
Le problème est que ce sont des gens à l'interne qui voient les militaires. Ça s'applique également à la GRC. Il faut se demander si leur fonction première est d'assurer qu'il y ait des effectifs pour les missions ou de voir à ce que des gens non fonctionnels n'y participent pas. Trois types de spécialistes interviennent dans le processus. D'abord, les spécialistes médicaux se chargent de déterminer si oui ou non la personne est admissible. Ensuite, des spécialistes en médecine du travail font un diagnostic. Par exemple, on peut dire à un individu que son audiogramme n'est pas normal et que ça justifie une pension de même qu'un appareil. On l'envoie alors voir un spécialiste. C'est notre devoir de le faire, sur le plan de l'éthique, en tant que médecins spécialistes de la santé au travail.
Une fois qu'on a déterminé la maladie et l'indemnisation, il faut soigner la personne. Pour ce faire, on peut faire appel à des civils. Il faut que le traitement se fasse de façon objective. Si c'est le même psychologue ou le même psychiatre qui se charge du traitement, on peut se demander comment les choses vont finir. Il y a ensuite toute la réadaptation. Il s'agit de soutenir non seulement l'individu mais aussi sa famille. Pour ce qui est de l'invalidité, on n'a pas de statistiques directes. En moyenne, un vrai stress post-traumatique dure de deux à sept ans. On dit que dans le cas des vrais traumatismes, les chances que l'individu reprenne son travail sont de 30 p. 100. Par contre, il peut faire autre chose. Je termine là-dessus.
Merci.
:
Ce serait une bonne idée.
Lors de nos déploiements, l'équipe médicale, qui était formée du psychologue en chef, du médecin, du responsable de la sécurité, faisait des visites annuelles à tous les militaires. On sait que lors de ces visites, le militaire n'a pas tendance à demander une consultation. C'est pourquoi on posait plusieurs questions sur ce qui avait été fait. En d'autres mots, il s'agit de ce qu'on appelle une intervention précoce. Il ne s'agit pas de debriefing parce qu'il n'y a pas de stress post-traumatique. On veut simplement savoir ce qu'ils font.
Quand un militaire nous dit que lorsqu'il était à Haïti, il a été retenu dans un barrage pendant deux jours, je le crois parce que je l'ai vu. Il est important que l'équipe aille sur place. Cela confère une crédibilité lors du debriefing, puisqu'on comprend des choses.
Avant d'aller en Afrique, on m'a dit que je ne croirais pas ce que les gars disaient, mais quand on y est allé, on les croit. Je sais que les militaires ont accès à un service médical, mais c'est un service de premiers soins. Nous appelons cela une reconnaissance des risques, un contrôle de ce qui se passe.
Ainsi, quand je vais à Haïti pour voir mes 100 membres, on leur donne des trousses de premiers soins et je vérifie s'ils ont pu voir un psychologue, s'ils ont utilisé leur trousse de médicaments contre la diarrhée et s'ils ont eu la grippe, parce qu'on parle de pollution, etc. On tâche de bien reconnaître tous les risques potentiels. On vérifie aussi si certains incidents pouvant mettre en lumière des questions de stress qu'ils ne pouvaient percevoir se sont produits.
Prenons un exemple. Un policier canadien pourrait avoir le mandat de se rendre sur une montagne pour arrêter quelqu'un. Quand on arrête quelqu'un, les gens ne sont pas contents. Si on n'arrête pas cette personne, on peut avoir des problèmes et si on l'arrête, on peut avoir encore plus de problèmes. Ensuite, il faut descendre de la montagne pendant deux heures sans savoir ce qui peut arriver.
Ce policier vit donc un stress. Va-t-il craquer ou pas? Je ne le sais pas. En ce qui a trait aux militaires, il y a ce qu'on voit à la télévision, mais c'est un peu maquillé. Parfois, on devait partir à 7 heures, mais on est parti à midi.
Je crois toujours qu'il est important qu'il y ait une visite d'une équipe professionnelle neutre, qui évalue les risques pour mieux comprendre ce que ces gens vont vivre au retour.
:
C'est une très bonne question.
Lorsqu'un militaire ou un agent revient d'une mission, il fait l'objet d'une évaluation médicale du rapatriement. À la Gendarmerie royale du Canada, où j'ai travaillé, nous avions l'habitude de faire des tests psychologiques. Ces tests étaient effectués tôt, avant le déploiement. Si, au retour du membre, on s'apercevait de changements que le membre lui-même n'avait pas remarqués, nous prévoyions une intervention précoce.
Deuxièmement, comme vous le savez — et je ne sais pas s'il en va de même pour les Forces armées — pour administrer ces tests psychologiques spéciaux, il faut avoir recours à un psychologue spécial, et malheureusement, ils font payer un peu plus cher. Il y a beaucoup de tests neuropsychologiques, qui coûtent cher. Bien sûr, ce qui arrive en fin de compte, c'est qu'on refuse de vous payer, parce que vous devez faire approuver votre demande. Je ne comprends pas cela. Si j'avais été en Afghanistan où j'avais subi un traumatisme, et le médecin des Forces armées me disait que je souffrais de stress, si on refusait de payer les services psychologiques dont j'avais besoin tant que je n'avais pas fait approuver ma demande, je dois dire que je ne pourrais pas accepter cela.
Mais voilà ce que fait la GRC. Elle refuse de payer tant que la demande n'a pas été approuvée. Donc, cela suppose d'ores et déjà une confrontation en ce sens que l'intéressé doit se battre, et c'est justement dans ce contexte qu'on entend toutes ces histoires d'horreur, du genre: « On ne me crois pas. Le traitement de mon dossier a été retardé parce que je dois leur fournir toutes sortes de détails à ce sujet. » C'est là qu'il se trouve, l'obstacle. Voilà ce que j'ai observé dans les cinq années où je m'occupais de ce genre de choses.
En ce qui concerne la Commission des accidents du travail de l'Ontario et la CSST au Québec, si vous souffrez de stress, on vous dira: très bien, nous allons payer les frais psychologiques, mais plus nous avons de détails sur vous, mieux nous pourrons vous aider à vous réadapter.
Nous avons appris des choses. Nous faisions exactement la même chose il y a une dizaine d'années. On leur disait: « Pas question. Vous êtes policier et vous avez voulu être policier. Nous vous avons envoyé à Regina pendant six mois. Vous savez… en tout cas, c'est impossible. » Eh bien, ce genre d'approche ne marche plus. Une intervention précoce et l'acceptation du diagnostic permettent d'éliminer ces barrières.
Voilà la nature du problème.
:
Oui, et en fait, c'est un employeur, c'est-à-dire aux Forces armées et à la GRC, etc., de bien choisir les gens. Vous ne diriez pas qu'une personne qui ne voit pas bien devrait conduire un véhicule d'urgence muni de lumières clignotantes qui permet immédiatement de savoir que c'est un agent de police. Il n'y a pas de désaccord à ce sujet-là.
En ce qui concerne l'éventualité de problèmes psychologiques, c'est à l'étape de la présélection qu'il faut éliminer certaines personnes, avant qu'il y ait des traumatismes. Malheureusement, si j'ai fait l'objet de sévices physiques, psychologiques et sexuels quand j'étais petit, à présent je suis devenu dysfonctionnel; je ne vais pas bien réagir au stress. Voilà un exemple d'un profil psychologique prétraumatisme. Malheureusement, si une telle personne est exposée au stress, elle va craquer.
Comme vous le savez, nous avons l'obligation, en vertu du Code de la santé et de la sécurité, de nous assurer de mettre la bonne personne au bon endroit parce que si nous, l'employeur — qu'il s'agisse des Forces canadiennes ou de la GRC — mettons quelqu'un dans une situation stressante alors qu'il ne peut pas tolérer le stress et qu'il tombe malade par la suite, on va nous intenter des poursuites. Avant qu'Anciens combattants Canada accorde toutes ces pensions, les membres nous intentaient des poursuites, et certains continuent à le faire. On les voit parfois à la télévision qui disent: vous m'y avez envoyé alors que vous saviez très bien que je ne devais pas y aller.
Donc, nous avons la responsabilité, pour des raisons de santé et de sécurité, de choisir les bons candidats ayant le profil psychologique approprié. Malheureusement, il faut éliminer certaines personnes à l'étape de la présélection, mais c'est vraiment le minimum. Comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas parce que vous êtes divorcé ou que vous avez des problèmes en ce qui concerne la garde de vos enfants que je vais refuser de vous y envoyer. Parfois les gens ont envie d'y aller, parce qu'ils pensent que cela va leur faire une petite pause, qu'ils vont gagner plein d'argent, etc. Donc, il faut absolument que je fasse un choix. Je travaille avec une équipe de spécialistes ou de psychologues, et c'est nous qui prenons la décision. Nous rencontrons même la femme de l'intéressé pour voir comment elle va réagir. Nous essayons de préparer le retour.
Donc, ce n'est pas noir et blanc; il y a une zone grise. Mais c'est faisable, si vous avez les bonnes priorités et une idée de ce qu'il faut faire.
:
Cette observation est très juste, et c'est toujours difficile à évaluer.
Chaque détachement militaire a sa propre équipe médicale, mais dans quelle mesure peut-elle assurer un soutien psychologique? C'est pour cette raison que nous avons mis sur pied un programme d'aide aux employés, et donc, George peut venir me voir s'il est malade. Donc, c'est possible, et nous facilitons l'obtention de ce genre d'aide.
Dans le cadre de notre mission, nous avons un détachement de policiers, et nous avons également un programme d'aide aux employés qui nous permet de voir les signes chez quelqu'un qui se croit trop bon, par exemple, ou qui se prend pour Mère Theresa — une personne qui veut en dire trop et qui en fait trop. Donc, nous établissons des profils qui nous permettent de voir ce genre de trait de caractère.
Par contre, je ne sais pas dans quelle mesure un soldat en Afghanistan peut vraiment parler à quelqu'un. Bien entendu, il peut toujours parler à George, mais George se trouve au même niveau que lui, et il pourra vous aider, étant donné qu'il utilise le même genre de canon et porte le même uniforme. Mais il faut qu'il aille parler à un sergent professionnel, mais il y a un danger en ce sens que si vous donnez cela à quelqu'un, vous allez accroître son niveau de stress, au lieu de le gérer. L'objectif consiste à gérer le stress tout au cours des activités et donc à ne pas prendre de risques. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'on ne peut pas prévoir tous les risques, mais si vous connaissez le pire scénario, vous pouvez y réagir.
Donc, existe-t-il un programme d'aide aux employés? Y a-t-il un collègue qui puisse voir les signes et s'adresser tout de suite à un psychologue pour faire le bilan? J'ai visité un détachement et j'ai justement dû rapatrier un soldat qui n'arrêtait pas de dire qu'il était trop bon. Il m'a suffi de faire un tour dans sa voiture avec les autres Forces de l'ONU pour comprendre qu'il avait un problème.
Des fois, malheureusement — et c'est ça qui donne lieu aux histoires d'horreur qu'on nous raconte à la télévision — le soldat ne sait pas qu'il est stressé; il ne sait pas qu'il réagit de façon excessive. Bien entendu, si vous êtes son ami, vous pouvez ne pas savoir quoi faire. Est-ce normal? Est-ce le George que je connais aujourd'hui? C'est pour cette raison qu'un professionnel doit faire une évaluation en bonne et due forme. C'est pour cela que nous allons dire à George qu'il doit aller consulter un psychologue, qui lui dira qu'il a bien rempli son rôle de soldat et qu'il est temps qu'il parte.
Nous rencontrons fréquemment ce problème, parce que nous avons beaucoup de détachements dans le Nord où les soldats sont déployés pour une période de trois ans. Ils veulent rester six ans, mais nous les renvoyons après trois ans. Ils ne comprennent pas qu'il est temps qu'ils reviennent à la vraie vie. Ils ne se rendent pas compte de la façon dont ils réagissent. Ils dorment avec leurs armes et cela influe sur leur moral, mais ils ne s'en rendent pas compte. Si nous les examinons avant le déploiement et si, pendant que la mission est en cours, nous allons faire une vérification afin d'évaluer le degré de stress associé à leur situation — nous savons combien il y a eu de blessures physiques et combien de blessures psychologiques — c'est là que nous pouvons éviter que des membres tombent malade ou aient des problèmes psychologiques à leur retour.
:
Je vais vous expliquer.
Nous accomplissons une mission en Jordanie, où nous faisons de la formation de policiers. Le profil requis en Jordanie est le suivant. Il nous faut des militaires ou des policiers de grande expérience. Ils n'ont pas de fusils et ils n'ont aucune interaction avec la population. Il est possible que certains hommes aient des appareils auditifs, que d'autres prennent des pilules pour la haute pression ou le diabète. Les hôpitaux de Jordanie sont comme les nôtres. Ces hommes peuvent donc aller dans une pharmacie avec leurs prescriptions.
D'autres sont au Darfour. Ils couchent dans des tentes et ils sont à environ 200 kilomètres de Khartoum. Évidemment, on ne peut pas y envoyer quelqu'un dont l'appareil peut bloquer et briser. Je parle de choses physiques. Si les lunettes de quelqu'un brisent, on ne peut pas l'envoyer chercher une nouvelle paire de lunettes. Il n'y a pas de docteur. Que faire si sa pilule pour la pression est débalancée, ou s'il n'en a plus?
C'est la même chose pour le profil psychologique. Au Darfour, le profil psychologique requis est qu'il n'y ait de problèmes de santé mentale qui nécessitent une thérapie, un médicament, etc.
Je respecte ce que madame a dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un as eu des problèmes dans son enfance qu'il sera refusé automatiquement, mais on veut voir comment il va réagir. Certains réagissent positivement et grandissent. D'autres sont écrasés et blessés pour le reste de leur vie.
Oui, on en refuse. Participer à une mission est payant. Beaucoup attendent à la porte et je suis obligé d'en refuser plus que j'en accepte. Il faut que je sois certain que le pauvre policier qui a 45 ans et qui veut aller au Darfour pendant un mois — dans la GRC, c'est neuf mois — soit capable de faire tout cela. Malheureusement, je suis obligé de refuser, non pas parce qu'il est malade, mais parce qu'il n'a pas le profil médical requis et que je n'ai pas les moyens médicaux de le soutenir. La GRC a établi qu'on offre le même appui médical qu'ici à nos policiers à travers le monde. C'est plausible. En d'autres mots, on ne leur dira pas qu'ils peuvent mourir d'une crise cardiaque. On va les transférer dans un hôpital de haut niveau où ils peuvent recevoir des soins coronariens. Quand je faisais mes visites dans les missions, j'établissais la méthode d'évacuation.
En ce qui a trait aux militaires, quand c'est assez gros, ils ont leur propre base. Ils ont tout cela et ils le font très bien avec l'Allemagne. Ce sont les normes qu'on établit.
:
Le problème est qu'il y a deux écoles de pensée. Je suis un spécialiste de la surveillance médicale. Quand on travaille à la Monnaie royale, on travaille avec de l'or, de l'arsenic, du plomb, du mercure. Lorsque j'y fais des analyses d'urine à des fins de dépistage, je trouve de ces métaux: c'est établi.
En ce qui concerne les tests psychologiques, c'est un peu plus intrusif. Les psychologues sont un peu plus réservés quand il s'agit de trancher. C'est délicat. On n'a pas un pouvoir absolu. En revanche, de plus en plus, on a des outils.
Les gens des droits de la personne, avec qui j'ai souvent travaillé et que je respecte, me disaient que si je soumettais M. Roy à un test, il fallait que je teste tout le monde. En outre, ils me demandaient de leur prouver que cela ferait une différence ou pas. Je peux défendre les cas des cinq années où j'ai appliqué ce programme à la GRC. Toutefois, je dois justifier chaque cas que je refuse, car les gens des droits de la personne me talonnent et je m'expose à un grief. Cela ne me pose aucun problème, car cela fait partie de mon travail, mais ce n'est pas facile. Il faut être vigilant: un test d'urine ne me dira pas si le militaire testé est un meilleur soldat ou non, mais on teste tout le monde.
En principe, il faut s'arrêter sur la qualité de notre intervention, car ce sera à la base de notre décision de le déployer. C'est pour cette raison que cela prend un bon équipement. Voici ce qui se faisait chez les militaires: ils avaient le meilleur gars, mais quant à l'équipement, ils s'en remettaient à lui pour s'en occuper, pour actionner le choke afin de faire démarrer le véhicule.
Tout cela fait partie de la formation. Si on me donne un nouvel équipement et que je ne suis pas formé... J'ai beau avoir la meilleure radio, mais si je ne sais pas m'en servir, c'est inutile. La même chose vaut pour l'équipement de protection personnelle. Ce sont souvent des stress que les gens ont.
Si j'ai un mauvais char d'assaut et que je n'ai pas le bon uniforme, parce que tout le monde me voit à trois kilomètres, je suis stressé, et quand j'aurai un stress, je vais craquer plus vite. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut faire des tests psychologiques, mais il y a quatre critères en cause: un bon équipement, une bonne formation, une bonne protection personnelle et le bon examen médical. C'est un tout. On a souvent insisté seulement sur l'aspect médical ou seulement sur l'équipement. Voilà ce qu'est un programme de surveillance médicale.
:
À la GRC — et là je vous parle des chiffres qui étaient pertinents au moment où je l'ai quittée — c'était 2 p. 100. Ce qui est curieux, c'est qu'à la CSST — soit la commission des accidents du travail du Québec, qui est la seule commission provinciale à indemniser les gens pour des maladies d'ordre psychologique — ces cas-là représentent 2 p. 100 de notre charge de travail. Nous avons à traiter 300 000 cas par an, mais seulement 2 p. 100 d'entre eux concernent des problèmes psychologiques.
Le problème qui se pose, dès lors qu'il est question de troubles psychologiques ou de droits liés à une maladie de ce genre, c'est qu'ils perdent deux fois plus de temps. Si, en moyenne, il faut compter 250 jours pour une blessure, c'est 500 jours dans ce cas-là. C'est ça le problème.
L'autre problème qui se pose, dès lors qu'il s'agit de maladie psychologique, c'est que non seulement on perd deux fois plus de temps, mais il y a un certain pourcentage de personnes qui sont totalement handicapées. Ces personnes sont incapables de retourner travailler. C'est ça la grande inquiétude.
Les chiffres ne sont pas si catastrophiques. Là je vous parle de la GRC et de la CSST; c'est pour ces deux organismes que j'ai des chiffres. Je n'ai pas de chiffres pour les Forces armées canadiennes. Mais, en fin de compte, cela représente deux fois plus de temps perdu et il faut comprendre que jusqu'à 50 p. 100 de ces personnes sont complètement handicapées et ne peuvent donc pas retourner travailler.
Malheureusement — et je vais conclure là-dessus — les statistiques de 2006 concernent l'ancienne méthode. Comme vous le savez, pour le SSPT, la nouvelle méthode est axée sur l'intervention et l'admissibilité précoce, la gestion rigoureuse des cas par des psychologues compétents, l'EMDR, etc. Si vous les envoyez chez un psychologue, ils sauront raconter tout ce qui leur est arrivé de négatif dans leur vie, depuis 0 ans à 10 ans, mais cela ne va pas les aider à reprendre leur capacité normale. Donc, une fois que l'admissibilité a été établie, nous estimons que nous devrions exercer un certain contrôle sur les traitements. Si un sujet se contente d'aller voir n'importe qui, on va lui dire: allez consulter un naturopathe. Il va peut-être se sentir mieux mais, en fin de compte, il ne va pas vraiment guérir. C'est pour ça que nous devons exercer un certain contrôle afin de garantir le succès de nos efforts.
Selon moi, si nous maintenons cette position rigoureuse au cours des cinq prochaines années, les statistiques ne seront pas plus mauvaises.
:
C'est vrai ce que vous dites.
Selon ce que j'ai observé, le message qu'on leur communique est celui-ci: « Vous avez droit à une pension pour le SSPT, George, et vous avez donc droit à des services de soutien psychologique. » Donc, il va voir le psychologue et le psychologue lui dit: « Eh bien, ils ne veulent pas me payer. Selon eux, vous avez besoin de seulement deux visites. »
Donc, pour moi, il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne l'aide qu'il faut fournir aux membres. Une fois qu'on a établi qu'il y a droit, et après s'être longtemps battu, il faudrait qu'il puisse s'adresser à quelqu'un pour obtenir de l'aide. Je sais
[Français]
que dans le cas des anciens combattants, il y a la Légion royale canadienne.
[Traduction]
Il faut absolument qu'on leur communique de l'information sur leurs droits. Très souvent, en ma qualité de médecin de la GRC, je leur disais: « Vous avez droit à telle chose. » Mais ils me répondaient en disant: « Non, si je vais voir le psychologue plus de cinq fois, ils vont dire que j'ai un problème. »
Donc, ils n'ont pas une idée claire de ce à quoi ils ont droit ni à qui ils peuvent s'adresser pour obtenir de l'aide. Il y a un agent de liaison qu'ils peuvent appeler. C'est une sorte de prolongation du programme d'aide aux employés. Mais si vous appelez Anciens combattants Canada, vous allez toujours tomber sur la mauvaise personne au mauvais moment. C'est très compliqué.
Je suis médecin et j'ai donc des privilèges particuliers, même à la GRC. Je sais à quelle porte je dois frapper. Mais si personne ne me répond, qu'est-ce que je dois faire? Pour le pauvre soldat, vous savez… Il y en a un qui a appelé Gatineau, alors qu'il était à Charlottetown, et c'était pour quelque chose de fort simple.
Donc, les communications sont mauvaises. Il faut absolument les améliorer. Le plus souvent, dès lors qu'il y a un processus, on lui greffe toutes sortes d'éléments. On dit au soldat: « Bon, George, votre gestionnaire de cas s'appelle Ginette. » Alors, il appelle Ginette, mais il n'y a pas de… S'il veut une paire de chaussures, il doit appeler Untel; s'il veut des soins psychologiques… c'est tellement compliqué. Voilà ce qui leur rend la vie difficile.
Ils viennent me dire: « Bon. J'ai le syndrome du stress post-traumatique. On peut me traiter, je peux en parler, mais chaque fois que je demande quelque chose il faut voir la réaction! » Malheureusement, ces gens-là se mettent en colère. Ils se mettent en colère et ils raccrochent le téléphone. Ils disent: « George n'est pas content, alors il ne faut pas lui parler ». On fait parvenir à George une lettre recommandée dans laquelle on dit: « George, ne nous appelez plus. » Vous savez, ça fait partie de la maladie. Ces personnes deviennent dysfonctionnelles et ne comprennent plus ce qui devrait être compréhensible.
Par conséquent, il faut leur faciliter la chose, et les changements opérés dans cette intention-là donnent déjà des résultats.
:
Robert, je vais faire pas mal de « mémérage » . Vous allez confirmer ou démentir ce que je dis. Je pense qu'il y a de sérieux problèmes à régler. Je m'intéresse au stress post-traumatique depuis 1998.
Je veux faire un commentaire à l'intention de Mme Hinton. Oui, il y a de nombreux très anciens combattants, ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre de Corée, qui ont de sérieux problèmes. Depuis 1998, chaque année, le 11 novembre, j'assiste à la cérémonie en vue de souligner la fin de la Première Guerre mondiale. Quand on voit des hommes de 85 ans et 90 ans pleurer, c'est parce qu'ils ont des problèmes quelque part entre les deux oreilles. Ce n'est pas un événement qui devrait faire pleurer. Si l'ancien combattant pleure, s'il tremble, c'est qu'il a des problèmes.
Ce qui se produit aussi du côté de nos très anciens combattants — et Pierre, qui est ici présent, va le confirmer —, c'est qu'ils se retrouvent à la Légion canadienne. Je n'ai rien contre cette organisation, mais les gars vont soigner leur stress post-traumatique en buvant du gros gin. C'est ce qu'ils font depuis qu'ils sont revenus de la guerre parce qu'avant la guerre, ils n'avaient pas de problème d'alcoolisme.
L'épouse du président de la Légion canadienne de Deux-Montagnes, Victor Smart, disait à ce dernier qu'il était un bon gars mais qu'il réglait son problème entre les deux oreilles avec du gros gin. La façon d'arriver à traiter le stress post-traumatique est de changer cette opinion qu'ont les nouveaux et les très anciens combattants, selon laquelle un militaire ou un gars qui a fait la guerre et qui a des problèmes entre les deux oreilles est un faible, un nobody. À Valcartier, les psychologues se trouvent au deuxième étage: les militaires appellent cela « l'escalier de la honte ». Ils montent au deuxième étage rencontrer une personne qui va vérifier s'ils ont des problèmes entre les deux oreilles. Je m'excuse d'employer un terme aussi vulgaire, mais il sont vus comme des tapettes. Il faut essayer de vaincre cette peur de se faire soigner.
Il y a un autre problème que j'aimerais soulever— et je n'ai pas d'expérience à ce sujet — et vous pourrez me dire si j'ai tort ou raison. Au milieu ou à la fin des années 1990, on a commencé à s'intéresser au stress post-traumatique. Je me demande si nous avons présentement assez de psychologues formés dans ce domaine, ou dans quelque chose de semblable, pour détecter la maladie et soigner les personnes atteintes. Ne faudrait-il pas en former davantage? J'ai l'impression que c'est peut-être une nouvelle science, une nouvelle maladie pour eux aussi. Ne pourrait-on pas trouver les moyens d'en former un plus grand nombre?
Je veux aussi répondre à David. Dans les forces armées, comme Mme Brillon l'a dit — et elle fait affaire avec Valcartier, au Québec —, il n'y a aucun psychologue.
:
Comme ces gens ne consultent pas un psychologue de façon volontaire, nous avons décidé d'aller les visiter et de faire une évaluation.
Quand je vais à Port-au-Prince, le psychologue et moi nous partageons les membres moitié-moitié et nous les rencontrons. Nous avons une petite liste de questions que nous leur posons pour évaluer s'ils sont stressés et comment ils fonctionnent. Nous visitons leurs installations et, par la suite, nous faisons des évaluations.
Il faudrait faire cela dans le cas de nos militaires qui sont en Afghanistan. Ce ne sont pas les gens qui sont sur place et qui soignent avec des plasters qui devraient le faire. Je n'aime pas le mot « audit », mais c'est une espèce d'évaluation que nous effectuons. Pour ma part, lorsque le soldat revient en congé, je lui dis de venir me voir. C'est ce que nous faisons. On dépiste la maladie, et il faut le faire.
Il y a un deuxième aspect. Des psychologues, il y en en grand nombre au Canada, mais des spécialistes en stress post-traumatique, il n'y en a pas assez, et il faut s'assurer qu'ils connaissent le sujet. Dans le cas d'autres organismes, on a dit à ceux qui désiraient soigner le stress post-traumatique qu'on leur donnerait une formation sur ce à quoi on s'attend et sur nos objectifs. C'est une forme d'agrément que l'on accorde à ces gens.
Qu'ils soient à l'intérieur des forces ou non, le problème, c'est que leur salaire est payé par le même organisme dans les deux cas et qu'il peut y avoir apparence de conflit d'intérêts.
Supposons que le Dr Perron est le psychologue des forces et qu'un soldat doit le rencontrer. C'est lui qui peut lui retirer le droit de fonctionner, etc. Donc, il faut qu'il y ait un psychologue des forces pour déterminer les normes, ce qu'on va verser en compensation, comment on va le faire, qui on réfère à des ressources indépendantes, mais il faut que ce soit un psychologue indépendant qui soit vu en premier, et ensuite celui des forces armées va valider la décision. On ne peut pas — et c'est le problème dans les forces — demander à un psychologue de diagnostiquer le stress post-traumatique, de le traiter et de déterminer quand la personne peut reprendre ses fonctions. Malheureusement, une même personne ne peut pas porter les trois chapeaux.
Sur le plan professionnel, les forces ont besoin de psychologues pour évaluer ce dont elles ont besoin, établir des statistiques, les soumettre au comité pour voir ce qu'il y a à faire, mais il faut aussi des ressources spécialisées. De plus, on ne peut pas faire venir le soldat d'Halifax à Montréal, ou de Montréal à Vancouver, et ainsi de suite.
Il est possible de bâtir un tel système. J'ai travaillé pour des organismes nationaux. Nous avions nos psychiatres, nos psychologues dans chaque territoire, dans chaque province, dont la fonction était validée par un psychologue administratif qui nous disait que tel traitement ne fonctionnait pas nécessairement. Donc, il faut des traitements qui sont éprouvés. Il faut se méfier, car les gens qui souffrent de stress post-traumatique se font manipuler par toutes sortes de psys. En ce qui nous concerne, il faut que le traitement ait fait ses preuves. La personne atteinte peut se faire dire d'aller voir un naturopathe et de manger des graines de lin, mais cela n'aidera pas à redresser son moral. Et pour cette raison, il faut quelqu'un qui s'y connaisse. Donc, il faut un psychologue dans les forces, des gestionnaires, ainsi que des ressources externes spécialisées, autorisées par les forces et indépendantes des forces pour le diagnostic. Et il faut aussi visiter nos militaires pour vérifier ce qui se passe en Afghanistan et quel est le niveau de stress qui s'y vit.
Nous avions un questionnaire pour évaluer le niveau de stress. On veut savoir si tous nos gens en Afghanistan dorment bien. On peut le savoir en les visitant. En gestion de la santé et sécurité au travail, cela fonctionne selon le modèle de la pyramide. À la base, si tu as beaucoup de gens qui ne dorment pas, il y en a d'autres au sommet qui seront en dépression. C'est clair. C'est comme cela qu'on gère cela. Donc, quand on va voir ces gens, si l'on constate qu'ils ont des poches sous les yeux jusqu'au menton et qu'ils n'ont pas dormi depuis une semaine, que l'on couche à cet endroit et que l'on ne dort pas parce qu'il y a trop de bruit, cela donne une idée du niveau de stress. Et le lendemain, il y a un char d'assaut à faire fonctionner, etc. Quand ils seront exposés au stress, c'est cela qui va les faire craquer. Donc, il faut que cet environnement soit connu, parce que quand quelqu'un souffre de stress post-traumatique, ce qui compte, c'est ce qui se passe dans sa tête avant, pendant et après.