NDDN Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
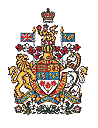
CANADA
Comité permanent de la défense nationale
|
l |
|
l |
|
TÉMOIGNAGES
Le mercredi 27 septembre 2006
[Enregistrement électronique]
[Traduction]
La séance est ouverte.
J'aimerais souhaiter la bienvenue à notre témoin d'aujourd'hui, le général Michael Jeffery, qui participera à nos débats et notre étude sur la présence des Forces canadiennes en Afghanistan.
J'ai ici un très long curriculum de votre expérience militaire, monsieur. Je vais aller tout de suite à la fin, si vous n'y voyez pas d'inconvénients.
Il a été chef d'état-major de l'Armée de terre d'août 2000 à mai 2003 et il a pris sa retraite des Forces canadiennes le 1er août 2003, avec le grade de lieutenant-général. Il est aujourd'hui président honoraire de campagne pour la campagne du patrimoine de l'Artillerie royale canadienne.
Il est clair, monsieur, que vous avez les compétences voulues pour nous entretenir des questions que nous étudions. J'aimerais vous donner l'occasion de nous faire part de vos commentaires, puis nous passerons aux questions.
Le comité doit aussi examiner le budget prévu pour ses déplacements à Petawawa, Edmonton et Gagetown, alors je propose de réserver quelques minutes à la fin de la séance. Si nous avons épuisé nos questions et que nous pouvons conclure la séance entre 17 heures et 17 h 15, nous allons alors traiter des affaires du comité.
Monsieur, vous avez la parole. Je vous remercie d'être ici.
Monsieur le président, mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être ici. À ma dernière comparution, je portais l'uniforme. Évidemment, le contexte est bien différent, mais le sentiment d'être dans cette salle est passablement le même.
J'ai été commandant de l'Armée de terre pendant trois ans, et c'est ainsi que j'ai terminé ma carrière militaire après 39 ans de service. À titre de commandant de l'Armée, j'ai participé aux deux premiers déploiements en Afghanistan. À la lumière de cette expérience, je vais essayer d'apporter un certain éclairage sur la mission. Je tiens à préciser, toutefois, que je ne suis pas un spécialiste de la région; il s'agit d'une région du monde qui est complexe et je ne prétends pas être un expert d'aucune sorte.
Étant à la retraite depuis maintenant trois ans, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe au sein des Forces canadiennes. Je conserve des liens avec elles, mais je ne prétends pas connaître à fond tous ces détails, bien que je comprenne les défis que les Forces doivent relever.
De tous les endroits où les Forces canadiennes doivent se déployer, l'Afghanistan est l'endroit le plus improbable que je puisse imaginer. Curieusement, lorsque j'étais commandant de l'Armée de terre à la fin des années 90, nous avions entrepris des jeux de guerre pour tester de nouveaux concepts afin de déterminer quel type d'armée serait nécessaire au Canada au XXIe siècle. Pour ce jeu de guerre, nous avions choisi une région du monde qui présentait, pour les soldats que nous étions, les plus grandes difficultés et ce, à tous les égards. Nous avions choisi le Caucase, pas très loin de l'Afghanistan. C'était un coup de dé. Nous aurions pu choisir l'Afghanistan, sans jamais penser que nous aurions un jour à nous déployer dans cette région très complexe.
Nous avons compris toute l'ampleur de ce défi lorsque nous avons dû déployer le groupement tactique du 3 PPCLI dans la région en 2002. Comme l'Afghanistan n'a pratiquement aucune infrastructure, nous devions composer avec de longues liaisons de télécommunications et la nécessité de déployer et de soutenir presque tout par voie aérienne. Toutefois, malgré mes préoccupations, la mission était réalisable, en grande partie parce que nous faisions partie d'une brigade américaine, avec son infrastructure, mais aussi parce que les objectifs politiques étaient clairs: si tôt après le 11 septembre, il n'y avait aucun doute que nous luttions contre le terrorisme.
En l'espace d'un an, toutefois, nous envisagions la possibilité d'un déploiement dans le cadre de la FIAS, à Kaboul, ce qui me préoccupait davantage. Pour cette mission à l'époque, je sentais que les objectifs politiques n'étaient pas clairs, que la structure de commandement et de contrôle était incertaine et que le soutien stratégique pour l'opération était limité, ce qui créait, à mes yeux, une situation très risquée. Pour dire vrai, je n'étais pas en faveur de ce déploiement. Toutefois, il en a été décidé autrement.
Or, depuis ce temps, l'OTAN s'est établie dans la région et bon nombre des inquiétudes que j'avais au départ se sont dissipées. Les FC ont bien rempli leurs fonctions, et l'OTAN semble résolue à rester, du moins pour l'instant. En effet, après avoir tant investi en Afghanistan, nous devons, je crois, rester sur place et terminer le travail.
Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que nous n'avons peut-être pas la résilience nécessaire pour rester. Parlons d'abord de la capacité des Forces canadiennes de poursuivre cette mission à long terme. Soyons clairs: je crois qu'à tout point de vue, les Forces canadiennes ont fait un excellent travail en Afghanistan, et je crois que les commentaires de nos alliés le confirment. Je redoute toutefois qu'elles ne puissent soutenir la cadence, et on tarde à augmenter la capacité des FC. Si la situation ne change pas, je crois que les FC risquent de s'épuiser à long terme. Bien sûr, c'est l'Armée de terre qui assume, de loin, la plus grande partie du fardeau de cette mission.
Le deuxième aspect, qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que nous n'avons peut-être pas la volonté nationale de rester. Ce sera, à mon avis, un engagement de longue durée. Il n'y a pas de solution rapide. On passe à côté de l'essentiel à discourir sur les pertes. Personne, et moi le dernier, ne souhaite que nos jeunes militaires, hommes et femmes, se fassent tuer ou blesser. Mais si la participation canadienne était conditionnelle à l'absence de victime, nous n'irions nulle part. La vraie question est de savoir ce que nous essayons d'accomplir et si le sacrifice est justifié. Nous aurons cette volonté nationale seulement lorsque nous serons convaincus, comme nation, que les objectifs poursuivis en Afghanistan sont essentiels et que nous serons prêts à en payer véritablement le prix.
Monsieur le président, à mon avis, ces deux aspects — la capacité militaire et la volonté nationale — sont les vrais défis que n'importe quel gouvernement devra relever à mesure que notre mission en Afghanistan évolue et, selon moi, ce sera là un véritable test de leadership.
Monsieur le président, voilà qui conclut ma déclaration. Je vais essayer de répondre à toutes les questions que voudra me poser le comité.
Merci beaucoup.
Nous allons commencer la première ronde de questions avec l'opposition officielle, pour sept minutes.
Monsieur Dosanjh.
Merci, général, de venir nous parler.
Vous avez parlé de la capacité des FC de soutenir la cadence à long terme, et vous croyez que pour accomplir cette mission, nous devons rester à cet endroit très longtemps. Selon vous, que doit-on changer précisément pour que la cadence puisse être ajustée et pour que nous réussissions la mission?
Si vous me permettez de situer cela dans un contexte stratégique, jusqu'en 1990 environ, les Forces canadiennes étaient déployées principalement en Europe, sur une base plutôt préventive. Nous conservions des forces de taille raisonnable. Les effectifs variaient, mais à une certaine époque, nous comptions plus de 90 000 militaires. Les réductions se sont succédées et nous comptons maintenant 62 000 éléments, mais même ce nombre varie de jour en jour.
Durant la même période, dans les années 90 jusqu'au début du XXIe siècle, les Forces canadiennes ont vu leur cadence augmenter constamment. Nous allons dans la mauvaise direction, et nous le savons. Lorsque j'ai comparu ici en uniforme, j'étais inquiet. J'ai dit à cette époque que nous faisions face à une crise démographique, puisque non seulement nous avions ce problème, mais nous avions le problème du vieillissement de la population canadienne — que tous les membres du comité comprendront, je crois. Le bassin dans lequel nous puisions les recrues se rétrécissait.
Nous aurions pu avoir cette discussion il y a dix ans et, à de nombreux égards, la situation ne s'est pas améliorée. Cela ne veut pas dire que les Forces canadiennes n'ont pas commencé à régler leurs problèmes de recrutement, etc. Un pourcentage toujours plus grand de recrues remplace les militaires qui quittent. Nous avons de la difficulté à régénérer les forces que nous avons aujourd'hui, sans parler d'accroître la capacité. À moins d'augmenter considérablement les effectifs, nous allons épuiser nos soldats, parce que nous les utilisons et les réutilisons à un rythme effréné.
L'idéal est d'envoyer un soldat en affectation de six mois tous les trois ans. Les situations difficiles de combat ou d'opération, comme en Afghanistan, sont très exigeantes, même s'il n'y a pas beaucoup de combats. Nous demandons à nos soldats d'aller là-bas tous les 18 mois. Ils sont chez eux pendant moins d'une année et ils doivent repartir. Ce n'est pas viable.
Lorsque vous avez entrepris des exercices après le 11 septembre, vous dites que dans le Caucase, vous saviez clairement que les terroristes étaient l'ennemi et que vous faisiez essentiellement des exercices antiterroristes. Avez-vous songé, à un moment quelconque, au soulèvement qui pourrait surgir dans ces pays si nous y allions et à la façon dont nous pourrions y faire face?
Si vous me permettez d'apporter quelques corrections, l'exercice que nous avons effectué dans les années 90 s'est déroulé avant le 11 septembre, évidemment, et nous tentions d'analyser le monde dans lequel nous allions vivre. Nous croyions déjà que le monde allait être beaucoup plus complexe et qu'avec la fin de la guerre froide, nous allions voir apparaître des guerres asymétriques: un grand nombre de petits joueurs qui essaient de battre les grands joueurs, si vous voulez utiliser des termes simples. Cela change la nature même du conflit. Toutes les tactiques changent et vous devez adapter l'armée en conséquence. Cette perspective animait nos réflexions.
Au début de 2000, nous avons élaboré une stratégie de l'armée de terre qui a transformé fondamentalement le type d'opérations que nous allions entreprendre. À bien des égards, le général Hillier, le CEMD, a poursuivi ces idées. Vous pouvez donc observer ce changement.
La chose nous est apparue clairement tout de suite après le 11 septembre, lorsque nous avons été mis devant cette réalité. L'Afghanistan en a été la première expérience. À cette époque, je n'aurais pas dit que c'était une opération de contre-insurrection; c'était une opération de contre-terrorisme, de recherche et de destruction, pour dire bien franchement. C'était ce genre d'opération. Mais si vous voulez qualifier ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, ce sont davantage des opérations traditionnelles de contre-insurrection.
Ma question sera peut-être injuste et je ne veux pas dénigrer nos forces, mais j'aimerais avoir une réponse. Croyez-vous que les Forces canadiennes sont bien entraînées et bien préparées pour ce genre de contre-insurrection? Je ne sais pas si vous avez besoin de chars dans une contre-insurrection. Je ne sais pas si vous avez besoin de pilotes de chasse. Je ne suis pas un militaire. Je suis un profane qui est aussi un parlementaire, alors je pose mes questions dans un langage de profane. Les Forces canadiennes sont-elles préparées à mener le genre de contre-insurrection dont nous parlons? Bien sûr, nous avons de braves soldats qui font un excellent travail, mais le fait d'être entraîné pour pareille contre-insurrection est une autre chose.
Je crois personnellement que les Forces canadiennes sont parmi les forces militaires les mieux entraînées du monde. Elles conviennent parfaitement non seulement aux opérations de contre-insurrection, mais à bien d'autres. Mais permettez-moi d'expliquer mon point de vue.
Il est important, je crois, de définir ce qu'est une contre-insurrection, du moins de mon point de vue. Vous avez, au départ, une partie de la population ou une organisation d'insurgés à l'intérieur d'un État-nation ou d'une région qui fomente une agitation politique, qui essaie de déstabiliser le gouvernement et, tôt ou tard, de le renverser. La solution, ce n'est pas de mener de simples combats. Ce que vous devez faire, c'est éliminer cette force d'insurrection, mais ce faisant, vous devez faire en sorte de gagner et de conserver, à défaut d'un meilleur terme, les coeurs et les esprits de la population visée. Vous devez avoir la population de votre côté. Si elle n'y est pas dès le départ, vous devez la gagner, et toute une dynamique entre en jeu: politique, développement, reconstruction, toute une gamme d'enjeux. Il se peut même que la force militaire n'ait pas de contrôle. C'est une question politique et la force militaire est un appui. Cela ne veut pas dire que la sécurité n'est pas importante. Si les insurgés créent de la violence, vous forcent à vous battre, alors vous devez vous en débarrasser. Votre défi est de revenir le plus rapidement possible à cette conquête des coeurs et des esprits, et si vous échouez à ce chapitre, aucun combat ne va régler le problème.
Je ne sais pas si vous voulez que je poursuive, mais vous avez parlé des chars et des pilotes. Je ne sais pas si ce...
Vous n'avez plus de temps pour cette question, mais gardez-la en tête, si vous pouvez en reparler plus tard. Nous allons poursuivre.
Merci, monsieur Dosanjh.
Monsieur Bouchard, vous avez sept minutes.
[Français]
Merci, monsieur le président.
Merci également pour votre présentation.
Vous êtes un lieutenant-général, vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez sans doute mené beaucoup d'opérations de ce genre. À l'heure actuelle, plusieurs militaires en mission en Afghanistan sont décédés.
Selon vous, quel est l'effet de ces pertes sur le moral des troupes des Forces canadiennes en opération? Cet effet se fait-il sentir uniquement pendant une journée ou se fait-il sentir aussi par la suite? Disposons-nous de mesures permettant de contrer ces pertes qui peuvent miner le moral des autres militaires?
[Traduction]
Je vous remercie de poser la question, monsieur le président.
Tout d'abord, je dois vous présenter mes excuses; je vais vous répondre en anglais. Mon français se perd de plus en plus et je ne voudrais pas vous l'infliger, ni à vous ni au comité.
Oui, nous avons eu des pertes en Afghanistan, mais les pertes sont inévitables dans un conflit et dans le travail des soldats et, à mon sens, compte tenu du type d'opérations que nous avons effectuées, les pertes sont relativement faibles. Elles sont difficiles à accepter pour un pays qui n'a pas connu de pertes depuis longtemps, mais elles sont relativement faibles, et les soldats ont le même sentiment.
Cela ne veut pas dire que chaque perte n'est pas importante. Chaque perte est importante pour nous tous; elle est particulièrement importante pour le soldat qui perd le compagnon à côté de lui. C'est une question grave, mais quand la chose se produit, le soldat se concentre avant tout sur le travail à terminer. C'est ce qu'il fait, même si la perte d'un grand ami est douloureuse. Le problème surgit durant une pause — lorsque le combat ou l'opération est interrompu —, quand vous avez du temps pour vous asseoir et réfléchir.
Toute une série d'études ont été menées, au cours du dernier siècle, sur la guerre et le combat. Je dirais qu'aujourd'hui, les Forces canadiennes sont probablement aussi bien préparées que n'importe quelle autre force dans le monde — et mieux que je ne l'aurais imaginé, compte tenu de notre histoire — pour offrir des services de counseling aux soldats, pour les aider à surmonter leur deuil, à retourner au travail et à passer à autre chose.
La nature humaine étant ce qu'elle est, la plupart des soldats vont réprimer très rapidement ces inquiétudes tant qu'ils sont dans le théâtre des opérations. La chose refait surface lorsqu'ils sont de retour au pays. Lorsqu'ils reviennent au Canada, auprès de leur famille, la pression tombe et c'est alors que le problème surgit. C'est souvent à ce moment-là que le syndrome de stress post-traumatique, le SSPT, apparaît, et c'est l'un des graves problèmes avec lesquels nous devons composer.
Je vais revenir à ce que je disais. C'est un effet secondaire compréhensible, et le moral des soldats sera bon en autant que certaines conditions sont réunies. L'une des conditions, et la plus importante, est de pouvoir dire, lorsqu'ils reviennent au pays, que leur ami ou leur compagnon est mort pour une bonne cause. S'ils ne peuvent le faire, nous avons tous un problème, et c'est ce qui mine le moral.
L'autre condition est la suivante: l'institution que nous sommes — les Forces canadiennes et le gouvernement du Canada — doit aider ses soldats à surmonter ce problème et ses répercussions, quoi qu'elles soient. Tant que ces conditions seront réunies, je ne crois pas que le moral sera atteint. Je ne dis pas que c'est facile pour chaque soldat de composer avec la mort, mais le moral ne sera pas atteint.
[Français]
Monsieur le général, vous avez dit que les Forces canadiennes ne pouvaient garder le rythme. J'ai cru comprendre qu'à ce rythme, il y aura peut-être essoufflement. J'ai cru comprendre également qu'avec leur mission en Afghanistan, les Forces canadiennes se retrouvent devant un véritable défi.
Les troupes canadiennes se battent-elles plus que celles des autres pays impliqués dans cette guerre en Afghanistan? Quels pays sont le plus utiles ou impliqués, comme le Canada, dans cette mission en Afghanistan?
[Traduction]
Si vous me le permettez, monsieur le président, je vais répondre à cette question en essayant de me mettre à la place d'un commandant, comme le commandant de la FIAS.
Dans pareille situation, un commandant a affaire à une force multinationale et la première chose dont il doit tenir compte, c'est la nature du travail, la mission et la taille du secteur où il se trouve. Ce n'est pas uniforme. C'est très complexe. Certains secteurs sont paisibles, d'autres sont plus difficiles et d'autres encore sont terribles, et vous ne voulez même pas envoyer des troupes à ces endroits. L'idéal serait d'avoir des troupes ayant le même niveau de capacité, de professionnalisme et de contraintes, mais ce n'est pas le cas.
Premièrement, un commandant reçoit des troupes dont l'emploi a été limité par leur gouvernement national respectif. Vous l'avez vu. Certains pays ne seront pas autorisés à se déployer dans certains secteurs du pays. Ce n'est pas à moi de décrier cette situation, parce que le Canada a fait la même chose, pas nécessairement en Afghanistan, bien que certaines contraintes seront imposées dans ce pays. Dans d'autres régions du monde, nous avons souvent envoyé des troupes dont l'emploi était limité par d'importantes contraintes politiques.
Deuxièmement, vous devez tenir compte du professionnalisme et de la capacité globale de la force. Certains éléments sont très professionnels, bien entraînés, bien équipés, etc. D'autres ont une capacité moindre. Le commandant doit composer avec toutes ces contraintes pour effectuer les tâches qui lui sont confiées. La réalité, selon mon jugement et je dirais selon le jugement de bien d'autres observateurs, c'est que le Canada figure parmi les trois ou quatre meilleures forces que l'on trouve en Afghanistan. Les Britanniques, les Américains et peut-être les Hollandais font partie de cette catégorie, mais le Canada en fait certainement partie aussi et, comme on le dit familièrement, c'est un match de poids lourds. Dans ce contexte, un commandant va utiliser les troupes canadiennes là où il en a besoin.
Alors, dans un sens, le Canada supporte une plus grande part du fardeau parce qu'il a les troupes pour le faire, et n'importe quel commandant de n'importe quel pays ferait pareil. Chose peut-être plus importante, on peut se demander si c'est déraisonnable. Est-ce une part disproportionnée? D'après ce que je vois à l'heure actuelle, la réponse est non. Nos troupes sont beaucoup moins nombreuses dans la région, quel que soit le pourcentage que nous utilisons, que celles des autres pays. Nous avons toujours eu de la difficulté à égaler l'engagement des autres pays envers les opérations internationales. Voilà une des rares occasions où nous figurons parmi les premiers, et je crois qu'il est grand temps qu'il en soit ainsi. Je ne crois pas que nous supportions une trop grande part du fardeau. Les pertes que nous avons subies ne sont pas disproportionnées par rapport à nos troupes ou au type d'opérations que nous avons entreprises.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Merci, général, de comparaître devant nous aujourd'hui. Je tiens à vous remercier de votre franchise. Sans cela, tout le système que nous avons ici ne peut fonctionner, alors c'est très apprécié.
J'aimerais revenir à un certain nombre de choses. Vous avez dit entre autres que nous devrions rester et « terminer le travail », même si vous avez mentionné que vous aviez eu certaines réticences au début. Encore une fois, je vous remercie de votre franchise à ce sujet.
J'aborderai d'autres aspects, mais je vais vous demander ce que signifie pour vous « terminer le travail ». Autrement dit, lorsque telle ou telle chose est réalisée, comment pouvons-nous dire « Mission accomplie »?
J'aimerais citer d'autres personnes qui s'intéressent à ceci depuis un certain temps, en commençant par Leo Docherty, ancien aide de camp du commandant des forces britanniques, qui a dit que la mission était une leçon sur la manière de saboter une contre-insurrection; le ministre actuel de la Défense nationale du Canada a dit qu'il n'y avait aucune solution militaire à cet endroit; un commandant afghan a affirmé publiquement « Les étrangers sont venus en disant qu'ils aideraient les pauvres et redresseraient la situation économique, mais ils n'ont investi que dans leurs opérations militaires. Les pauvres sont encore plus pauvres maintenant que lorsque les talibans étaient au pouvoir. Nous ne leur faisons plus confiance. Nous serions fous de continuer à croire leurs mensonges. » L'avant-dernière citation est du président Karzaï, qui était ici la semaine dernière. Il a dit « Ce n'est pas en bombardant l'Afghanistan que nous réglerons le problème des talibans et on ne peut faire échec au terrorisme en lançant des bombes sur des villages. »
Cela m'amène à l'un des points que vous avez soulevés, à savoir qu'il est primordial de mettre la population de votre côté. Je n'ai pas noté les mots exacts que vous avez utilisés, mais je crois que l'essentiel était que vous êtes en grande difficulté si vous ne le faites pas, que c'est essentiel à la mission.
Nous envoyons maintenant d'autres chars. Nous sommes en train de détruire une grande partie de l'infrastructure et des villages par suite de la force que nous avons dû utiliser pour contrer l'ennemi et, par le fait même, un grand nombre d'Afghans se demandent comment nous pouvons être leurs amis. Nous voulons les aider, mais après avoir tout fait exploser. Et maintenant, nous expédions des chars.
Alors ma question est la suivante: tout cela étant dit, comment déterminons-nous qu'une mission est réussie? Deuxièmement, comment allons-nous mettre la population de notre côté si les combats que nous menons actuellement détruisent tout ce qui l'entoure et si un grand nombre d'Afghans se retrouvent dans des situations encore pires qu'auparavant? Comment, selon vous, les Forces canadiennes réussiront-elle la quadrature du cercle?
Monsieur le président, si vous me le permettez, j'aimerais répondre à ces questions dans l'ordre inverse. Je parlerai d'abord de la population. Je suis d'accord avec vous sur un certain nombre d'aspects, et c'est une question d'équilibre.
Je ne suis pas médecin, mais permettez-moi d'utiliser une analogie médicale. Nous connaissons tous l'infection à streptocoque du groupe A, cette maladie mangeuse de chair qui envahit le corps assez rapidement, si bien que les chirurgiens doivent effectuer une opération plutôt délicate pour empêcher l'infection de tuer le patient. À de nombreux égards, la situation en Afghanistan est similaire. Vous dites que nous ne pouvons gagner les coeurs et les esprits en bombardant des villages, et vous avez tout à fait raison. Toutefois, vous devez parfois le faire et éliminer la maladie — le terroriste, dans ce cas-ci —, sinon, ce n'est qu'une question de temps avant que le patient ne meure. C'est exactement la situation à laquelle nous devons faire face ici.
Les commandants militaires ne veulent pas nécessairement utiliser la force; ils essaient plutôt de trouver cet équilibre. Mais lorsque les talibans et les insurgés reprennent des forces ou rétablissent leur position dans certains secteurs et exercent de nouveau leur emprise sur la population locale, l'environnement ne vous permet pas de mener des opérations de stabilisation — de reconstruire, de développer, de chercher et trouver des solutions politiques au problème — parce que ce cancer est au beau milieu du corps. D'où le défi.
Vous avez raison; l'essentiel est de trouver cet équilibre. Dans certaines régions en Afghanistan, comme dans toute autre campagne d'insurgés,il y aura des moments où l'équilibre ne sera pas atteint parce que vous devrez utiliser davantage la force pour des raisons de sécurité. Le défi consiste à le faire le plus rapidement possible et de revenir à une approche équilibrée et faire en sorte que le reste du pays ne soit pas infecté.
Comment définir la réussite? Je ne sais pas comment vous pouvez le faire. Je ne peux certainement pas vous donner une équation objective et parfaite en disant « faites ceci, faites cela, et lorsque vous aurez atteint x, y et z, voilà ce que vous allez réaliser ». Je peux toutefois vous donner une idée du genre de choses que nous devons rechercher.
Tout d'abord, nous devons avoir un engagement continu de la part du monde occidental — non pas un engagement rhétorique, mais bien réel et manifeste — pour faire comprendre au gouvernement et à la population de l'Afghanistan que nous n'allons pas les laisser tomber. Je crois que c'est un grave problème présentement; il y a toujours cette inquiétude.
À l'heure actuelle, les organes du gouvernement doivent être établis: l'organe politique, que vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais qui occupe une place importante; les organes de sécurité de l'État; la force militaire; la police; la règle de droit — voilà le genre de choses qu'il faut mettre en place.
Essentiellement, le soutien international, du moins du point de vue militaire, doit se transformer, passant d'une présence sur la ligne de front à un soutien, une disponibilité. Nous sommes encore très présents sur la ligne de front. Nous faisons beaucoup d'efforts pour que l'armée nationale afghane et sa force policière soient en mesure d'occuper la ligne de front. Lorsque ce sera fait, vous saurez que vous avez réussi quelque chose, que vous pouvez aller de l'avant. Vous jugerez alors si vous réduisez la force dont vous disposez. Vous déciderez à quel moment vous commencez à le faire. Toutefois, des progrès évidents doivent être accomplis dans ce genre de choses pour pouvoir dire que vous avez réussi.
Je comprends ce que vous dites. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on ne trouve pas d'équilibre dans le sud de l'Afghanistan. L'envoi de chars fait pencher la balance. C'est ce qui nous préoccupe.
Mon autre question — et je vais vous laisser y réfléchir, si vous voulez faire des commentaires sur ce que peut signifier l'envoi de ces chars... La balance penche davantage en faveur de l'artillerie lourde, des combats massifs et de la destruction.
Vous avez dit, monsieur, que nos troupes ne pouvaient plus tenir le coup après 18 mois, ce qui a piqué ma curiosité. Que fait un commandant sur le terrain lorsqu'on lui dit que la mission continue, mais que les troupes ne sont pas là ou ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions? Qu'arrive-t-il alors? Le commandant dit-il au ministre « Je ne peux pas remplir la mission dont vous me chargez parce que je n'ai pas les effectifs suffisants », ce qui force alors notre retrait, s'il n'y a pas de renforts? Que fait un commandant à ce moment-là, s'il n'a pas ces soldats qui, comme vous le dites, sont déjà surmenés, pour utiliser mes propres mots?
Le fait est que les hommes et les femmes en uniforme ont le devoir de partir et de faire ce qu'il faut faire. Nous avons envoyé des soldats en Europe en 1939, qui ne sont pas revenus avant 1945. Si vous voulez un scénario extrême, voilà ce que vous pouvez faire.
Nous avons raccourci ce temps, en exigeant toujours davantage. Alors vous pouvez le faire et, à moins de directives contraires, c'est ce qu'un militaire fera, en général.
Ce que j'espère, ce que je crois, c'est que nous ne devrions pas en arriver là. Ce que nous devons faire, c'est augmenter la capacité le plus rapidement possible.
Merci, monsieur le président.
Merci, général, d'être avec nous aujourd'hui. Votre présence est vraiment appréciée.
Au cours des dernières semaines, nous avons entendu toutes sortes de suggestions, de tous les coins du pays, préconisant différentes mesures à prendre en Afghanistan. Les commentaires les plus intéressants que j'ai entendus sont ceux du chef du NPD, qui suggère que nous retirions nos troupes, que nous nous défilions, pour ainsi dire.
J'ai plusieurs questions et voici la première: quel impact aurait le retrait de nos troupes d'Afghanistan, premièrement sur nos soldats, deuxièmement sur notre réputation internationale et troisièmement, ce qui est encore plus important, sur la sécurité des Canadiens au Canada et dans le monde?
Je ne crois pas que nous devrions partir, mais je serais irresponsable si je vous disais que nous n'avons pas le choix. Il y a toujours un choix. La situation en Afghanistan, comme dans n'importe quelle région du monde, pourrait en fait se détériorer au point où je recommanderais notre retrait. Comme on dit, celui qui s'enfuit pourra reprendre le combat. Il y a un peu de cela.
Je crois sans l'ombre d'un doute que si nous ne gagnons pas ce combat ou un volet important de la guerre contre le terrorisme ici, ce sera beaucoup plus difficile lorsque nous devrons le combattre ailleurs. Nous devons donc rester. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas partir si les circonstances le justifient, mais si nous partons, nous signifions clairement aux insurgés, compte tenu de ce que j'ai dit à propos de la contribution du Canada et de sa position dans cette région, qu'ils ont gagné. Notre retrait serait un stimulant pour eux, mais un coup dur pour le monde occidental, nos alliés, si on songe à l'engagement collectif. Les engagements militaires du Canada ont miné sa crédibilité pendant longtemps. Il gagne du terrain à ce chapitre, mais il pourrait le perdre très rapidement.
Pour dire vrai, l'impact sur le moral, sur l'état d'esprit des Forces canadiennes ne serait pas positif. Les soldats n'aiment pas effectuer des tâches difficiles et partir avant que le travail ne soit terminé. Ils n'aiment surtout pas que leurs compagnons restent sur le champ de bataille sans gagner la bataille, sans que la mission ne soit terminée. Ce serait dur pour eux. Mais tout cela pourrait arriver si les circonstances le justifient. C'est une décision difficile.
On demandait aussi quels seraient les effets sur la sécurité des Canadiens au pays et dans le monde.
À court terme, aucun effet; à long terme, je crois que l'impact serait important. À mon avis, il ne s'agit pas seulement de veiller sur l'État naissant de l'Afghanistan, compte tenu de son histoire récente ou ancienne. Je crois très fermement qu'il s'agit ici d'une campagne à long terme pour notre mode de vie, pour les valeurs occidentales et le mode de vie occidental. D'importants segments d'insurgés ont pour objectif de faire en sorte que notre mode de vie s'arrête.
Je crois donc qu'à long terme, les Canadiens seraient moins en sécurité, parce que nous allons nous battre contre eux quelque part. Si ce n'est pas en Afghanistan, ce sera ailleurs, et ce sera beaucoup plus coûteux.
Ma deuxième question fait suite à vos commentaires sur la durée idéale d'un déploiement. L'idéal serait une affectation de six mois aux trois ans. À l'heure actuelle, nos soldats partent en affectation tous les 18 mois, et ce rythme n'est pas viable.
Quel est l'impact sur notre capacité de nous engager dans d'autres missions? Comment ce niveau de déploiement, cette fréquence de déploiement agit sur notre capacité?
Je ne pense pas que je comprends bien la question, monsieur le président. Je vais donner une réponse très courte.
La capacité des forces terrestres, navales et aériennes est limitée, et les compétences des militaires ne sont pas transférables. Si je décide d'envoyer un pilote de chasse dans une tranchée en Afghanistan, je vais probablement susciter des rires, et je ne réglerai pas vraiment le problème. Les militaires ont des compétences différentes. Simplement en raison de la nature de la tâche à accomplir, une grande partie du travail doit être exécuté par les forces terrestres. La Marine et l'Armée de l'air peuvent exercer bien des fonctions, et elles le font de plus en plus. Des pilotes et des officiers de la Marine commencent notamment à participer aux travaux de reconstruction. C'est une évolution positive et une utilisation de plus en plus optimale de nos ressources. Mais il demeure que ce sont les forces terrestres qui jouent le plus grand rôle dans l'exécution de la mission.
Selon moi, le ratio est de cinq pour un. Comme cinq et un font six, cela signifie qu'on déploie des troupes pour des missions de six mois tous les trois...C'est dire qu'on peut déployer à la fois un sixième de l'Armée de terre. Vous vous demandez sûrement pourquoi ce n'est pas davantage. Ce pourrait l'être, mais il faut voir quelle est la limite qui peut être assumée. Il faut penser qu'au terme d'une mission, les militaires ont besoin d'un certain temps pour se remettre, et ensuite, ils doivent commencer à s'entraîner pour la prochaine opération. La durée de la mission et de la période qui suit représente au moins six mois. Si l'on tient compte des conditions météorologiques et de toutes les autres tâches à accomplir, c'est probablement davantage.
Il y a environ 2 500 militaires en Afghanistan — et si nous prenons en compte toutes les missions, ce nombre s'élève à 3 000 — et parmi eux, environ 18 000 font partie de l'Armée de terre, qui elle compte au total environ 12 000 militaires.
J'ai une dernière question à vous poser.
Vous avez abordé la question de la volonté nationale. À la lumière de vos commentaires au sujet de l'importance de cette mission et des investissements que nous avons faits jusqu'à maintenant, comment pouvons-nous faire en sorte, selon vous, que la volonté nationale demeure?
Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre simplement ni rapidement. De nombreux facteurs entrent en jeux. L'un d'eux, mais non le moindre, est l'histoire militaire des 50 dernières années et la perception qu'ont les Canadiens d'eux-mêmes et de l'armée, qui est en train de changer et qui doit évoluer.
Dans mon exposé, j'ai dit que tout dépend de la capacité à mobiliser. Je ne montre personne du doigt; je vous l'assure. J'estime que j'ai moi-même un rôle à jouer à cet égard, comme c'était le cas lorsque j'étais militaire. Je pense que tous les militaires, les politiciens — peu importe leur allégeance — les gens d'affaires et les universitaires se doivent de comprendre ces problèmes complexes et de guider la population canadienne. Nous sommes devenus, à mon humble avis, paresseux et irresponsables à l'égard de ce qui constitue une responsabilité collective sur la scène internationale.
Je vous remercie beaucoup. Voilà qui met fin à la première ronde de questions. Dans la deuxième ronde de cinq minutes, nous allons commencer par l'opposition officielle et ensuite, ce sera au gouvernement, au Bloc québécois et de nouveau au gouvernement.
Allez-y, monsieur.
Merci, monsieur le président.
Je vous remercie beaucoup, monsieur le lieutenant-général, de comparaître devant nous aujourd'hui. Permettez-moi d'abord de prendre un instant pour rendre hommage à vous, pour votre carrière, ainsi qu'à nos militaires.
J'ai l'impression que vous êtes en train de dire que bien des soldats, et vous-même, s'interrogent au sujet du bien-fondé de cette mission et de ce qui se passe là-bas.
Je ne crois pas que nos soldats se demandent pourquoi ils sont là bas, mais je pense que bien des Canadiens se demandent pourquoi nos soldats sont là-bas. Si la population ne croit pas fermement que nous devons être là-bas, alors cela peut avoir d'importantes répercussions sur nos soldats. Je profite de l'occasion pour exprimer une opinion.
Les soldats feront ce qui est nécessaire. Ils vont subir les conséquences de cette mission, c'est-à-dire les pertes de vie et tout le reste. Le débat politique qui a lieu en ce moment à propos de ce que notre pays devrait faire ne pose aucun problème. Cela n'inquiète pas les soldats. Ils sont capables de faire la distinction entre un débat politique légitime dans le cadre duquel on se demande si nous devrions ou non être là-bas et ce qu'ils perçoivent comme un manque de volonté de continuer la mission malgré les difficultés.
D'accord, merci.
Vous avez aussi indiqué qu'il faut trouver un équilibre entre l'aspect militaire et le côté humanitaire de la mission, et vous avez déclaré qu'il faut venir en aide aux populations locales et obtenir leur confiance. Même si vous ne participez pas directement à la mission, pouvez-vous me dire si, à votre avis, on a trouvé cet équilibre.
Je dois d'abord dire, très honnêtement, que je ne me suis pas rendu en Afghanistan depuis 2002 et que je suis à la retraite depuis trois ans. Je ne suis donc pas au courant de ce qui se passe précisément sur le terrain. Mes propos sont fondés sur ce que je connais.
Il y a eu quelques problèmes. Dans certains cas, des membres de la communauté internationale qui s'étaient engagés à mener des travaux de développement et de reconstruction n'ont pas respecté leur engagement. Je ne parle pas du Canada; il s'agit d'un effort international. Je crois qu'environ 36 pays sont présents en Afghanistan; la participation est grande. Parfois, c'est pour des raisons de sécurité que les travaux n'ont pas lieu. C'est surtout dans le sud du pays que la sécurité a posé des problèmes.
Je tiens à souligner que ce n'est qu'au début de cette année que nous avons pris le contrôle du sud du pays. C'est l'une des régions les plus difficiles. Il nous faudra du temps. Quant à savoir si, au quotidien, l'équilibre est atteint, je ne peux pas vous répondre parce qu'il faudrait être là-bas pour pouvoir le constater.
Vous avez dit qu'il nous faudra du temps. Combien de temps faudra-t-il pour revoir les stratégies que nous avons employées jusqu'à maintenant et trouver peut-être une approche différente?
C'est difficile à dire. Je dirais qu'il faudra au moins 6 mois dans le sud étant donné ce qui se passe là-bas. Cela ne fait pas assez longtemps que nous sommes présents dans cette région. Ce n'est pas parce que nous avons éprouvé de la difficulté pendant un certain temps que cela signifie que la stratégie n'est pas bonne. Rappelez-vous que notre adversaire ne veut pas qu'on réussisse. Il fait tout en pouvoir pour nous en empêcher.
Examinez la situation dans son ensemble; pensez à combien de temps cela fait-il que la FIAS est présente là-bas. Elle a commencé son travail en 2002-2003. Ses équipes provinciales de reconstruction ont commencé à oeuvrer dans le nord pour ensuite se rendre dans l'ouest, et elles se dirigent maintenant vers le sud. En dernier lieu, elles iront dans l'est. Elles ont commencé dans les régions les plus faciles, et à mesure qu'elles se déplacent la situation devient de plus en plus difficile. Il leur a fallu deux ans pour en arriver là où elles en sont. Puisque le sud est une région difficile, il pourrait falloir plusieurs années. Et même beaucoup plus longtemps. Je ne veux pas vous induire en erreur, mais nos attentes doivent être établies en fonction de la gravité de la situation.
J'ai dit qu'il fallait au moins six mois pour étudier la stratégie. Et ce n'est pas certain que nous allons la changer. Il faut donner aux commandants là-bas au moins six mois pour déterminer si la stratégie fonctionne ou non. Normalement, ils pourront vous dire assez rapidement s'il faut la modifier.
Je vous remercie pour cette question.
Je vais donner la parole à M. Hawn d'abord et ensuite à un député du Bloc québécois.
Merci, monsieur le président.
Je vous remercie, lieutenant-général Jeffery. Lorsque vous étiez dans les forces armées, vous étiez du genre à aller droit au but, et je suis ravi de constater que vous n'avez pas changé.
J'aimerais poser des questions d'une autre nature. Nous avons parlé de l'adaptation et de la pérennité. Les Forces canadiennes ont mis sur pied un nouveau programme de recrutement plus accrocheur. Je présume que vous avez vu les publicités. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que ce programme sera efficace?
Je ne peux pas m'empêcher, monsieur le président, de penser à la campagne de recrutement lancée à la fin des années 1960 et au début des années 1970. M. Hawn et moi-même, nous nous souvenons de la publicité dans laquelle on voyait un jeune officier vêtu d'un bel uniforme vert descendant d'un 707 avec une mallette à la main. C'était un peu l'image du jeune cadre, qui ne correspond pas du tout à un soldat au combat. Nous avons fait beaucoup de chemin.
Depuis assez longtemps, je trouve que la nature et l'efficacité des publicités des forces armées laissent à désirer. Cela est attribuable en partie au fait que nous hésitons à appeler un chat, un chat. On n'ose pas dire clairement ce qu'un soldat, un marin et un pilote doivent faire. Il en va de même en ce qui a trait aux opérations de maintien de la paix. On nous laisse croire que nous avons des qualités particulières qui nous permettent d'accomplir des choses que les autres pays ne peuvent pas. La réalité, c'est que les militaires sont confrontés à des situations très difficiles. Ce dont nous avons fait abstraction depuis 20 ans, c'est la capacité d'un soldat d'accomplir de rudes tâches.
À certains égards, il s'agit donc là d'un changement positif. La publicité est honnête, et je crois qu'elle atteindra certains groupes de la population; mais il faudra un certain temps.
Ce qui me préoccupe un peu, c'est qu'on mette l'accent sur le terrorisme pour recruter. Du point de vue politique, je crois qu'il faut veiller à contrer le terrorisme, et j'estime que la population canadienne doit prendre part au débat. Toutefois, il ne faudrait pas que le terrorisme soit la principale raison pour laquelle on s'enrôle. La lutte contre le terrorisme est l'une des nombreuses missions des Forces canadiennes.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui, c'est bien.
Parlons maintenant du point de vue de la population canadienne, et, par extension, du gouvernement. Vous avez parlé du mythe au sujet des opérations de maintien de la paix auxquelles participe le Canada. À quel point ce mythe a-t-il eu une incidence sur la compréhension des Canadiens des missions à l'étranger et de la participation des Forces canadiennes à ces missions?
C'est difficile à évaluer, mais je dirais que l'incidence est considérable.
Il n'y a pas eu depuis très longtemps une opération traditionnelle de maintien de la paix, dans le cadre de laquelle on envoie des casques bleus pour empêcher des affrontements entre deux sociétés qui ne s'entendent pas, jusqu'à ce qu'elles règlent leur différend par voie politique. Je ne dis pas que des missions de la sorte n'auront plus jamais lieu, mais le fait est qu'il n'y en a pas eu depuis très longtemps. Le monde est aujourd'hui beaucoup plus complexe. Si les Canadiens pensent que nous pouvons envoyer des jeunes gens de notre pays dans des régions perturbées du monde sans leur fournir des armes et sans leur offrir le soutien moral nécessaire, comme c'était le cas jadis, alors nous tuons ces gens pour rien; je veux dire qu'ils meurent pour rien.
Je me souviens d'une mission des Nations Unies durant laquelle je dirigeais des soldats qui malheureusement n'avaient pas été préparés en conséquence. Il est souvent arrivé que nous mettions sur pied une mission à la dernière minute, pour diverses raisons — c'était il y a de nombreuses années — et nous envoyions des soldats qui n'étaient pas prêts à affronter ce qui les attendait. Si nous faisions cela aujourd'hui, le nombre de militaires qui reviendraient au pays dans des cercueils serait beaucoup plus grand.
Nous ne pouvons donc pas procéder ainsi; c'est un mythe. Il faut envoyer des gens autonomes et capables d'utiliser la force lorsque c'est nécessaire. Cela ne signifie pas que notre mission est de tuer des gens. Nous cherchons à éviter cela, mais il faut tout de même y être préparé.
Rapidement, croyez-vous qu'on doive accorder de l'importance aux commentaires d'un officier subalterne dont la principale tâche est de faire en sorte que les bottes du général brillent? Je parle de Leo Docherty, l'aide-de-camp du général britannique dont les propos sont souvent cités comme s'il était un expert pouvant juger de la réussite ou de l'échec de la mission.
Il faut toujours tenir compte de la source de la citation. Je ne peux pas en dire davantage, car je ne connais pas cette personne.
[Français]
Bonjour, monsieur le général. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui.
On a parlé tout à l'heure d'équilibre entre les interventions armées, l'aide à la reconstruction et l'aide humanitaire dans le pays. Pensez-vous que le Canada consacre actuellement suffisamment d'efforts à la reconstruction? J'ai entendu dire que lors de sa récente visite, M. Karzaï a mentionné que le Canada devrait s'orienter davantage vers la formation de militaires afghans, afin que le travail puisse être fait par eux-mêmes plutôt que par des militaires canadiens. Les efforts de nos forces armées en ce sens sont-ils suffisants?
[Traduction]
Je ne pense pas être en mesure de répondre honnêtement. Je dirais qu'étant donné l'ampleur de la mission, nous accomplissons beaucoup de travail sur le plan du développement en général, qui ne se limite pas à la reconstruction. Très peu de pays jouissent d'une position aussi importante en Afghanistan. Nous avons beaucoup d'influence à tous les niveaux sur le plan politique étant donné notre engagement là-bas. Nous dirigeons l'une des équipes provinciales de reconstruction et, bien entendu, nous commandons les troupes qui se trouvent dans une des grandes régions du sud. Notre influence est très grande.
Devrions-nous en faire davantage? Nous pourrions revenir à la question de l'équilibre. La contribution doit être plus grande. Je ne suis pas en mesure de dire qu'elle devrait provenir du Canada, car le problème ne concerne pas seulement notre pays. Comme je l'ai dit, c'est un problème dont doit s'occuper l'OTAN, voire l'Occident.
[Français]
Vous avez mentionné qu'il ne faut pas partir en laissant le travail inachevé en Afghanistan, mais un jour ou l'autre, il faudra partir de l'Afghanistan; on n'y sera pas éternellement. Il y a des nations beaucoup plus puissantes que le Canada qui ont dû partir d'un pays, comme l'ont fait les Américains au Vietnam. Ils ne sont pas partis dans la gloire, ils sont partis dans la déchéance après avoir failli à leur tâche.
N'y a-t-il pas un risque, si on retarde trop la décision de partir, que cela soit dangereux et que les conséquences soient pires?
[Traduction]
Certainement.
Il y a un risque — je vous mentirais si je vous disais qu'il n'y en a pas — mais, à mon avis, c'est une question de volonté. Étant donné que l'Occident a déclaré que l'Afghanistan est un pays où il faut faire en sorte qu'il puisse y avoir la prospérité et la paix et où il faut veiller à ce que les extrémistes talibans n'utilisent pas ce territoire comme base d'opération, nous avons l'obligation collective de voir à l'atteinte de ces objectifs. Je dirais que bien des pays concernés devraient se demander s'ils font leur part. Si nous choisissons de ne pas faire notre part à l'instar de certains pays, nous ne sommes alors pas mieux qu'eux. Je crois que nous pouvons faire mieux que ces autres pays; c'est mon opinion.
Si nous passons notre temps à dire que cette mission nous coûte trop cher et que nous devrions l'abandonner avant d'échouer, nous montrons alors aucun engagement, aucune volonté nationale. Nous sommes carrément lâches.
[Français]
Le Pakistan joue un rôle de plus en plus néfaste en Afghanistan. Nous n'avons qu'à penser au fait qu'il était dans une large mesure responsable du terrorisme implanté en Afghanistan et qu'il a joint par obligation les Américains dans leur intervention dans ce pays.
N'y a-t-il pas un risque que cela fasse déraper encore davantage l'intervention armée qui se déroule présentement en Afghanistan et qu'on soit obligé d'intervenir encore plus loin que dans ce pays?
[Traduction]
J'ai déjà signalé que je ne suis pas un spécialiste de cette région, et j'hésite plus ou moins à me prononcer davantage à cet égard.
Le Pakistan est un pays très complexe. Le président Musharraf est aux prises avec suffisamment de problèmes intérieurs, et c'est sans parler du problème que pose l'Afghanistan, problème que vient exacerber l'accord conclu récemment avec les talibans. Je pense qu'il ne plane aucun doute à ce sujet.
J'ignore quelle est la solution, mais quelle que soit celle retenue, tout dénouement positif passe par un engagement politique de la communauté internationale au Pakistan: il faut contribuer à la solution plutôt qu'au problème. Je ne suis pas convaincu que les mesures qui sont, à mon avis, nécessaires, ont été prises.
Merci, monsieur le président.
Merci de votre présence parmi nous, général.
Je vais m'éloigner un peu du sujet. J'ignore si vous avez suivi l'actualité ces derniers jours et si vous êtes au courant des commentaires formulés. Paul Martin, l'ancien premier ministre, a récemment critiqué la mission, affirmant que le Canada a perdu de vue son objectif initial en Afghanistan. Que pensez-vous de cette déclaration? Estimez-vous que l'objectif de la mission a changé depuis le déploiement initial des troupes? Selon vous, que se passerait-il si nous ramenions nos troupes à Kaboul et restreignions la capacité du commandement de l'OTAN de déployer les forces canadiennes? Faudrait-il y déployer nos troupes à l'heure actuelle? Que pensez-vous de cette déclaration?
Je ne sais pas si je veux commenter cette déclaration. Vous me permettrez cependant de préciser un point. Il ne fait aucun doute que l'objectif a changé, mais c'était voulu. Si vous relisez la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies autorisant l'intervention de la FIAS et examinez l'évolution de la stratégie employée, la mission initiale de la FIAS consistait à se déployer à Kaboul. Les choses ont changé considérablement depuis, et l'engagement du Canada également. Il s'agissait de décisions motivées prises par la communauté internationale, les Nations Unies et le Canada, quant à la participation de ce dernier en fonction de l'évolution de la stratégie. Il faut être prudent et ne pas refaire l'histoire à cet égard.
Quant à savoir si nous avons perdu de vue notre objectif, je ne me prononcerai pas sur ce point. J'en ai dit suffisamment. Je suis d'avis que nous sommes déployés là-bas et qu'il nous faut y demeurer. Je commence à me répéter, ce qui est toujours très dangereux. Je ne crois pas que nous devrions nous défiler.
Je vais aborder un autre point.
Aujourd'hui, un convoi militaire canadien a fait l'objet d'une embuscade de la part d'un kamikaze à Kandahar. Heureusement, aucun militaire n'a été blessé, mais le véhicule, le RG-31 Nyala, a été endommagé. J'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Je me rappelle que, au début du déploiement -- et ceci vient souligner votre commentaire précédent quant à l'évolution de la nature de la mission --, des militaires canadiens ont malheureusement péri lorsque leur véhicule Iltis a roulé sur une mine -- ou s'agissait-il plutôt d'un attentat-suicide à la bombe, d'un dispositif explosif en bordure d'une route ou d'autre chose --, il y a trois ou quatre ans. Notre matériel a évolué parallèlement à notre mission. Je sais que la question des chars et tous les autres aspects connexes ont été soulevés. Pouvez-vous nous dire si, d'après vous, la mission a changé et s'il nous faut par conséquent modifier notre matériel terrestre là-bas? Estimez-vous que le matériel dont disposent nos troupes actuellement permet à celles-ci de s'acquitter de leur tâche?
Monsieur président, je dois dire que la situation est complexe dans cette région. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Vous m'arrêterez si je dépasse les bornes.
Premièrement, la disponibilité constitue l'un des problèmes communs que vous devez affronter. Je veux dire par là que nous pouvons savoir ce que nous voulons et même avoir pris des mesures afin de l'obtenir, mais nous nous rendons compte que cela n'est pas disponible. Le véhicule Iltis en est un exemple caractéristique. Il a fallu s'en servir parce que c'était tout ce dont nous disposions. Ce n'était pas faute d'avoir reconnu qu'il était inadéquat. Nous avons en fait exercé des pressions pour accélérer le dossier des contrats d'acquisition du G-Wagen pour le Iltis. Nous n'avons simplement pas pu accélérer les choses suffisamment. C'est là un exemple de ce genre de problème.
Il y a ce dont vous disposez et ce que vous déployez. Cela pose des problèmes. Le char en est un exemple. Il faut également tenir compte des limites rigoureuses de la technologie quant à l'art du possible en matière de matériel.
Voici quelle est mon expérience à cet égard. Au début des années 90, je dirigeais le programme d'équipement de l'Armée de terre. J'étais alors colonel. Nous faisions face à tous ces problèmes dans les Balkans. Nous nous sommes rendu compte rapidement que certaines de nos méthodes d'acquisition de matériel ne correspondaient plus à la réalité. Nous en avons tiré de dures leçons.
Les choses se sont beaucoup améliorées. Depuis que je porte l'uniforme, l'Armée de terre canadienne n'a certes jamais mieux été équipée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lacunes, ni qu'il n'y a pas de place pour l'amélioration. Dans l'ensemble, je suis donc satisfait de la situation.
L'aspect le plus important -- et j'en arrive à ce qui vous préoccupe, je pense --, c'est la protection. Mesdames et messieurs, je suis désolé, mais il s'agit vraiment d'un problème difficile, la mobilité, la puissance du feu et la protection constituant les trois principaux aspects dans la guerre terrestre. Historiquement, les changements dans les opérations militaires terrestres ont toujours découlé d'une modification dans l'équilibre entre ces trois aspects. La puissance de feu a prédominé pendant fort longtemps. Les armes chimiques et autres sont si perfectionnées qu'elles peuvent pénétrer à travers presque n'importe quoi. Il faut peut-être une arme plus puissante, mais même les chars les plus modernes, les plus gros et les plus lourds peuvent être perforés. Sur ce plan, tout est possible. Voilà la cause du problème.
Nous le reconnaissons. Le lourd char de combat classique ne nous permet pas d'intervenir n'importe où. Il ne sera pas efficace. Nous pouvons nous en servir sur certains terrains, et c'est surtout pour la protection qu'il offre que nous avons envoyé ce char en Afghanistan. Ce n'est pas pour sa puissance de feu. Le LAV-25 possède une puissance de feu analogue à tout autre véhicule de combat sur le théâtre des opérations. On n'a pas besoin des chars pour leur puissance de feu, mais bien pour la protection qu'ils assurent.
Avant qu'on me demande pourquoi nous n'avons pas amélioré cette protection, je vous dirai que c'est -- j'allais dire matériellement impossible, mais ce ne serait pas tout à fait exact. C'est en raison de graves limites inhérentes à ce véhicule. Par conséquent, le LAV-3, un des meilleurs véhicules blindés légers au monde, a atteint sa charge utile maximale. Nous ne pouvons plus l'augmenter. Sur le plan de la technologie des matériaux, nous en sommes déjà au maximum dans la mise au point de nouveaux blindages.
Le problème est donc le suivant, mesdames et messieurs: nous en sommes rendus à une étape de l'histoire où nous attendons une percée technologique nous permettant de résoudre le problème. La solution ne résidera pas dans de nouveaux blindages, mais dans de nouvelles contre-mesures efficaces. Les véhicules blindés de combat intégreront la technologie furtive qui les rendra invisibles et indétectables. Vous serez témoins d'améliorations dans la technologie des matériaux, mais il se produira également des perfectionnements importants dans les systèmes actifs. Ces véhicules seront effectivement dotés de capteurs qui détecteront les projectiles et les explosions. De plus, il y aura des systèmes d'armes qui élimineront les missiles ou les projectiles en vol. Cela pourrait vous évoquerLa guerre des étoiles, mais nous en sommes presque rendus là sur le plan de la technologie.
Nous n'avons pas besoin de plus de blindages passifs ou de dispositifs plus gros. Il n'y en aura jamais assez. La difficulté à laquelle nous nous heurtons en ce qui concerne les mines et les engins explosifs improvisés -- ou EEI comme nous avons tendance à les appeler --, c'est que la technologie est tellement perfectionnée et à portée de main des terroristes. Dès que vous mettez au point une contre-mesure, ceux-ci trouvent un moyen de la contrer. C'est ce à quoi nous nous livrons à l'heure actuelle.
Je me suis en quelque sorte étendu sur le sujet, mais j'espère vous avoir donné une idée du problème.
Merci.
Je vais maintenant céder la parole à M. Murphy, qui sera suivi de Mme Gallant, puis ce sera encore au tour de l'opposition officielle; cela marquera la fin de notre première série de questions.
Allez-y, vous disposez de cinq minutes.
Merci bien, monsieur le président.
Je vous remercie également beaucoup d'être venu, monsieur, et je tiens à vous dire que j'apprécie votre franchise et votre point de vue éclairé.
Il y a quelque chose que j'aimerais que vous m'expliquiez concernant les communications dans les forces armées. Notre rôle en Afghanistan, comme vous avez pu vous en rendre compte, est un sujet brûlant au Canada. Chaque politicien a sa propre opinion sur la question, tout comme l'ensemble des ONG. Nous avons même des commentaires de George Bush. Nous avons reçu Pervez Musharraf hier et M. Karzai la semaine dernière. Je crois que la population canadienne a très envie d'en savoir davantage sur ce qui se passe. De mon point de vue, et corrigez-moi si je me trompe, il serait utile que les militaires nous informent plus. Je sais que le brigadier général David Fraser a été interrogé, mais normalement, c'est sur un incident en particulier, comme quand un soldat meurt ou qu'il y a un problème particulier en Afghanistan.
Je sais bien que c'est une zone de conflit et que vous n'allez pas nous dire ce que vous y faites, mais existe-t-il une stratégie pour que les militaires puissent communiquer directement avec la population canadienne les objectifs visés, la stratégie, les défis à relever et la façon dont la situation évolue? Honnêtement, je pense que les Canadiens ont soif de savoir, mais tout cela manque de clarté car il y a beaucoup de visions et d'opinions différentes sur la question. Il y en a qui parlent sans savoir, et puis il y a ce que disent les chefs d'État étrangers, dont certains ne sont pas très crédibles.
Prenons par exemple la guerre du Golfe, quand le général Norman Schwarzkopf apparaissait tous les soirs à la télévision. Celui-ci expliquait dans les détails ce que faisaient les militaires américains. Il jouissait d'une très grande crédibilité en Occident. Y a-t-il une stratégie dans ce sens, ou pensez-vous que les militaires canadiens devraient faire plus?
Il est évident que la communication joue un rôle central à notre époque; je crois que tous les militaires l'ont appris au cours des 20 dernières années et qu'ils se sont améliorés à ce chapitre. Mais on peut toujours faire mieux. Il me semble, toutefois — et je déteste utiliser ce terme dans un contexte différent —, qu'il faut trouver un juste équilibre. Je pense que le haut commandement, le chef d'état-major de la Défense et des gens comme eux, doivent être à la disposition du public. De mon point de vue, l'actuel chef d'état-major de la Défense est très disponible. Il est prêt à discuter sur toutes sortes de questions et se montre plutôt réceptif, car il sait qu'il est au service du gouvernement. Mais c'est toujours difficile, comme n'importe quelle personne en uniforme, de trouver le juste équilibre.
Par ailleurs, d'après mon expérience, les commandants se trouvant sur le théâtre des opérations ont toujours été ouverts aux médias. Je n'en ai pas fait l'expérience personnellement, je ne conteste pas donc ce que vous avez dit ou laissé entendre, mais je serais surpris que David Fraser n'aie pas des rencontres régulières avec les représentants des médias pour répondre à leurs questions.
Mais vouloir rencontrer les militaires — sur le modèle de Schwarzkopf — pour avoir des comptes rendus de guerre quotidiens serait à mon avis un changement extraordinaire. Je ne dis pas que c'est infaisable, et peut-être qu'à l'époque de la guerre du Golfe ce qu'ont fait Schwarzkopf et les États-Unis était souhaitable dans les circonstances, mais personnellement, j'ai du mal à imaginer un général canadien faire rapport quotidiennement de l'évolution d'un conflit.
J'avoue que je n'ai pas beaucoup réfléchi à la question, mais ça me semble un peu excessif, et cela risque d'envoyer de mauvais messages. Je suis certain que l'effet sur la nation... personnellement, je crois que le rôle des militaires dans la société est peut-être plus important qu'on pourrait le souhaiter dans une démocratie.
Ce que je veux dire, c'est que normalement, nous ne voyons ou n'entendons David Fraser que lorsque nous avons perdu un de nos soldats en Afghanistan, pour qu'il nous explique ce qui s'est passé. Il transmet ses condoléances à la famille et aux amis du défunt et s'explique du mieux qu'il peut. Je continue de penser que les militaires devraient avoir un rôle à jouer dans la communication d'informations — je ne sais pas lequel et j'aimerais avoir votre avis là-dessus —, mais honnêtement, je crois que les Canadiens ont une très grande soif de savoir et qu'il y a des lacunes à combler à ce niveau-là. Je considère qu'il serait très utile pour eux que quelqu'un sur le terrain leur explique quels sont les objectifs et les stratégies.
C'est tout en ce qui me concerne, mais si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y.
Je dois admettre, même si je n'ai pas réfléchi à la question sous cet angle, que je suis d'accord avec vous. La seule chose que j'aurais à ajouter, c'est que même si les militaires ont un rôle à jouer à ce niveau-là, au bout du compte, ce n'est pas aux militaires à expliquer pourquoi nous sommes là-bas. Je vous comprends donc, mais je ne pense pas que ce soit le rôle des militaires.
Merci, monsieur Murphy.
C'est maintenant au tour de Mme Gallant, puis nous reviendrons à l'opposition officielle.
Merci, monsieur le président.
Merci aussi à vous, Gén Jeffery, d'avoir précisé que les chars d'assaut n'ont pas été déployés pour détruire les infrastructures civiles, mais pour protéger nos troupes. Je suis heureuse de vous revoir ici, comme au temps où vous étiez commandant et que vous veniez à titre de témoin.
À ce propos, j'aurais aimé que ce comité puisse poser des questions, comme celles formulées par le premier député de l'opposition, avant le déploiement de nos troupes en Afghanistan. Peut-être que nous n'aurions pas eu à devoir informer le public ni à nous demander pour quelle raison nous sommes là-bas si nous avions eu l'opportunité de débattre du déploiement au tout début et de tenir un vote là-dessus, car il faut voir comment ce gouvernement s'y est pris pour prolonger notre engagement là-bas.
Si nos troupes obtiennent d'aussi bons résultats, c'est grâce à leur entraînement et à leur professionnalisme hors pair, même si lorsqu'elles ont été déployées pour la première fois en Afghanistan, elles n'avaient pas un équipement adéquat. Est-ce qu'à votre avis, l'équipement des Forces canadiennes en Afghanistan aujourd'hui est adapté à la mission?
Oui. Comme je crois l'avoir dit plus tôt, de mon temps, c'est probablement ce qui se faisait de mieux. Mais que ce soit clair : il y a toujours des lacunes; il est pratiquement impossible dans quelque...
Vous savez, pour chaque système, il y a un contre-système, et on essaye constamment de rattraper le retard. Il faut ajouter à cela les difficultés liées à l'achat et à l'acheminement du matériel. Les choses se font quand même, mais il y a toujours un décalage; ce n'est pas nouveau. Il y a donc des difficultés inévitables, mais nous ne sommes pas les seuls à les avoir. Toutes les armées sont confrontées à ce problème.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, notre priorité, c'est la protection de nos troupes. Évidemment, autant que je sache, nous continuons de faire de notre mieux. La seule inquiétude que nous ayons, sur le plan opérationnel, concerne le volet aérien et plus particulièrement les hélicoptères. Ceux-ci sont disponibles parce qu'ils font partie de la force de l'OTAN, mais ils ne sont pas spécialement réservés aux Canadiens. Cela limite quelque peu notre marge de manoeuvre.
C'est la seule chose à laquelle je pense ou qui me vienne à l'esprit, qui pourrait poser problème.
De notre côté, il y a ici au Canada, un parti politique et un secteur de la société, tout comme chez les talibans, qui veulent que nous nous retirions, mais ce serait pour aller dans des zones que des témoins qui ont comparu récemment ont qualifié de tout aussi dangereuses, sinon plus. Si c'est la voie que devait choisir le Canada, ce serait pour rapatrier les troupes.
Vous faisiez partie du commandement militaire canadien quand nos troupes ont été déployées au Kosovo et en Bosnie. Vous souvenez-vous si on a posé le même genre de questions, concernant des stratégies de désengagement possibles, bien avant que la mission ne soit terminée?
Si ma mémoire est bonne, oui. Il me semble avoir souvent débattu de cette question, à savoir s'il y a une stratégie de désengagement et si oui, en quoi elle consiste.
Honnêtement, une stratégie de désengagement claire facilite beaucoup les choses — autant sur le plan politique que militaire —, mais les choses ne sont pas aussi simples dans la réalité. Il est facile de se retrouver dans une impasse. Ceci étant dit, maintenant que vous vous êtes mis dans cette position, à mon avis, il vous incombe de continuer à travailler pour bien définir cette stratégie de désengagement et vous donner les moyens de la mettre en oeuvre.
Franchement, j'ignore pourquoi vous posez cette question, mais oui, cela a été un problème.
Si je comprends bien, à mesure que la mission avancera et que nous progresserons vers nos objectifs, nous saurons davantage quoi faire pour mieux nous acquitter de nos engagements sur place.
Oui. Je n'irais toutefois pas jusqu'à dire qu'il ne faut pas s'en préoccuper tant que les choses ne sont pas claires. On doit anticiper, mais ne pas se précipiter.
Un exemple classique est celui de la première guerre du Golfe, lorsque les États-Unis ont déclaré très clairement : « Nous n'allons pas à Bagdad. Nous n'irons pas plus loin »; ce qui était tout à fait logique dans les circonstances. Et le commandement militaire était ravi parce qu'il avait une stratégie de désengagement claire. Il savait exactement quoi faire, et en fin de compte, tout le monde a pu rentrer à la maison.
L'histoire montre que si on avait envisagé plus sérieusement la possibilité de changer les choses, on aurait évité bien des souffrances. Ce n'est pas parce que vous avez une stratégie de retrait que c'est nécessairement la bonne. Cela facilite la tâche à ceux qui mènent la campagne, mais il faut s'assurer que la stratégie répond aux objectifs politiques.
Merci.
Votre temps est écoulé. Je cède donc la parole au représentant de l'opposition officielle pour clore cette deuxième série de questions.
Monsieur Dosanjh.
Merci.
Lieutenant, j'ai lu ce matin avec grand intérêt dans le Globe and Mail un article de Jeffrey Simpson. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. Le journaliste parle des règles entourant la contre-insurrection et cite David Galula, grand spécialiste français de la guerre contre-insurrectionnelle. Il dit que cet expert a dressé la liste des cinq règles d'or pour mâter l'insurrection et qu'il semble qu'aucune ne soit appliquée par les forces canadiennes et de l'OTAN dans le sud de l'Afghanistan.
Voici les règles en question : garder une structure de commandement qui intègre des militaires et des civils; mettre un civil à la tête des opérations; étant donné que la contre-insurrection est au bout du compte une affaire politique, essayer d'éviter le déploiement à grande échelle de forces conventionnelles; et par-dessus tout, ne pas oublier de viser le soutien de la population locale — c'est-à-dire gagner la faveur du peuple, comme vous l'avez souligné plus tôt.
Est-il déterminant de suivre ces règles? Jeffrey Simpson croit que oui. J'aimerais connaître votre avis là-dessus et qu'un expert me dise si ces règles sont importantes et, si oui, est-ce qu'on les applique correctement?
Je n'ai pas lu l'article en question et je ne connais pas vraiment le spécialiste dont vous parlez...
Je vais me renseigner, mais je dois vous avouer que je ne connais pas son travail. Je ne suis pas venu ici pour réfléchir sur la théorie et la doctrine de la contre-insurrection, parce que c'est ce qu'on fait quand on commence à citer des principes.
Ceci étant dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est sûr qu'il ne faut pas perdre ces règles de vue. Quant à savoir si elles sont suivies en Afghanistan, c'est moins clair.
Il ne faut pas oublier que nous sommes une coalition, une alliance. C'est une opération de l'OTAN. Nous sommes sous son commandement. C'est à ce niveau-là qu'il faut appliquer les règles, et pas à tous les niveaux inférieurs. On pourrait en discuter. À ma connaissance, l'OTAN est sous contrôle civil. Les opérations là-bas, ainsi que la mission de l'ONU, sont sous contrôle civil.
Quant à la division du commandement et du contrôle, je ne suis pas certain de ce que cela implique. Le problème, c'est lorsque vous entrez dans la zone d'intervention canadienne sous le commandement de David Fraser, la situation peut être bien différente de ce que vous aviez imaginé. On devrait respecter ces principes, mais je ne suis pas certain que ça se fasse dans le contexte; je n'ai pas lu l'article en question.
Voilà pourquoi il est difficile de tirer des conclusions sur l'effort d'une coalition et de les appliquer à un pays. Nous faisons partie d'un tout.
J'apprécie cette distinction. Si nous agissions seuls, nous suivrions peut-être davantage ces règles, mais comme nous faisons partie d'une coalition.... car si nous voulions suivre cette règle de contrôle conjoint, nous l'aurions fait, peu importe que nous soyons seuls ou dans une coalition. Je ne vous contredis pas, mais ça me paraît logique.
Ma prochaine question porte sur les chars d'assaut et la difficulté à gagner la faveur du peuple. Je comprends que nous soyons préoccupés par la sécurité de nos troupes, et que c'est notre priorité à tous. Mais j'ai été frappé par quelques-uns des commentaires du lieutenant-colonel Matthew Moten, de l'armée américaine, selon lesquels l'envoi des chars Leopard en Afghanistan était une erreur, autant sur le plan stratégique qu'opérationnel. Même s'il reconnaissait leur puissance de feu et leur capacité de protection, il estimait que ces chars nous empêchaient de conquérir le coeur et l'esprit des populations locales.
J'aimerais savoir ce que vous en pensez, mais vous n'êtes pas obligé de répondre.
Je comprends qu'on puisse en arriver à penser ainsi. C'est une question de jugement, comme tout le reste. Je ne connais pas tous les détails, mais d'après ce que j'ai lu dans les journaux, on a envoyé environ 15 chars, ce qui, pour être franc, est très peu... On les utilise comme armes d'appui de l'infanterie, et seulement en cas de besoin, pas à grande échelle. Leur principal rôle est de permettre aux troupes d'avancer tout en étant protégées. On en a décidé ainsi à la suite de la bataille de Panjawai, où un certain nombre de blindés LAV-3 ont été détruits. On n'avait pas la protection adéquate pour pénétrer dans une zone de combats intenses.
Il faut trouver le juste équilibre. Mais vous avez raison, on commence à faire pencher la balance d'un côté. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est toujours une question d'équilibre. Plus vous faites de démonstrations de force, plus vous risquez de perdre le soutien de la population afghane. Et c'est loin d'être négligeable.
Très bien. Ceci conclut notre deuxième tour de table. Chacun a eu l'occasion de poser une question.
Nous allons entreprendre le troisième tour sous peu, mais je ne crois pas que nous pourrons le terminer. Préférez-vous poursuivre la séance à huis clos et discuter des déplacements? Je vous laisse le soin d'en décider. Puis-je demander à ceux qui sont pour de lever la main? C'est donc ce que nous ferons.
Mais avant, si vous me le permettez, en tant que président, j'aimerais poser quelques questions au témoin.
Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre franchise et d'avoir répondu à nos questions du mieux que vous pouviez, étant donné que vous n'êtes plus sur la ligne de feu, si je puis m'exprimer ainsi, depuis quelque temps déjà.
Ce qui me préoccupe, c'est de savoir comment nos soldats sont traités à leur retour au pays. Certains reviennent en bonne santé et en un seul morceau; cela étant dit, vous avez évoqué le syndrome de stress post-traumatique. Toutefois, qu'arrive-t-il lorsque des combattants reviennent blessés, avant la fin de la mission? Prend-on bien soin d'eux?
Oui. Laissez-moi vous situer le contexte.
Comme nous l'avons vu dans les Balkans au cours des années 1990, voire même au début des années 2000, nous avons manqué à notre devoir. Nous avons laissé tomber nos soldats, nos marins et nos aviateurs — mais particulièrement nos soldats parce que c'est parmi eux qu'on compte le plus de victimes. Cela faisait tellement longtemps que nous n'avions pas été confrontés à de réels combats que nous avions oublié ce que c'était, et nous n'avons pas suffisamment porté attention à ces choses. Nous l'avons appris à nos dépens.
À mon avis, le système de soutien que les Forces canadiennes ont mis en place pour venir en aide aux soldats blessés, y compris ceux souffrant de troubles psychologiques, et aux familles des soldats blessés ou tués, n'a pas son pareil. Je ne dis pas qu'il n'y aura jamais d'erreurs ni que le système est parfait, loin de là. Ce que je dis, c'est qu'il a été très bien pensé. On intervient aussitôt qu'une personne est blessée. D'après mon expérience et ce que les gens concernés m'ont dit, c'est un système très satisfaisant.
Le problème le plus délicat est bien celui du SSPT, syndrome de stress post-traumatique. C'est un problème difficile à traiter, non pas à cause d'un manque de ressources, mais plutôt d'une réalité selon laquelle les gens — particulièrement ceux qui portent l'uniforme — sont très fiers de ce qu'ils ont accompli et que, malgré toute la formation et la préparation qu'ils ont reçu, ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont un problème psychologique. Ils perçoivent souvent cela comme une faiblesse et ne veulent pas en parler. Mon ami Roméo Dallaire a affirmé publiquement à plusieurs reprises qu'il aurait préféré perdre une jambe plutôt que d'être victime de ce syndrome. C'est exactement le sentiment de beaucoup de gens.
Ce que je veux dire, c'est que le système ne peut rien si les gens ne veulent pas admettre qu'ils ont un problème et en parler.
En ce qui concerne les restrictions des différentes forces qui sont là-bas, si un pays dépêche des troupes sur le terrain et que celles-ci ne peuvent participer pleinement aux opérations, peuvent-elles être ou sont-elles utilisées comme renforts? Cela est-il possible? Lorsque la participation d'un pays est très limitée, jusqu'à quel point ses troupes peuvent-elles se rapprocher des lignes de front?
Il faudrait presque prendre un exemple précis pour répondre à cette question. C'est comme un casse-tête. Un commandant, au sein d'une coalition, doit tenir compte de tous les éléments du casse-tête — c'est-à-dire des limitations et de la capacité d'intervention de chaque pays — avant de décider. Dans certains cas, c'est clair. Dans d'autres, il faut faire preuve d'imagination dans l'utilisation des forces, tout en essayant de composer avec ces limitations.
Je m'écarte peut-être un peu du sujet, mais je crois comprendre qu'en Afghanistan, le commandement a misé sur la collaboration des troupes britanniques, canadiennes, allemandes et américaines, parce que leur capacité et leurs restrictions leur permettent de travailler pleinement ensemble. Les autres mènent des opérations ailleurs, là où c'est moins compliqué. C'est une bonne méthode. Bien entendu, le danger, c'est qu'après un certain temps, on fait porter un poids démesuré sur ces nations qui font le gros du travail. La question est de savoir si cela devient un problème politique pour ces pays.

