IWFA Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
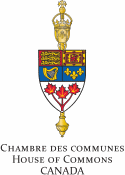
Comité spécial sur la violence faite aux femmes autochtones
|
l |
|
l |
|
TÉMOIGNAGES
Le jeudi 28 novembre 2013
[Enregistrement électronique]
[Traduction]
Merci d’être avec nous à nouveau pour la deuxième réunion du Comité spécial sur la violence faite aux femmes autochtones.
Je remercie les témoins de leur patience et je les prie de nous excuser de les avoir fait attendre. Nous avions quelques affaires internes à régler avant d’entendre votre témoignage.
Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion. Nous avons très hâte de vous entendre. Nous accueillons aujourd’hui John Syrette, président de l’Association des chefs de police des Premières Nations, et John Domm, chef de police de Rama.
Bienvenue à tous les deux, John et John. Nous vous céderons d’abord la parole pendant 10 minutes, puis nous commencerons nos tours de questions.
Merci, mesdames et messieurs, d’avoir invité l’Association des chefs de police des Premières Nations à comparaître devant vous ce soir. Je m’appelle John Syrette et je suis chef du service de police d’Anishinabek, mais je suis aussi président de l'Association des chefs de police des Premières Nations.
Je suis accompagné de M. John Domm, chef du service de Rama, en Ontario. Il a aussi été chef du service de police de la nation Nishnawbe-Aski, qui a son siège à Thunder Bay, en Ontario.
Notre association, l’Association des chefs de police des Premières Nations, a été constituée en personne morale en 1992 dans le but de regrouper les chefs de police visés par les ententes d’autogestion des services de police conclues à la suite de l’approbation de la Politique sur la police des Premières Nations, la PPPN, approuvée par le Cabinet en 1991. Nous avons pour mandat de servir les services de police des Premières Nations et les territoires autochtones partout au Canada en favorisant le niveau le plus élevé de professionnalisme et de responsabilité au sein de leurs services de police, tout en reflétant les cultures, le statut constitutionnel, les circonstances sociales, les traditions et les aspirations propres aux Premières Nations. Nous comptons peu de membres, soit environ 60 chefs de police.
Vous savez probablement qu’il y a 38 services de police autonomes et autogérés, établis dans le cadre d’ententes tripartites conclues en vertu de la politique sur les services de police des Premières Nations. Ces services sont en place au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Les communautés que nous servons comprennent des Premières Nations distinctes, dont plusieurs ont leur propre langue et leurs propres traditions culturelles. Vous, de même que la plupart des Canadiens, connaissez très bien les nombreux défis qui se posent à nos communautés, dont la pauvreté, le chômage, le logement, l’accès aux services médicaux et sociaux, la toxicomanie, l’alphabétisation et les niveaux de scolarisation, ainsi que les séquelles des pensionnats, entre autres.
Ce sont là des facteurs importants qui contribuent à la violence dans nos communautés, y compris la violence faite aux femmes. Comme nous le savons, un grand nombre de femmes qui quittent leurs réserves pour se rendre dans de grands centres urbains y deviennent des victimes de la violence.
Les préoccupations de ce comité au sujet du bien-être des femmes autochtones sont appréciées. Nous espérons que votre travail aura une certaine influence sur la réaction du gouvernement fédéral devant les conditions qui mènent à la violence perpétrée contre les femmes autochtones, peu importe où elle sévit.
À notre avis, l’élimination de ces causes profondes est la stratégie de prévention la plus importante.
Nous savons, d’après l’étude de Shannon Brennant publiée par Statistique Canada en 2009 et intitulée La victimisation avec violence chez les femmes autochtones dans les provinces canadiennes que les femmes autochtones sont presque trois fois plus susceptibles que les femmes non autochtones de déclarer avoir été victimes d’un crime de violence. La majorité des incidents de violence perpétrés contre les femmes autochtones l’ont été par des hommes qui ont agi seuls et la plupart des incidents violents n’ont pas été commis à l’aide d’une arme ou entraîné de blessure. Font exception les incidents de violence conjugale, pour lesquels près de la moitié des femmes autochtones victimisées ont déclaré avoir été blessées. Enfin, la plupart des incidents violents envers les femmes autochtones n’ont pas été signalés à la police ou à un autre service officiel d’aide aux victimes, à l’instar de la victimisation en général. La plupart des femmes autochtones ont plutôt décidé de se confier à une source non officielle, comme une amie ou un membre de la famille.
Qu’est-ce que cela signifie pour les services de police des Premières Nations?
Premièrement, nos agents ont reçu une formation sur les interventions de première ligne dans les cas de violence faite aux femmes, dans la même mesure que les membres des autres services de police du Canada, ce qui est crucial. La formation, de la police, dans les réserves et à l’extérieur, serait améliorée si on mettait un accent particulier sur les femmes autochtones.
Dans de nombreux centres urbains, la police établit des partenariats avec d’autres organismes qui fournissent un soutien aux victimes ainsi qu’aux femmes et aux jeunes filles vulnérables. Il s’agit d’un modèle efficace et les administrations incitent les services de police à l’adopter. Cependant, il ne peut pas être appliqué dans le contexte des services de police autochtones parce que nous n’avons pas de tels partenaires sur qui compter.
Deuxièmement, il est utile qu’un service de police puisse réagir de façon proactive à la violence faite aux femmes. Il n’y a que peu ou pas de services de police autochtones dotés d’un poste spécialisé dans les interventions auprès des victimes de violence de sexe féminin, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas tenu compte des actes de violence signalés.
Je vous donne en exemple le service de police de Treaty Three, à Kenora, en Ontario. Le coordonnateur des questions de violence a une vaste gamme de responsabilités, dont les suivantes: enquêtes; saisie de données dans des systèmes comme le ViCLAS, un outil de la police servant à identifier les personnes qui commettent des crimes de violence; relations de travail avec les procureurs de la Couronne, d’autres services de police et les organismes de services sociaux; présentation d’exposés et d’information à la communauté; programmes de formation; tenue de documentation; aide aux victimes et rapports aux administrations.
Troisièmement, le travail effectué par notre association de concert avec d’autres organisations policières nous permet de participer au perfectionnement professionnel portant sur les interventions de première ligne relatives à la violence faite aux femmes, et sur les mesures de prévention pertinentes. Par exemple, l’ACPPN est membre d’office du conseil d’administration de l’Association canadienne des chefs de police.
Nos membres siègent également à un certain nombre de comités de l’ACCP qui traitent de cette question, à savoir le comité sur les services de police des Premières Nations, le comité sur la prévention du crime et le comité sur les victimes d’actes criminels. Ces comités mettent constamment en lumière la situation de violence dans les communautés autochtones et permettent aux communautés de faire valoir leurs pratiques prometteuses.
Quatrièmement, nos relations avec les associations autochtones nationales nous fournissent des occasions de parler d’une seule voix des questions préoccupantes que nous avons en commun et de communiquer des messages cohérents à nos propres communautés.
À titre de policiers, nous pouvons fournir des services d’intervention de première ligne plus efficaces lorsque nous sommes réceptifs à des changements constructifs et que nous nous accordons avec ceux qui représentent les priorités des femmes autochtones. Par exemple, nous maintenons une étroite relation de travail avec l’Assemblée des Premières Nations, qui a fait de la violence perpétrée contre les femmes et les jeunes filles autochtones l’une de ses priorités en matière de politiques. Nous sommes en liaison avec l’Association des femmes autochtones du Canada, qui se consacre à la promotion du bien-être des femmes et des jeunes filles autochtones au moyen de communications continues. J’ai pu présenter les mesures prises par mon service de police en réaction à la violence lors du forum national sur la sécurité communautaire et l’éradication de la violence tenu par cette association à Edmonton en avril 2013.
L’initiative de l’Association des femmes autochtones du Canada intitulée « Sisters in Spirit » est l’une avec laquelle l’ACPPN maintient des liens en raison de l’accent qu’elle place sur l’éradication de la violence faite aux femmes autochtones, et de son intérêt pour la formation des policiers et leur sensibilisation au problème des femmes et des jeunes filles manquantes.
Gardez à l’esprit que l’Association des chefs de police des Premières Nations est d’envergure nationale et qu’elle n’exerce aucun pouvoir sur les pratiques opérationnelles des services de police. Toutefois, nous sommes en mesure de servir des communautés individuelles grâce aux ressources que nous offrons à nos membres. Ces ressources comprennent des liens avec d’autres associations, des possibilités d’apprentissage continu, le partage d’information sur les politiques et les pratiques de première ligne efficaces et prometteuses, ainsi qu’un mécanisme d’établissement de consensus sur les priorités nationales des Premières Nations du Canada.
Pour conclure, je reviens à un point clé du rapport de Statistique Canada que j’ai déjà cité, à savoir que la plupart des femmes autochtones ne font pas rapport à la police lorsqu’elles sont victimisées. C’est un point qui ressort également du travail de « Sisters in Spirit », et la question concernant le nombre de femmes autochtones qui sont victimes de violence.
Notre message aux femmes et aux jeunes filles de nos communautés et à leur entourage est de signaler les incidents ou les menaces à l’attention de la police. Les interventions de première ligne de la police ont lieu après coup et ne tiennent pas compte des facteurs qui contribuent au crime. Néanmoins, la réaction de la police est un élément essentiel de l’intervention communautaire auprès des victimes de la violence.
Merci. C’est avec plaisir que nous répondrons à vos questions.
Très bien, parce que nous en avons probablement. Nous commencerons par Mme Mathyssen, pendant sept minutes.
Je vous remercie, madame la présidente. Merci beaucoup d’être ici et de nous fournir ces renseignements. Je pense que c’est extrêmement important.
Comme vous le savez sans doute, nous avons abordé ce sujet à maintes reprises et dans de nombreux comités. Mais j’espère qu’il en sortira quelque chose de concret cette fois-ci, qu’il y aura de vraies mesures.
Vous avez raconté tous les deux ce qui se passe dans les communautés autochtones. Vous avez évoqué le service de police de Kenora et le fait qu’il n’y a pas de protocole d’intervention et que les interventions de première ligne sont prioritaires pour apporter des changements ouverts et constructifs.
Ma question porte sur vos besoins. Mme Ashton a proposé que des subventions d’action communautaire soient versées pour appuyer l’élaboration de plans d’action communautaire et la création d’équipes de gestion d’urgence dans toutes les communautés autochtones. Je pense que cela répondrait à votre demande concernant la formation des policiers, la sensibilisation, afin d’intervenir de manière pratique et pertinente.
Que pensez-vous de ces subventions et de l’élaboration de plans d’action communautaire? Serait-ce utile pour vous, dans vos activités visant à assurer la sécurité des femmes et des jeunes filles?
C’est une très bonne question. À l’heure actuelle, c’est un secret de polichinelle qu’un grand nombre de nos communautés sont presque gérées par des tiers; autrement dit, le financement dans un grand nombre de nos communautés est limité, parce qu’il y a de nombreux besoins et peu de moyens financiers. Je pense que les priorités de nombreux dirigeants de nos communautés sont celles que nous avons indiquées plus tôt — la pauvreté, le logement et d’autres enjeux sociaux — et que ce type de financement leur permettrait de détourner un peu leur attention des grandes priorités, parce qu’ils sauraient que des fonds suffisants seront fournis pour créer ces relations et mieux intervenir en cas d’incidents de violence.
Je suis convaincu que nos partenaires font tout ce qu’ils peuvent, au quotidien, avec les fonds limités dont ils disposent. Ils font leur possible avec du personnel minimal et, normalement, lorsque la police a besoin de ses partenaires, c’est surtout après les heures normales de bureau. Il serait formidable d’avoir du personnel supplémentaire — des gens sur qui nous pourrions compter lorsque nous sommes appelés pour intervenir lors d’un incident de violence. Ces partenaires sont cruciaux pour nous.
Pendant des années, les services de police ont sévi, et nous continuons de le faire, alors que nous préférerions ne pas contribuer à accroître le nombre de détenus. Je crois qu’une estimation conservatrice est que nous représentons environ 4 % de la population nationale, mais que nous sommes très surreprésentés dans la population carcérale. J’imagine que cela influerait sur le nombre de personnes que nous jetterions en prison, si nous pouvions intervenir en amont par l’éducation, par des programmes, et que nous pouvions convaincre les membres de nos communautés que la violence ne devrait pas être acceptée. Mais cela ne se fera que par l’éducation et la conviction profonde que ces comportements ne sont plus acceptables. Nous devons chercher à les réduire et, nous l’espérons, à les éradiquer complètement.
Vous venez de toucher un aspect très important. En 2010 et en 2011, le comité de la condition féminine s’est rendu à Iqaluit. L’une des choses qui sont ressorties très clairement, c’est que, dans les ménages où il y avait de la violence, le pourvoyeur se retrouvait souvent en prison parce que personne ne savait quoi faire d’autre. À cause de cette incarcération, toute la famille souffrait. Il n’y avait plus rien pour appuyer la famille et s’assurer qu’elle pouvait guérir. On ne punissait pas seulement l’auteur de la violence, mais aussi les victimes, et très profondément.
Si vous rédigiez notre rapport, vous assureriez-vous qu’il y aurait recommandation en faveur de ce financement, que le financement fasse absolument partie des propositions de notre comité, pour l’avenir?
Je vous remercie.
J’avais une autre question. Elle porte sur un aspect que vous avez abordé, soit la réalité de la pauvreté et ses effets sur les communautés, ses effets sur les personnes, et les besoins inassouvis dans les communautés. Dans la tournée de 2010, nous sommes aussi allés dans des communautés où sévissait une crise du logement indicible, et où il était impossible d’offrir un refuge ou un appui aux femmes et aux jeunes filles victimes de violence, à cause de la pénurie de logements.
Est-ce qu’un investissement — une fois de plus, il est question de sous — dans des services de première ligne, dans des refuges dans les réserves, dans les communautés du Nord et les communautés rurales, aiderait à offrir ce genre de soutien que vous souhaiteriez pour les femmes et les jeunes filles victimes de violence?
Pour répondre brièvement, vous évoquez les refuges pour les femmes et les jeunes filles victimes de violence. Ces refuges sont cruciaux partout et pour toute victime de violence, et le besoin est certainement encore beaucoup plus criant pour les victimes dans le Nord. J’ai travaillé dans des régions éloignées au nord de l’Ontario, et c’était une réalité très cruelle pour les membres de ces communautés dans les réserves du Nord accessibles seulement par les airs.
Alors oui, des refuges seraient très utiles pour ces femmes lorsqu’elles en ont besoin, parce qu’elles ont des choix très limités.
Merci beaucoup, madame la présidente.
Chefs, merci d’être ici aujourd’hui.
Je pense que vous avez mentionné qu’il y a 60 chefs dans 38 services, quelque chose comme ça. Ou alors, je me trompe et c’est l’inverse.
Combien y a-t-il de policiers dans des services de police autochtones au pays?
Fantastique.
Pouvez-vous décrire un peu le fonctionnement de votre association et, plus précisément, comment vous collaborez avec les autres services de police pour offrir ces services d’un océan à l’autre?
Nous sommes reliés à la grande association, l’Association canadienne des chefs de police. À l’échelle locale, un grand nombre de nos services de police sont reliés à l’association provinciale. Des relations sont créées et des renseignements sont partagés. Grâce à la création et au maintien de ces relations, un grand nombre de problèmes quotidiens sont réglés dans un cadre informel. Nous obtenons un formidable appui des services de police fédéraux, provinciaux et municipaux avec lesquels nous avons des interactions.
Une affirmation a grandement attiré mon attention. Vous avez cité une étude qui affirme que « la plupart des incidents violents envers les femmes autochtones ne sont pas signalés à la police ». Si tel est le cas, comment votre organisation ou d’autres organisations policières peuvent-elles encourager les femmes victimes de violence à signaler ces incidents, à votre organisation tout au moins? Prenez-vous des mesures pour changer la situation?
De nombreux efforts ont été déployés pour chasser une foule d’idées reçues sur la police. Je pense, par exemple, aux séquelles des pensionnats. À l’époque, les policiers étaient vus comme ceux qui venaient prendre les enfants. Nous ne nous sommes pas encore débarrassés de cet héritage. Nous avons encore du mal à convaincre les gens que nous sommes là pour les appuyer et les aider. L’effet résiduel de ces idées reçues est encore fréquent dans un grand nombre de nos communautés, alors nous avons un mal fou à les faire changer d’idée. Des mesures et des interventions efficaces face aux incidents de violence amélioreront grandement la situation, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire avant que les gens se sentent assez en confiance pour nous appeler.
Est-ce aussi répandu dans les 38 communautés où travaillent vos membres? Les femmes autochtones sont-elles plus susceptibles de faire un signalement à un service de police autochtone, ou les chiffres sont-ils encore, malheureusement, très bas? Y a-t-il un écart lorsque les services de police sont fournis par la GRC ou un service de police provincial et lorsqu’ils sont fournis par un service de police autochtone? Savez-vous si les signalements sont plus nombreux en cas d’incidents de violence?
Je ne crois pas que des statistiques démontrent qu’elles sont plus à l’aise pour faire un signalement à un service autogéré qu’à la GRC. Je n’ai pas de preuves de ce genre, désolé.
Très bien.
Dans vos communautés, alors, peut-être. Vous êtes tous les deux chefs de police dans l’une de ces communautés. J’aimerais maintenant que vous portiez ce chapeau et répondiez à cette question. Dans vos communautés, la situation est-elle stable? Constatez-vous que c’est encore un problème? À mesure que les programmes d’éducation sont mis en place, y a-t-il plus de signalements? La situation reste-t-elle stable? Est-elle pire? Quelle est l’expérience de votre service de police?
Je pense que la situation s’améliore. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a quelques années, on m’a indiqué qu’il arrivait souvent, lorsqu’une femme était dans un ménage violent, qu’elle avait subi 30 incidents de violence avant de décrocher le téléphone et d’appeler la police. Notre objectif est d’être efficaces la première fois qu’elle trouve le courage de nous appeler. Nous espérons que cela se saura dans la communauté, qu’on saura que nous sommes là pour elles. Nous espérons que notre intervention est positive et leur donne la volonté d’agir que nous souhaitons.
Nous avons progressé, mais nous reconnaissons qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
Est-ce que l’un de vous connaît le programme pour la prévention de la violence familiale et, si oui, que pensez-vous de son efficacité?
Le programme a fourni 24 millions de dollars sur deux ans. Depuis 2006, il a appuyé 41 refuges partout au pays, il a offert des services de refuge à plus de 16 500 enfants et 18 000 femmes qui vivent dans des réserves, et il a réalisé plus de 1 800 activités de prévention de la violence familiale et de sensibilisation à cette violence dans les communautés autochtones.
Connaissez-vous ces programmes? Sont-ils efficaces, selon vous, compte tenu des importants engagements financiers des dernières années?
Je serai franc avec vous. Je n’en ai jamais entendu parler, alors je peux difficilement me prononcer sur l’efficacité.
Si vous deviez résumer en une minute, comme nous devons le faire maintenant, quelles seraient la ou les principales difficultés auxquelles sont confrontés les services de police des Premières Nations?
Je dirais que nous souffrons d’un sous-financement chronique et que nous nous efforçons de déployer les ressources limitées à notre disposition le plus efficacement possible avec l’appui de nos partenaires dans nos communautés. La jeune dame a soulevé la question des subventions futures pour ce type d’activité. Ce serait positif pour nous. Cela nous permettrait de créer des liens et de renforcer ce que nous faisons actuellement avec les ressources limitées dont disposent les services des Premières Nations et les fournisseurs de services dans la communauté. Cela aiderait à combler le fossé et à créer un meilleur mécanisme d’intervention, une réaction plus pertinente et plus durable face à la violence dans nos communautés.
Merci beaucoup d’être avec nous aujourd’hui.
C’est la première fois que j’assiste à une réunion de ce comité. Je remplace un collègue.
J’aimerais que vous m’expliquiez un peu ce que vous faites, votre travail. Je sais que vous êtes chef d’un service de police autochtone, mais où travaillez-vous? Qui servez-vous? Combien de personnes travaillent avec vous pour offrir ce service? J’essaie simplement de me faire une idée de vos activités au jour le jour.
Mon service de police est responsable de 16 Premières Nations en Ontario. Nous avons un conseil d’administration, où chacune des communautés est représentée. Le conseil d’administration établit les priorités du service de police dans chaque communauté, et mon travail consiste à élaborer un plan d’intervention opérationnelle pour répondre aux besoins de ces diverses communautés. Il y a beaucoup de points communs, mais chaque communauté a aussi ses propres priorités, qui peuvent varier d’un endroit à l’autre. Donc, en ma qualité de chef de police, j’essaie de trouver la manière la plus efficace possible de déployer nos ressources pour nous assurer que nous répondons aux besoins du mieux que nous le pouvons.
Je travaille dans une petite communauté, située à environ une heure au nord de Toronto. Il y a chez nous l’un des trois grands casinos commerciaux en Ontario. C’est donc un cadre un peu particulier, un milieu semi-rural sur les rives du lac Couchiching, tout près de Orillia, en Ontario. Le casino est une grande attraction pour la ville de Toronto et ailleurs. C’est donc une communauté particulière et mixte, si l’on veut.
À titre de chef de police, je suis chargé de diriger l’organisation, de diriger le travail qui s’y fait, de faire la liaison avec la communauté, soit les membres de la communauté, les chefs de service ou les dirigeants politiques. De plus, comme mon ami John Syrette, je représente les neuf services de police autochtones autogérés en Ontario au sein de l’association provinciale des chefs de police. Je siège à quelques comités nationaux, par l’entremise de l’Association canadienne des chefs de police. Pour ces activités, nous représentons les services de police autochtones. Nous représentons nos organisations, mais nous présentons aussi les enjeux que nous connaissons et nous essayons de faire avancer ces dossiers à un niveau plus large. Que ce soit à l’échelle provinciale ou nationale, nous présentons ces enjeux.
Votre travail est certainement admirable. Il y a une importante population autochtone dans ma circonscription et je connais les difficultés qui sont liées aux services de police et aux autres services qu’il faut offrir dans un grand nombre de ces communautés.
Le système de gestion de l’information de la police autochtone indique que les services de police des Premières Nations doivent traiter actuellement 3,8 fois plus d’incidents criminels que dans le reste du Canada. Il présente aussi quelques indicateurs clés: le taux de criminalité est 5,8 fois plus élevé que la moyenne nationale, les agressions sont sept fois plus nombreuses que la moyenne nationale, et le trafic de la drogue est 3,8 fois plus élevé que la moyenne nationale. Ce sont des statistiques alarmantes, c’est certain, quel que soit le groupe de la population canadienne.
Comment abaisser ces niveaux? Je ne dis pas que nous ne les avons pas abaissés un peu, mais comment les ramener à un niveau encore plus bas que leur niveau actuel? De quels types de ressources avons-nous besoin pour commencer à investir dans les communautés autochtones afin d’atteindre cet objectif?
Je pense qu’il faut une approche globale pour s’attaquer à plusieurs facteurs sociaux, tels que la santé de base, l’eau potable, l’éducation et le logement. Il s’agit de besoins fondamentaux qui doivent être comblés pour tout être humain et dans toutes les familles partout au Canada. Sinon, on se retrouve avec la hiérarchie des besoins de Maslow. Il faut commencer par les éléments de base, établir des fondements solides et s’y appuyer pour aller plus loin. Sans ces fondements, il est très difficile d’intervenir dans un domaine et de réussir complètement.
C’est une question et une proposition très complexe et très difficile, et de nombreux grands esprits n’ont pas encore trouvé de réponse à ce jour, mais je suis encouragé de voir qu’on en parle. C’est très important, mais je ne pense pas qu’il y ait un seul aspect auquel nous pouvons nous attaquer et prétendre qu’en faisant ceci nous éradiquerons cela. C’est beaucoup plus complexe que cela.
Estimez-vous que ces besoins fondamentaux sont satisfaits dans les communautés autochtones où vous offrez des services de police?
Je ne peux pas faire de généralisation, mais je peux dire que certaines de nos communautés sont très avancées et s’attaquent à certains des problèmes que John a soulevés. C’est par le leadership politique, et certains dirigeants considèrent vraiment qu’il s’agit d’une priorité, d’un problème à régler, non seulement pour la communauté proprement dite, mais aussi dans l’esprit des gens. Il faut faire comprendre que ce genre de comportement n’est plus accepté. Les jeunes doivent considérer l’éducation comme une priorité. Dans ces communautés, je constate une énorme différence par rapport à d’autres communautés qui relèvent de mon service de police et qui ne sont pas encore arrivées au point où ce sont des priorités.
Il n’y a pas de solution unique. Chaque communauté a son propre niveau de développement, mais j’espère et je souhaite qu’un jour, lorsque je prendrai ma retraite, nous serons allés beaucoup plus loin et qu’ensemble, nous aurons établi un processus et un service qui aura réglé un grand nombre de ces problèmes.
Nous savons tous, je suppose, que le financement des services de police autochtones n’a pas augmenté de 2007 à 2012, et que la hausse du financement qu’on vous a accordée cette année ne sera probablement même pas aussi élevée que l’inflation et ne réglera pas, j’en suis sûre, votre problème de sous-financement chronique.
En tant qu’association, avez-vous évalué les ressources financières, pour déterminer comment avoir le financement suffisant pour mieux faire votre travail?
Nous avons effectué quelques études sectorielles, qui ont révélé une grande disparité par rapport aux services de police normaux. Nous espérons pouvoir aller plus loin à un certain moment, mais encore une fois, il n’y a eu aucune augmentation en 2013-2014. Ce n’est qu’en 2014-2015 qu’il y aura une modeste hausse de 1,5 p. 100.
Est-ce que je pourrais échanger mon tour avec Mme Brown, parce qu’elle vient de dire à quel point elle voulait sept minutes? Je pensais que j’en avais seulement cinq.
Merci, madame la présidente.
Messieurs, merci beaucoup d’être ici. J’ai quelques questions que j’espère présenter de manière fonctionnelle.
Monsieur Domm, puis-je vous poser d’abord la question suivante? Pouvez-vous me décrire les incidents de violence pour lesquels vous devez intervenir chez vous? Quel pourcentage des appels auxquels vous répondez porte sur des actes de violence?
À l’heure actuelle, je suis à Rama. C’est une communauté assez florissante. Il convient peut-être de souligner qu’elle est assez prospère à cause du casino. Je ne prétends pas que le casino est la solution, loin de là, mais il a créé une économie. Il a créé une demande pour d’autres services, tels que travaux publics, égouts, ou police, incendie, ambulance, etc. Il a aussi fallu une administration: de meilleurs services des finances, des affaires juridiques, des ressources humaines, etc.
Cette économie a vu le jour et a fourni à tout le monde des emplois lucratifs. La communauté a investi dans la formation et le développement de ses membres afin qu’ils puissent occuper ces nouveaux postes et participer à cette nouvelle économie, qui est devenue très florissante. L’économie est donc devenue une économie normale, si l’on veut: tous travaillent, ils élèvent leurs enfants, ont une famille. C’est une communauté très prospère. Il y a bien des problèmes de temps en temps, mais il y en a aussi ailleurs en Ontario. Le contraste est très grand avec la communauté où je travaillais auparavant.
C’est pour cette raison que j’avais commencé à parler de la région où se trouve la nation Nishnawbe Aski. J’y ai travaillé pendant quatre ans. En réponse à votre question, si je peux aller un peu plus vite, dans le Nord, la situation était complètement différente. La plupart de nos interventions touchaient à des incidents violents. Le taux était exceptionnellement élevé; parfois 10 fois plus de violence que la moyenne nationale pour certaines infractions. Le changement a été spectaculaire. C’est une réalité spectaculaire, mais tout de même la réalité.
Donc, le pourcentage d’appels portant sur des incidents violents que vous recevez à Rama est comparable à celui que constatent d’autres services de police ailleurs au Canada, selon vous?
Je représente la circonscription de Newmarket — Aurora. Je suis donc à une heure au Sud de Rama, et je sais que des centaines de milliers de dollars — voire des millions de dollars — sont dépensés dans ce casino. Il y a une circulation constante à partir du Nord de Toronto. Les enfants vont à l’école. Il y a un formidable hôpital dans la région d’Orillia et, évidemment, on peut aller à Barrie pour d’autres services quand il le faut. Donc, les besoins en éducation et en soins de santé sont comblés. Ce que vous dites, c’est que les gens ont un emploi et que cela fait une différence dans leurs choix dans d’autres aspects de leur vie. C’est juste?
Merci beaucoup. Orillia est une très jolie ville. Il y a tellement de jolies petites villes où il faut bon vivre dans cette région. Tout autour du lac Couchiching, il y a une foule de superbes propriétés, et je dirais que c’est un privilège de vivre dans cette région.
Monsieur Syrette, j’ai besoin de quelques éclaircissements concernant votre déclaration d’ouverture, et vous devriez pouvoir m’aider. Je cite votre déclaration, que vous nous avez fournie. Vous déclarez:
La majorité des incidents de violence perpétrés contre les femmes autochtones l’ont été par des hommes qui ont agi seuls.
Vous ajoutez ensuite:
La plupart des incidents violents n’ont pas été commis à l’aide d’une arme ou entraîné de blessure. Font exception les incidents de violence conjugale, pour lesquels près de la moitié des femmes autochtones victimisées ont déclaré avoir été blessées.
Premièrement, je me demande si vous pouvez préciser votre affirmation que la plupart des incidents de violence n’ont pas été commis à l’aide d’une arme ou entraîné de blessure. Voulez-vous dire des blessures causées par une arme, ou ai-je mal lu?
Pouvez-vous définir la violence dont il est question, parce que ce n’est pas très clair pour moi.
Je suis désolée.
Monsieur Domm, c’est vous qui l’avez lu. Vous vous êtes peut-être concertés pour préparer votre exposé. Toutes mes excuses.
Oui, nous nous sommes concertés, merci.
Cela vient directement du tableau de Statistique Canada. Ce sont des statistiques présentées dans cette étude. Je pense que vous parlez de la distinction entre les actes de violence commis avec une arme ou sans arme.
Je lis seulement ici que « la plupart des incidents violents n’ont pas été commis à l’aide d’une arme ou entraîné de blessure ». Alors, s’ils n’ont pas entraîné de blessure, comment pouvez-vous les définir comme des incidents violents?
Très bien. Je vous remercie de cette clarification.
J’aimerais revenir sur un témoignage de la semaine dernière. Nous avons entendu la Première Nation de Hollow Water, au Manitoba. Une femme qui a témoigné devant nous a déclaré:
Autrefois, on acceptait que les femmes soient traitées de la sorte, qu’elles fassent l’objet de maltraitances physiques et de sévices sexuels et tout ce qui vient avec. Dans ma collectivité, on avait adopté l’attitude voulant que la faute incombait aux femmes.
Elle a ensuite raconté comment des femmes de la communauté ont décidé de réagir et de dire que ce n’était plus acceptable. Pouvez-vous m’indiquer quand c’était acceptable, selon vous? Partout au Canada, quand était-ce acceptable? Y a-t-il un renversement de situation?
Je pense qu’il y a une amélioration. Je ne peux pas dire qu’il y a eu un point tournant. Je crois que les communautés avancent à leur propre rythme. Certaines vivent peut-être encore dans un environnement où c’est acceptable. J’espère que, grâce à l’intervention continue et à l’éducation, nous avancerons tous vers le jour où nous reconnaîtrons que ce comportement n’est plus acceptable.
Très bien. Merci, madame la présidente.
Merci beaucoup, chef Domm et chef Syrette, d’être ici et merci pour votre travail.
J’ai l’honneur de représenter Churchill, qui se trouve au Nord du Manitoba. Je connais de nombreux dirigeants et membres de la communauté qui ont les yeux tournés vers votre travail, d’autant plus que l’autogestion des services policiers a été accordée aux Premières Nations en Ontario. Chez nous, c’est un modèle qu’on aimerait suivre. Malheureusement, le gouvernement fédéral n’est pas à la table pour en discuter sérieusement.
Je suis consciente également de l’énorme besoin de services policiers dans les communautés que je représente, et chez les Premières Nations que je représente. Tout au long de votre exposé me sont revenus en mémoire quelques visites ou quelques cas. Je me rappelle être allée à Red Sucker Lake, une Première Nation oji-cri éloignée, très proche de la frontière ontarienne. Il n’y a pas de détachement de la GRC là-bas. On n’y accède qu’en avion et lorsqu’il faut appréhender quelqu’un, il faut faire appel au bureau de la bande. Il y a eu du vandalisme, et il a fallu faire des arrestations durant les heures de bureau. Les membres de la communauté ou les personnes incarcérées ne devraient pas avoir à vivre des situations de ce genre. C’est un échec de notre système fédéral lorsque les membres des Premières Nations ne reçoivent pas les mêmes services que les autres Canadiens.
Je comprends très bien l’importance que vous avez accordée à la violence faite aux femmes et comment votre travail est relié à cette question. Il y a quelques semaines, j’ai déposé à la Chambre des communes une motion demandant au gouvernement fédéral d’adopter un plan d’action national pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Cela ne tombait pas du ciel. De fait, les Nations Unies ont demandé au Canada d’adopter un plan d’action, parce que nous n’en avons pas, contrairement à d’autres pays semblables. Ma motion propose des lignes directrices. Le plan ne serait pas une obligation, plutôt des lignes directrices, et il accorderait une attention spéciale aux femmes autochtones.
La motion indique également que, pour mettre en oeuvre et faire appliquer le plan d’action, des ressources humaines et financières doivent être spécialement destinées à l’exécution des mesures prévues dans le plan. Cette motion attire beaucoup d’attention, et nous espérons que le gouvernement fédéral acquiescera à la demande des Nations Unies et reconnaîtra la nécessité d’un plan national, exprimée par de nombreuses organisations, et par des femmes et des hommes de partout au pays.
Compte tenu de votre travail, pas seulement en Ontario mais partout au Canada, croyez-vous qu’un plan national et une réaction nationale à l’égard de la violence faite aux femmes sont importants?
Oui, absolument. Là encore, c’est une question d’éducation des membres de nos communautés pour faire comprendre que c’est inacceptable. Ce plan d’action affirmerait clairement l’opinion des dirigeants, à l’échelle nationale, que c’est une priorité, qu’il faut résoudre ce problème et que ce n’est plus acceptable, et que le gouvernement du Canada fera tout ce qu’il peut pour mettre fin à la violence dans nos communautés. Je crois que ce serait une merveilleuse idée.
C’est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier pour votre exposé.
Chef Syrette, vous avez évoqué l’opinion des membres de nos communautés au sujet de la police. Je pense que c’est encore vrai aujourd’hui. Dans ma langue, [Le député s'exprime en cree] désigne quelqu’un qui vous emmène et vous enferme et [Le député s'exprime en cree] désigne quelqu’un qui vous arrête. Dans nos concepts et notre langue, nous n’avons pas encore la notion de service et de protection. Je suppose que nous en sommes encore très loin.
Vous avez évoqué dans votre exposé le manque de signalements de la part des femmes. Vous avez déclaré: « Notre message aux femmes et aux jeunes filles de nos communautés et à leur entourage est de signaler les incidents ou les menaces à l’attention de la police. » Je suis tout à fait d’accord. C’est une grande préoccupation.
Au-delà d’un plan national, sur quel aspect faudrait-il insister? La sensibilisation? J’ai beaucoup travaillé à la sensibilisation aux droits de la personne dans le monde entier. Je pense qu’un aspect est la sensibilisation. Dans cette veine, qu’est-ce qu’on fait avec les hommes?
Les auteurs des actes violents doivent savoir que ce n’est pas acceptable, mais il faut aussi un mécanisme pour les éduquer et leur faire comprendre pourquoi ils font ces choix. Ce n’est pas quelque chose qui s’apprend à l’école. C’est quelque chose qui est ancré et c’est malheureux.
Mais s’il était possible, par la gestion de la colère et divers autres programmes, par l’éducation et par les convictions de notre culture, de convaincre ces hommes qui prennent ces mauvaises décisions que ce n’est pas acceptable... Cela n’a jamais été enseigné, mais nous devons d’une certaine façon les convaincre que nous ne pouvons pas nous contenter du statu quo et que ce comportement n’est pas acceptable.
En tant que société, nous ne pouvons pas les ostraciser. Ils font partie de la communauté. Ils ont pris une mauvaise décision. En tant que société, nous devons aussi les aider et les aider à changer: ils n’iront pas en prison, ils s’attaqueront plutôt à la racine du problème. C’est mon espoir.
Merci beaucoup. Espérons que je n’aurai pas trop de mal à ne pas dépasser mes cinq minutes.
Je vous remercie tous les deux d’être ici ce soir. J’apprécie votre exposé et aussi le dialogue que nous avons eu jusqu’ici.
Dans votre déclaration, vous avez fait l’affirmation suivante: « Les communautés que nous servons comprennent des Premières Nations distinctes, dont plusieurs ont leur propre langue et leurs propres traditions culturelles. » J’apprécie également votre observation, en réponse à une demande d’un de mes collègues, que les différentes nations ont des capacités différentes de résoudre certains problèmes, peut-être à cause de leur développement économique et de quelques avantages qu’elles peuvent avoir, notamment lorsque des entreprises sont établies dans les réserves.
Ceci m’amène à la question que je veux vous poser, parce que je sais que le Programme des services de police des Premières nations repose sur le principe que les Premières nations devraient décider des types de services de police qui conviennent le mieux à leurs communautés. J’imagine que certains de ces programmes ou les services qui sont offerts dépendent aussi de la capacité de la communauté. Je me demande si vous pouvez m’expliquer le processus de consultation des communautés autochtones avant la signature d’une entente.
Il faut aussi que la communauté soit convaincue et qu’elle indique l’orientation qu’elle aimerait prendre. S’il s’agit de services de police autogérés, ils aimeraient savoir en quoi un service autogéré est meilleur que ce qui existe actuellement.
Je donnerai l’exemple de la province de l’Ontario parce que je connais mieux l’Ontario. La police provinciale de l’Ontario exécute l’Entente sur les services policiers des Premières nations de l’Ontario depuis plusieurs années. Un grand nombre des communautés dont les services de police sont assurés actuellement par mon service se sont retirées de cette entente dans l’espoir d’exercer un contrôle direct sur la manière dont les services de police sont offerts chez elles plus grand que lorsqu’une organisation à Orillia leur impose une façon de faire. Cette capacité de participer à la direction du service et à ce qu’elles jugent prioritaire leur donne le sentiment que le service leur appartient. Il est essentiel qu’ils acceptent le service de police, au lieu qu’il leur soit imposé.
Merci.
Ma deuxième question va dans ce sens.
Vous avez aussi affirmé dans votre déclaration d’ouverture qu’« il est utile qu’un service de police puisse réagir de façon proactive à la violence faite aux femmes ».
Je crois que vous avez donné l’exemple d’un service de police qui fonctionne très bien, celui de Treaty Three, à Kenora, en Ontario. Vous avez décrit le poste de coordonnateur des questions de violence et le vaste éventail des responsabilités de ce coordonnateur. Je suppose que vous en avez parlé parce que cela paraissait comme une pratique exemplaire ou peut-être un modèle qui pourrait être suivi par d’autres Premières nations et services de police pour renforcer les capacités.
Est-ce bien le cas? Avez-vous un rôle ou une responsabilité pour échanger des pratiques exemplaires entre Premières nations dans le cadre des programmes de services de police qui pourraient y être administrés?
Nous présentons le service de Treaty Three comme une pratique exemplaire. Ils font un formidable travail là-bas. Le poste qu’ils ont est financé hors du PSPPN. Il est financé par une subvention du programme de recrutement de 1 000 agents de la province de l’Ontario. Jusqu’à très récemment, le PSPPN prévoyait que nous n’offrions que des services de police de première ligne. D’autres unités spéciales existent normalement dans un grand nombre de services de grande envergure. Nous n’étions pas financés. Il y a eu une transition très graduelle vers l’acceptation de la création de ces unités spéciales. Ce fut une bataille. Mon service de police a aussi un coordonnateur des questions de violence. Nous ne voulions pas donner trop d’exemples, mais il y en a d’autres. Par l’échange de ressources et de renseignements, et par des exposés à d’autres services de police, nous espérons créer une vague d’enthousiasme qui déferlera dans tous les services des Premières Nations. Chacun d’eux fait au mieux de ses capacités et du financement mis à sa disposition.
Merci.
Nous entendrons maintenant Mme Mathyssen et M. Saganash. Je crois qu’ils partageront cinq minutes.
Merci beaucoup, madame la présidente.
Je suis ravie que nous ayons cinq minutes de plus avec vous, chef Domm et chef Syrette.
Qu’est-ce qui serait l’idéal, à votre avis? En tant qu’association, quelle serait votre principale priorité pour lutter contre la violence faite aux femmes, quel serait votre plus grand souhait?
Du financement pour chacun de nos services afin de pouvoir affecter ne serait-ce qu’un agent à cette liaison avec nos partenaires. Leurs priorités seraient l’éducation, l’établissement de liens, l’élaboration d’un plan à long terme en consultation avec nos partenaires et le mode d’application. Il n’y a pas de solution unique; dans chaque communauté, il faudrait s’adapter aux besoins. Ce serait un premier pas formidable.
En gros, oui, je suis d’accord.
Je voudrais parler de la sécurité, du sentiment de sécurité, et de certains problèmes connexes. Ce que nous devons reconnaître chez nous, ainsi que dans certains services de police autonomes des Premières Nations, c’est que la police n’est pas toujours là. C’est un problème. Les communautés ne cessent de nous le répéter. Ils veulent que nous soyons plus nombreux, en réalité. Ils veulent nous voir. Ils veulent que nous soyons présents, mais nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas là parce que nous ne sommes pas financés pour y être. Il peut s’agir d’une communauté — petite, je le reconnais — où il y a du financement pour deux agents. Mais deux agents ne fournissent que tant d’heures de services par semaine. La réalité, c’est qu’il y a de grands trous. À cause de ces trous et de l’absence de présence policière, on ne fait pas respecter la loi. Vous avez le sentiment qu’il est impossible de faire respecter la loi. Vous avez le sentiment de ne pas être en sécurité. Même si vous voulez signaler un incident, à qui le signaler? Si vous le signalez, qui sera là pour vous protéger? Qui sera là pour vous aider? Et pas seulement pour les premières heures ou le premier jour, mais aussi le lendemain, le surlendemain et la semaine suivante.
Ma question précédente visait probablement la nécessité d’un programme de sensibilisation national afin qu’un plus grand nombre de femmes signalent des incidents partout au pays.
Voyez-vous cette nécessité? Faudrait-il en parler dans nos recommandations? Et qui seraient les partenaires pour réaliser cette campagne de sensibilisation nationale?
Il y aurait évidemment l’Association canadienne des chefs de police des Premières Nations, mais je crois que l’APN serait un excellent point de départ. Un grand nombre de nos organisations provinciales et territoriales et l’Association nationale des femmes autochtones seraient un excellent point de départ. Il pourrait y avoir du financement pour quelque chose d’aussi simple qu’un numéro sans frais où elles pourraient appeler et expliquer ce qui se passe. Il y aurait à l’autre bout de la ligne quelqu’un qui pourrait les aider et leur expliquer à quoi s’attendre quand elles appellent la police — la police viendra à la maison et posera beaucoup de questions difficiles, mais il faudra répondre avec précision.
Ce type d’appui serait énorme pour nous. Lorsque la plupart de nos agents se présenteront sur les lieux, ils feront exactement ce qu’on dirait dans cette ligne d’aide, soit que les agents poseront beaucoup de questions difficiles; il faudra alors répondre le plus franchement possible et donner des explications.
C’est la seule façon de pouvoir résoudre efficacement le problème. Pour répondre de but en blanc, je pense que ce serait un bon point de départ.
Merci, madame la présidente.
Je partagerai mon temps avec mon collègue, M. Dechert.
Merci tous les deux d’être ici. Notre gouvernement prend certainement très au sérieux la violence contre les femmes et les jeunes filles au Canada, plus que tout autre gouvernement. Nous sommes ravis que vous soyez ici et que le comité puisse examiner ce que nous pouvons faire pour aider les femmes et les jeunes filles.
Le membre d’en face a laissé entendre que nous ne voulons pas accorder les mêmes droits qu’aux autres Canadiens, pourtant lorsqu’il a fallu voter sur le projet de loi S-2, le NPD et les libéraux ont voté contre et ne nous ont pas appuyés. Cette loi aurait donné aux femmes et aux hommes les mêmes droits matrimoniaux partout au Canada.
Vous avez présenté dans votre exposé une affirmation que je ne suis pas certaine d’avoir bien entendue. Avez-vous dit qu’une femme peut être agressée 30 fois avant de décrocher le téléphone? Avez-vous dit 30?
Ce chiffre était une estimation acceptée il y a quelques années dans un comité où je siégeais et qui s’appelait Justice Partners Serving Victims, en Ontario. Ce comité estimait de manière approximative et conservatrice qu’il fallait 30 incidents de violence avant qu’une femme trouve le courage de téléphoner à la police.
C’est très élevé. Je pensais que c’était trois. Trente, c’est tragique. C’est horrible.
Ai-je lu quelque part que vous avez participé à la marche Marchons un mille dans ses souliers? Participez-vous à cette activité dans vos collectivités?
Nous avons une marche Marchons un mille dans ses souliers à Kettle Point, l’une des communautés que je sers.
D’accord. Il me semblait bien que j’avais lu cela quelque part.
Je sais qu’à Condition féminine Canada, nous essayons de faire participer les hommes et les garçons à cette marche. Il y a les BC Lions dans l’Ouest qui s’efforcent de sensibiliser les hommes et les garçons à la violence contre les femmes et les jeunes filles.
Que font vos organisations pour sensibiliser les hommes et les garçons dans vos communautés?
J’ai vu un programme appelé I Am a Kind Man dans plusieurs communautés de l’Ontario. Il vise à éduquer et sensibiliser, et à renforcer, appuyer et valider des comportements et des gestes positifs.
À ma connaissance, il existait à Rama, et je l’ai vu dans d’autres communautés en Ontario, mais je ne sais pas s’il a une envergure nationale.
Merci, messieurs. Je parlerai rapidement parce que nous n’avons pas beaucoup de temps.
Quel pourcentage des cas de personnes disparues est résolu dans les réserves? En avez-vous une idée?
Avez-vous une comparaison avec le reste de la population ou savez-vous s’il y a une évolution avec le temps?
D’accord.
Notre gouvernement a consulté les victimes partout au Canada. De toute évidence, des femmes dans les réserves du Canada sont des victimes. Leurs familles sont aussi des victimes. Les victimes nous ont souvent raconté durant ces consultations que la police ne les informe pas assez sur ce qui arrive de leur dossier. Quelle que soit l’infraction perpétrée contre elles, elles font une déclaration à la police, puis la police prend l’affaire en main et ne les informe pas de la suite de l’enquête. Elles se font dire parfois qu’une accusation a été portée, puis elles n’entendent plus parler de rien avant le procès. Elles sont parfois appelées à témoigner. Parfois, il n’y a qu’un témoin, et ensuite, elles n’entendent plus rien d’autre à propos du processus judiciaire.
Quels types de mécanismes utilisent vos services de police des Premières Nations pour tenir les familles des victimes informées? S’il s’agit d’une personne disparue ou de violence faite à une femme, comment assurez-vous un suivi avec la famille et comment la tenez-vous au courant du processus?
Franchement, je ne crois pas que nous sommes différents des autres services de police en Ontario. J’applique la loi et les règlements provinciaux, les normes en la matière.
L’une des difficultés, pour tenir les familles bien informées ou tout au moins aussi informées qu’elles le souhaitent, c’est qu’on ne sait jamais pourquoi une personne est disparue ou portée disparue. Parfois, les personnes portées disparues fuient leurs agresseurs, alors nous devons être très prudents et tenir compte de toutes les possibilités dans ces cas...
Je suis désolé de vous interrompre. Et si c’est une affaire de violence faite à une femme et que l’agresseur est connu? Comment travaillez-vous avec les victimes pour les tenir informées au cours du processus? Pensez-vous qu’il faut le faire? Des victimes ou leur famille vous ont-elles exprimé ce besoin?
Absolument. Elles sont certainement informées lorsqu’une accusation est portée. Si l’agresseur est détenu jusqu’à audience de cautionnement, elles en sont informées. Si l’accusé est libéré, des systèmes et processus sont en place pour informer les victimes, les renseigner sur les conditions de la libération et les conseiller. Dans certains cas, nous avons même des plans de sécurité de la victime, afin de nous assurer qu’elle sait bien ce à quoi elle doit faire attention, quelles sont les précautions à prendre, que faire en cas de non-respect des conditions de libération par l’agresseur.
L’éventail des activités possibles avec une victime en particulier est très large, mais nous nous efforçons très certainement de travailler très étroitement avec nos victimes pour les tenir bien informées à toutes les étapes du processus.
Il se fait du travail formidable en partenariat avec les tribunaux et la police pour aider et appuyer les victimes.
Merci beaucoup.
Notre heure est malheureusement écoulée, et nous aimerions remercier le chef Domm et le chef Syrette d’avoir passé leur jeudi soir avec nous et de nous avoir éclairés sur le travail que vous faite dans ce domaine très important.
Merci à tous les membres du comité pour votre participation, et merci à nos observateurs.
La séance est levée.
Explorateur de la publication
Explorateur de la publication

